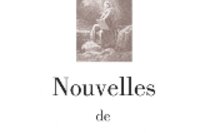Toute spiritualité chrétienne offre des expressions, des formules, des sentences à partager, qui permettent de signifier une façon particulière d’entendre l’Évangile et de suivre le Christ. Il en va ainsi des expressions ignatiennes. Quand elles sont investies du désir de dire, à l’intime, le lien qui unit à Dieu, elles en reçoivent un sens neuf. C’est ainsi que, pour une tradition spirituelle, à côté de la présentation et de l’analyse, toujours précieuses, un autre mode de lecture, plus libre, et qui est privilégié dans les textes suivants, permet d’entrer en résonance avec une expérience vivante. Fondé en 1987 à l’initiative du supérieur des jésuites de France, le groupe « Nicodème » a rassemblé des hommes d’une même génération, engagés sur des terrains divers : enseignements secondaire et universitaire, action sociale, revues, aumôneries. Ils étaient désireux de poursuivre ensemble une réflexion intellectuelle, attentifs aux questions posées par la culture contemporaine. Pendant quinze ans, ils ont tissé une « conversation » selon ce terme cher à Ignace de Loyola, leur fondateur. Elle renaissait à chacune de leurs rencontres, à partir de leurs expériences et aussi de textes qu’ils faisaient circuler entre eux, écrits par eux ou par des auteurs actuels. Un souci constant a été d’explorer les chemins et les obstacles de l’annonce de la foi dans le monde contemporain. Cela a conduit cinq d’entre eux au projet d’écriture de ces textes qui, dans la tradition ignatienne, parlent de l’accès à Dieu. Comme une manière d’inviter le lecteur à méditer à son tour ces expressions et à les habiter de son désir de Dieu et de sa liberté.
S’adresser au Seigneur « comme un ami parle à son ami »
La comparaison n’est pas neuve. Elle caracole déjà à travers les auteurs spirituels des premiers siècles. Une comparaison banale somme toute, trop courante, pour qu’il soit intéressant de s’y arrêter.
Mais c’est justement peut-être cette familiarité qui en fait la valeur. Parler à Dieu, c’est accepter d’entrer dans une relation. Le faste des églises, le ressassement des liturgies, les débats des Conciles ont pu nous donner à croire que Dieu était une affaire de religion, de définition. S’adresse-t-on à un concept ?
Pourtant, à chaque fois, c’est cette intimité avec Dieu qui a irrigué du plus profond ces mots et ces gestes qui ont structuré l’Église. Mais rien de plus indicible que cette source vive. Elle nous a été transmise. D’autres nous en ont parlé, nous y ont conduits. Un jour, cependant, cette histoire de Jésus-Christ n’en a plus été une. Nous nous sommes découverts compagnons d’un homme qui a marché sur les routes de notre terre. L’hostie des eucharisties est devenue le pain partagé d’un repas commun. Nous le croyons mort, passé. Il est vivant.
Le monde entier s’est offert à la lumière de ses pas. La poussière s’est mise à scintiller de ses traces. La banalité des jours n’en a pas été effacée pour autant. Elle s’est éclairée, habitée alors par la présence d’un nouvel ami. Tout s’est mis à parler de Dieu. Les événements des jours, les rencontres, les lectures, ont commencé à dire et à redire la crainte de ses absences, l’illumination de ses confidences. Il ne s’agissait plus alors de savoir si Dieu était nécessaire ou s’il était utile ; si son existence expliquait le monde ou répondait à la mort. Le temps s’est mis à s’écouler autrement. La prière s’est développée en moments inattendus d’affection, en une futilité de camaraderie. Il ne s’agissait plus tellement de dire ou de faire, mais de laisser se creuser au fil des jours une intimité, de laisser ses sens et son coeur être touchés par lui, par sa manière de vivre.
Recevoir d’être « compagnons de Jésus » s’est nourri de tous ces instants. Passer par Ignace de Loyola livre une manière de vivre, une manière de faire. Mais l’essentiel se déchiffre dans l’amitié avec le Christ, dans cette ouverture à la vie d’un ami qui grandit en nous, entre nous.
Il est le Ressuscité qui a préparé le repas sur la rive du lac. Il est Celui qui marche à nos côtés sans se lasser, comme il a marché sur les routes de Galilée sans s’inquiéter de perdre du temps, sans se préoccuper de ne pas être ailleurs. Il est le visage rayonnant sur la montagne, dévoilant pour nos regards cette lumière qui nous illumine déjà. Il est Celui qui, dans l’abandon et l’angoisse d’un jardin, s’est abandonné sans réserve entre les mains de son Père. Il est ce Dieu qui a appris d’un homme et d’une femme à prier. Il est ce Berger qui abandonne tout pour partir à la recherche de la brebis perdue et qui rayonne de joie lorsqu’il l’a retrouvée. Il est ce créateur de paraboles qui nous raconte un royaume où nos calculs, nos ayants droit n’ont plus cours. Il est l’ami qui pleure Lazare. Il est ce corps que ne peut retenir Marie Madeleine.
Pascal SEVEZ
« Chercher Dieu en toutes choses »
Chercher, et chercher encore. Sans fin. Chaque jour. Jour après jour. Aujourd’hui. Hier. Demain. Maintenant. Ici. En cet instant reçu. Reçu parce que donné. Et voilà que tout change. Le temps est donné. Il est offert. Il est le lieu de ce chercher qui ne se satisfait d’aucun trouvé.
Pas d’espace privilégié pour ce chercher. Tout. Absolument tout est lieu de ce désir ardent, le plus souvent éteint. Chaque rencontre, chaque moment relance le désir de la quête. Être là avec un autre humain, vivre le silence, déchiffrer un texte, balayer un couloir, laver du linge, prendre un repas, tous ces gestes, et tous les autres, sont habités par ce désir. Rien n’y échappe, sinon celui qui désire et qui souvent se laisse tomber dans le sommeil.
En toutes choses, veiller, patienter, désirer, reconnaître, découvrir, se réjouir, continuer. Il n’est jamais là, parce que je ne suis jamais complètement là. Chercher, c’est reconnaître ce léger décalage, cette absence à moi-même qui conduit à ne pas être là lorsqu’il est là, et à le reconnaître lorsqu’il est déjà parti, quelques pas plus loin, vers un autre, des autres. Il n’y a là nul regret, mais bien reconnaissance amoureuse que l’amant véritable me précède toujours un peu, qu’il sait atteindre au plus intime et plus vivant lors même que je refuse.
Le chercher en toutes choses, lui, lui seul, c’est découvrir que je cherche beaucoup d’autres que lui. Il ravive mon désir de son passage plus que de sa présence, car sa présence dirait ma fin. Il est en transhumance parmi nous, il ne nous convoque pas à nous arrêter, mais bien à marcher, portés par le secret désir de sa venue pour tous. Le chercher en toutes choses, c’est ne jamais le garder pour soi, mais bien le reconnaître quand il passe, et le désigner à ceux qu’il nous confie. Le chercher conduit à le désigner, à pointer notre doigt vers lui lorsqu’il nous est demandé qui nous sommes. Le chercher en toutes choses, c’est le découvrir toujours plus comme promesse de vie, de cette vie vraie qui ne retient rien de ce qui la nourrit, qui ne se fige pas sur des poses bien établies.
Le chercher en toutes choses, c’est de plus en plus le tutoyer, te tutoyer, devenir partenaire d’une relation sans fin renouée. Te chercher et t’apprivoiser, me laisser chercher et apprivoiser, être relancé vers les humains qui déjà t’ont accueilli, tant leur désir est grand d’une paix maintenant si absente.
Il n’y a nul arrêt, si ce n’est le sommeil quotidien qui repose l’être entier en le recréant au plus profond. Et même là, me laisser surprendre par ces réveils soudains, où se murmurent en moi, incroyables et souvent « incrus », comme insus, des mots donnés un jour, hier ou avant-hier, peu importe, qui retissent dans la nuit la mémoire amoureuse qu’il a secrètement nourrie par sa parole.
Te chercher en toutes choses, c’est me laisser atteindre par toutes choses, par tout autrui, le plus proche et le plus lointain. Tout ce qui advient est espace et temps pour t’accueillir.
Te chercher en toutes choses, c’est réentendre dans les situations les plus inhumaines les mots que tu as déposés en notre terre pour laisser germer une espérance folle.
« À la limite extrême du déchirement il ne reste plus rien que les conditions de l’espace et du temps. » Ces mots de Hölderlin me disent ce « te chercher en toutes choses », dans mon corps, avec les corps des autres milliards d’humains dispersés sur toute la terre humaine et inhumaine. L’espace et le temps sont les deux conditions inoubliables du chemin, de la recherche, de sa reprise et de sa relance inachevées et inachevables. Dans ce temps et dans cet espace naît et grandit le désir de toi, non pas de tous, mais seulement de quelques-uns vers toi. Habiter cet espace et ce temps, se laisser conduire toujours mieux vers eux, c’est-à-dire y demeurer en se laissant chaque jour déloger de ses abris, voilà ce qui est remis.
Te chercher en toutes choses, c’est éprouver que la plupart ne te cherchent pas, qu’ils n’ont nul intérêt pour cette quête, qu’ils sont occupés ailleurs. Partager cet ailleurs, l’entendre, le découvrir, c’est découvrir d’autres manières de vivre, de penser, d’aimer, de croire.
Te chercher là, c’est me laisser dérouter, suivre des voies nouvelles, parcourir des chemins inconnus parce qu’ignorés. Te chercher, c’est vivre le labeur humain qui désire que l’homme soit un peu plus homme, c’est partager le désir de briser la violence permanente qui ne cesse de déchirer le corps de l’humanité, à côté de moi, en moi, très loin de moi, partout, depuis toujours. C’est alors découvrir secrètement, dans la veille amoureuse, que tu as connu cette violence, que tu t’y es exposé, et qu’en ce lieu repose une nouvelle à accueillir jour après jour.
Te chercher en toutes choses, c’est lentement laisser éclairer mes pas et ceux de tous par cette lumière qui ne vient pas de nos efforts tenaces et acharnés, qui vient d’un lieu que nous n’avons pas créé, où tu nous invites silencieusement.
Te chercher en toutes choses, c’est découvrir ta manière de venir vers nous en nous conduisant là où tu as tout dit, ce tombeau vide où l’ombre portée de la croix que ton corps a brûlée de son passage laisse résonner sur notre terre l’espérance folle d’une promesse chaque jour redonnée.
En toutes choses te chercher, en toutes choses te désirer, en toutes choses t’espérer. C’est sans fin. C’est aujourd’hui. Ce sera demain, puis après-demain, et après après-demain. C’est toujours maintenant, jusqu’à la fin.
Gérard BAILHACHE
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup... »
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement » (Exercices spirituels, n° 2).
Ce pourrait être un conseil de sagesse spirituelle un peu critique visà- vis des savoirs. Trop de connaissance appesantit l’âme comme un repas trop riche alourdit le corps et par conséquent l’esprit. L’opposition est fréquente, et facile, entre ces deux pôles que sont le savoir et le sentiment, la connaissance extérieure et l’expérience intérieure, l’objectivité de la science et la subjectivité du ressenti. Dans l’accès à Dieu, ou bien on privilégiera une théologie rationnelle, voie austère — mais ô combien « sûre » — qui évite les pièges de l’émotionnel toujours incontrôlable (le dogme régule vigoureusement les embardées du sentiment religieux) ; ou bien, on fera appel à l’intuition spirituelle immédiate de l’ignorant pour contrecarrer les pseudo-savoirs des « sages et des savants ». Combien n’a-t-on pas entendu de propos de piété s’efforçant de rejoindre l’intime de l’âme en court-circuitant les longues médiations de l’intelligence !
Le chemin d’Ignace, qui s’adresse à tout l’homme, conjoint les deux. L’intelligence n’est pas négligée. Elle est un moyen indispensable de discernement. Dans le paragraphe où se trouve notre citation en exergue, la réflexion propre du retraitant est prise en compte. Elle s’appuie sur un savoir : le « fondement véritable de l’histoire ». Sans ce minimum de connaissance objective, la méditation resterait flottante, dépourvue de base.
Mais cette voie se garde bien de survaloriser le savoir. Elle est consciente du danger de fondamentalisme qui se cache dans toute volonté de connaître. Savoir avec certitude, agripper le fondement et ne pas le lâcher. La volonté de maîtrise fait obstacle à la rencontre de Dieu. Le savoir n’a pas de valeur s’il n’entre pas en résonance avec une expérience. « Goûter », sentir par le goût, se dit en latin sapere, dont le substantif sapientia a donné en français « sagesse ». La sagesse est une question de goût, au moins autant que de raisonnement.
Quelle est la part du savoir, et de la science qui le met en ordre, dans l’accès à Dieu ? Elle n’est pas négligeable. Dans certains cas, elle peut fournir un bon point de départ. Mais la connaissance devient un obstacle si elle ne s’accorde pas avec l’expérience intime du sujet dans son irréductible singularité. Le savoir objectif, toujours un peu contraignant, doit résonner avec la liberté de l’homme.
François EUVÉ
Deux sentences paradoxales où Dieu se dit dans l’action
« Être aux dimensions du plus vaste, mais se tenir au plus particulier, c’est chose divine » (jésuite anonyme, 1640). « Que la première règle de l’agir soit de se fier à Dieu comme si le succès ne dépendait que de toi, et en rien de Dieu, et cependant d’y mettre tout ton labeur comme si Dieu allait tout faire et toi rien » (sentence attribuée au jésuite Gabriel Hevenesi, 1705).
L’agir humain est le siège d’une mystérieuse rencontre entre la liberté humaine et la grâce divine. Bien des générations ont médité sur ce sujet — ô combien polémique — pour tenter de percevoir la part de l’un et de l’autre, souvent hélas en croyant que ce qui était attribué à Dieu devait être retiré à l’homme, et inversement. Ces deux perles de la tradition ignatienne, ces sentences de sagesse aux allures paradoxales, indiquent au contraire combien l’action révèle et Dieu et l’homme, dans un mouvement commun.
La première sentence semble sortie tout droit d’une plaquette conçue par une ONG en vue de la défense de l’environnement : elle évoque pour nous (trois cent cinquante ans en avance cependant !) la désormais fameuse devise : « Penser globalement, agir localement. » Dans l’esprit du jésuite du XVIIe siècle qui a écrit cette phrase, point n’était question de défense de la nature, sans doute ; et pourtant, il s’agit bien de la Création. Être aux dimensions du plus vaste ne peut manquer d’évoquer la manière dont Dieu, contemplant le genre humain et toute la Création, décide d’envoyer son Fils pour les sauver (cf. Exercices spirituels, n° 101-109). En même temps, se tenir au plus particulier, c’est dire la manière dont Dieu choisit les moyens de ce salut : Jésus va prendre chair d’une femme d’Israël, nommée Marie, dans un village du nom de Nazareth, en Galilée. La petitesse du point d’arrivée — un petit village —, la modestie des moyens — une femme simple qui donne naissance à un enfant — contrastent avec l’ampleur du projet, le plus vaste qu’on puisse imaginer. Ce coup de zoom depuis la sphère céleste jusqu’au point minuscule de Galilée indique la folie de l’incarnation ! Et de cette contemplation, l’homme formé aux Exercices spirituels en tire une attitude pour sa propre action. Si tu veux faire de grandes choses, commence par oser choisir un lieu où ce vouloir puisse s’exprimer. C’est la vérité de ton désir qui en sera éprouvée. Mais aussi, à l’inverse, laisse-toi instruire par le plus particulier, de sorte que ton regard en soit changé, ouvert à plus large, et qu’une profondeur encore inconnue sourde du plus banal de tes gestes, de la plus anodine de tes rencontres. C’est « chose divine », nous dit la sentence. À la fois une chose qu’on ne peut se donner soi-même, qu’on ne peut que recevoir, et un lieu d’authentification de l’orientation de notre vouloir. Comme le dit avec humour Raymond Devos : « Dieu, l’imaginaire, ça le dépasse. » Il n’est pas dans l’imaginaire, irréel. Il n’est pas non plus enfermé dans le particulier, mais Il est ce qui toujours le déborde de l’intérieur.
La deuxième sentence est apparemment très différente et pourtant elle joue, elle aussi, sur des paradoxes. Double paradoxe à vrai dire. Pendant des années, cette phrase a été écrite d’une manière qui pouvait paraître plus compréhensible : « Que la première règle de ton agir soit de te fier à Dieu comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi, et cependant d’y mettre tout ton labeur comme si tu allais tout faire et Dieu rien. » En l’état, la phrase était déjà assez étonnante : dans l’action, il s’agit à la fois de faire confiance à Dieu et en même temps d’y mettre tout son soin. L’intérêt n’est pas négligeable de comprendre que se fier à Dieu de qui tout dépend ne signifie nullement laisser faire ou abandonner ses responsabilités propres mais au contraire les assumer pleinement. L’esprit humain est enclin à faire des soustractions là où il faudrait faire des multiplications. La liberté humaine n’est pas de cette sorte que l’influence de Dieu la retirerait à elle-même, mais ce qui de l’intérieur est suscité par ce qui est nommé « Dieu ». Et pourtant, la sentence nous emmène encore plus loin que cette découverte de la synergie des volontés, au-delà de ce stade où apparaît l’harmonie entre la confiance et le faire. Elle augmente le paradoxe.
Elle ne place pas seulement la tension entre le vouloir et l’action, la confiance et l’agir, mais à la jointure intérieure de chacune de ces opérations. Agir en ayant foi en Dieu comme si le succès ne dépendait que de soi et non de Dieu, n’est-ce pas indiquer une fissure de la foi elle-même qui en indique l’ouverture ? À l’endroit même où je fais confiance, je renonce à posséder cette confiance comme une chose, une propriété, une action qui soit mienne. La manière de s’en remettre à l’autre est alors de ne rien exiger de lui, de ne rien prendre de lui, de tout prendre sur soi, en attendant de la recevoir de lui. Il ne s’agit pas pour autant de reprendre la confiance mise en l’autre, mais précisément de laisser l’espace afin que l’autre soit reconnu pour lui-même dans sa liberté. « Dieu, qui peut le connaître ? », rappelle un psaume. Et un autre déclare : « Tes pensées sont au-dessus de mes pensées. » L’inverse vaut également : agir comme si tout dépendait de soi n’est pas s’en remettre à soi mais à un autre qui me constitue. « Tu es plus intime à moi-même que moi-même », écrit saint Augustin. La confiance est vécue comme une non-possession de l’action de l’autre. De même, le soin porté au labeur ne s’accompagne pas d’une appropriation du résultat : j’agis avec soin comme si Dieu allait tout faire, je fais confiance comme si tout dépendait de moi, sans rien exiger de l’autre. Ce double paradoxe indique une double dépossession : celle qui accompagne la confiance en l’autre et celle qui anticipe le résultat de mon travail. Foi et action sont tous deux habités de l’intérieur par une altérité qui les constitue. Il s’agit d’être « contemplatif dans l’action », disait Jérôme Nadal, un proche d’Ignace. Il faudrait ajouter : « actif dans la contemplation ». Mais que disent encore les mots « action » et « contemplation », à ce stade ?
Il est des moments où il nous est donné de ne plus savoir qui de nous ou de cet autre en nous est l’auteur de nos intuitions, de nos décisions, de nos actions. C’est l’instant où notre liberté se découvre elle-même comme une autre, et où le divin peut se laisser entrevoir.
Alain THOMASSET
« Que nous ayons toujours le sens de sa très sainte volonté »
« Que nous ayons toujours le sens de sa très sainte volonté et que nous l’accomplissions entièrement » (Ignace de Loyola, dans sa correspondance).
Des milliers de lettres attestent de la correspondance immense qu’Ignace a entretenue à travers le monde, à une époque de grande mutation où les repères traditionnels, y compris sur Dieu, étaient bouleversés. À travers ces lettres se dessinent les traits d’un Dieu à l’oeuvre dans l’histoire et les affaires humaines, un Dieu au travail pour nous — un Dieu qui « travaille et oeuvre pour nous dans toutes les choses créées sur la face de la terre » (Exercices spirituels, n° 236). Pendant les vingt ans que couvre sa correspondance, Ignace, le plus souvent, conclut ses lettres par la même formule, à quelques variantes près — une formule qu’il affectionne certainement, et qu’il ne reproduit sans doute pas par paresse ou par commodité, de Venise en 1536 jusqu’à Rome en 1556, à la fin de ses jours :
« Je le prie, par sa bonté infinie, de nous donner sa grâce parfaite pour que nous ayons toujours le sens de sa très sainte volonté et que nous l’accomplissions entièrement » (Venise, 12 février 1536). « Je supplie la divine bonté qu’elle nous donne à tous sa grâce parfaite pour que nous ayons toujours le sens de sa très sainte volonté et que nous l’accomplissions entièrement » (Rome, 3 janvier 1555). « Que le Christ notre Seigneur donne à tous sa grâce pour que nous ayons le sens de sa très sainte volonté et que nous l’accomplissions entièrement » (Rome, 3 septembre 1555).
Cette formule ne me laisse pas quitte. Au fil de la correspondance, naissent des questions. Quelle est cette « très sainte volonté » ? Que signifie « avoir le sens de sa volonté » ? Comment ce sens est-il « donné », par grâce ? Comment « l’accomplir entièrement » ?
Ignace, qui longtemps signa ses lettres en faisant suivre son prénom des mots « pauvre en bonté », s’en remet à la bonté infinie de celui dont il a appris que l’amour consiste en une communication réciproque. Au cours de son itinérance, il a découvert de façon décisive, pour lui et pour beaucoup, combien le désir de Dieu est de se donner, de se communiquer à nous autant qu’il est possible, en tout ce qui nous arrive. De volonté à volonté, c’est-à-dire en ce lieu de ma liberté où je peux me laisser atteindre, où je peux acquiescer à ce qui est ou me révolter contre le malheur et l’injustice, décider d’agir, prendre des initiatives : « Invente avec ton Dieu l’avenir qu’il te donne », chante l’hymne liturgique.
Voici que je commence alors à comprendre, dans les balbutiements et la joie du coeur, que faire la volonté de Dieu, ici et maintenant, c’est accueillir le don que Dieu fait de lui-même, et qui sont sa propre vie, son amour et sa lumière, plus forts que ma mort, mes enfermements et mes obscurités. C’est accueillir un amour plus grand, en m’en remettant à un autre. C’est agir en ce sens, dans la direction que cet amour dessine, en réponse à cet amour que j’apprends amoureusement à percevoir à l’oeuvre dans mon existence et celle d’autrui. « Vous êtes ressuscités avec le Christ, dit l’apôtre Paul aux chrétiens de Colosse. Recherchez les choses d’en haut. C’est là qu’est le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d’en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. » Car là où est ton trésor, là est ton coeur, dit Jésus.
Paul LEGAVRE