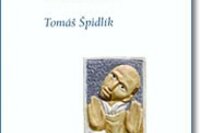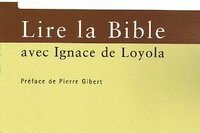Il y a cinquante ans, le 9 juin 1972, fête du Sacré-Cœur de Jésus, le père Pedro Arrupe célébrait la messe avec cent soixante jésuites dans l'église du Gesù à Rome et, en présence de cette assemblée, il renouvela la consécration de la Compagnie de Jésus au Sacré-Cœur faite un siècle auparavant. En 1980, il publiait plusieurs méditations et homélies sur le même sujet, préfacées par le théologien jésuite Karl Rahner, qui devaient faire date1. En actualisant « une dévotion pour notre temps », il préparait en quelque sorte le voyage du pape Jean Paul II à Paray-le-Monial en 1986 et la canonisation de Claude La Colombière en 1992.
Ces événements ont suscité de solides études et une nouvelle vitalité du sanctuaire de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Ils soulignaient aussi le charisme de celui qui fut le directeur spirituel de sainte Marguerite-Marie Alacoque. Comment donc le message de Paray-le-Monial, le munus suavissimus, comme l'évoque la Compagnie de Jésus, révélé à une humble religieuse et confié à la Compagnie après la mort même de Claude, a-t-il pu devenir public et se répandre dans l'Église universelle ? Et comment le père La Colombière avait-il accompagné sœur Marguerite-Marie au long de ses visions et révélations, devant lesquelles directeurs et supérieurs restaient très réticents, jusqu'à la confirmer dans l'authenticité des apparitions par de solides conseils ? « Je t'enverrai mon fidèle serviteur et parfait ami », lui avait dit Jésus.
Si nous ne connaissons pas le charisme d'accompagnement du père Claude par une correspondance que sœur Marguerite-Marie a soigneusement brûlée, nous gardons de lui un lot de cent cinquante lettres adressées à des laïcs et des religieuses, qui permettent d'apprécier sa manière de faire et son respect du travail de l'Esprit saint en chacun2.
Les extraits suivants, qui concernent la pratique de la prière, présentés et classés par un étudiant en théologie mexicain à Rome, le père Pedro José Hernandez O'Hagan, à qui nous sommes redevables de ce travail, permettront aux personnes en charge d'accompagnement de comparer leurs pratiques, et aux personnes accompagnées d'y trouver inspiration. On ne s'étonnera pas d'un style grand siècle, qui n'en perd pas pour autant, bien au contraire, sa clarté et ses nuances.
Voici, pour introduire cet article, comment le « parfait ami » s'adressait à Jésus comme à son « véritable ami » :
Au souvenir des révélations qu'il avait reçu mission de propager, le père La Colombière écrivait : « Que ferez-vous donc, Seigneur, pour vaincre une si grande dureté ?... Il faut que vous nous donniez un autre cœur, un cœur tendre, un cœur qui ne soit ni de marbre, ni de bronze ; il faut donner votre Cœur même. Venez, aimable Cœur de Jésus, venez vous placer au milieu de ma poitrine et allumez-y un amour qui réponde, s'il est possible, aux obligations que j'ai d'aimer3. »
Le père La Colombière ressentait « un attrait pour la prière » et avait demandé « de tout cœur à Dieu, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie », que lui soit accordée la grâce d'aimer chaque jour davantage l'exercice de la prière. Il le considérait comme l'unique moyen de nous purifier et de nous unir à Dieu, comme le « moyen nécessaire pour acquérir les vertus et les rendre utiles au prochain ». Une fois où une sœur du monastère de Paray-le-Monial avait demandé la permission de ne pas faire oraison en raison de sa maladie, le saint, consterné, lui écrivit, laissant un témoignage de l'appréciation si haute qu'il avait de la pratique de la prière.
Dans les lettres du père La Colombière, nous trouvons d'innombrables conseils pour aider à la prière. L'idée de se laisser guider par l'Esprit et non par ses propres schémas apparaît constamment. Le père La Colombière écrit en ce sens de Londres à l'une de ses dirigées : « Il est bon ou de lire un sujet, ou de se déterminer à quoi l'on veut s'occuper durant l'oraison ; mais si, après cela, l'on se sent attiré à un autre sujet, il ne faut faire nul effort pour s'arrêter à ce qu'on a préparé5. »
Tous les thèmes de prière sont bons mais, surtout si l'on trouve un sujet qui nous plaise et si l'on ressent du goût et du profit à le méditer, alors il faut le prendre comme sujet de prière. À ce propos, il écrit à Marie Mayneaud : « Toutes les fois que vous êtes remplie de quelques sentiments extraordinaires, soit de reconnaissance, soit d'amour de Dieu, soit d'admiration pour ses bontés, soit de désir de lui plaire, soit de mépris pour les choses de la terre, soit enfin de sa présence, il faut en faire le sujet de vos oraisons et vous y occuper à goûter et à fortifier ces sentiments6. » Quand une personne a trouvé du goût au thème de son oraison, elle doit y demeurer aussi longtemps qu'elle se sent mue par ces sentiments et ne pas passer à un autre point, tant que le cœur ne s'est pas vidé de toute bonne pensée.
Faut-il ressentir de la ferveur pendant l'oraison ? Pour saint Claude, l'esprit de Dieu porte à la ferveur ; mais la ferveur qu'il inspire ne produit pas de trouble, ne crée de désordre ni en nous, ni chez les autres ; et, devant les obstacles, on sait s'arrêter et se soumettre avec patience à la volonté de Dieu. Une profonde et sincère humilité est plus agréable aux yeux de Dieu pour se rapprocher de lui qu'un désir exagérément fort de prier avec une ferveur sensible. Il ne s'agit pas de prier froidement mais de savoir « qu'il est nécessaire d'aimer Dieu seul, de tout son cœur, et de se contenter de sa croix comme unique preuve d'amour », qu'il y ait ou non de ferveur sensible.
Saint Claude ne demandait pas de douceurs dans sa prière, il considérait n'en être pas digne et ne les trouvait pas bonnes pour lui. Recevoir des grâces extraordinaires aurait été pour lui comme « verser une liqueur exquise dans un vase fêlé qui ne pourrait rien retenir ». Ce pourquoi, dans ses exercices spirituels, il demandait à Dieu « une prière solide, humble, qui le glorifie Lui et ne m'enfle pas moi » car il redoutait l'orgueil et pensait que « la sécheresse et la désolation, accompagnées de la grâce de Dieu » lui étaient beaucoup plus utiles. Si le père La Colombière ne demandait pas de douceurs dans sa prière, il conseillait à une religieuse de les accueillir, si cela devait se faire, comme un don de Dieu : « Il n'est point nécessaire de renoncer actuellement aux douceurs que vous sentez à l'oraison : il suffit de ne pas y avoir attache et d'être disposée à vous en passer […] avec beaucoup de simplicité et de confiance en la miséricorde de Dieu, et puis recevoir indifféremment tout ce qui vient de sa main sans tant de réflexions7. »
Il est courant que, dans l'oraison, apparaissent des distractions involontaires ; le père La Colombière suggérait de les supporter toujours avec patience, car elles font partie du dégoût et de la fatigue que produisent les exercices spirituels. Pour lui, une âme qui ne pourrait souffrir ces divagations de l'esprit ne voudrait pas se mortifier et ne désirerait que les consolations sensibles. Une telle âme, d'après saint Claude, est remplie d'amour-propre. C'est en ce sens qu'il écrivait à une religieuse qui se plaignait de ses distractions pendant l'oraison : « Ma bonne sœur, quand vous seriez ravie en extase vingt-quatre fois le jour et que j'aurais vingt-quatre distractions en récitant un Ave Maria, si j'étais aussi humble et aussi mortifié que vous, je ne voudrais pas changer mes distractions involontaires pour toutes vos extases sans mérite8. » Le saint montrait par là qu'il n'y a pas de véritable dévotion là où il n'y a pas de mortification, et il invitait à se faire une perpétuelle violence, intérieurement surtout, et à ne jamais tolérer que la nature prenne le dessus, ni que le cœur ne s'attache à aucune créature. Lorsque l'on s'inquiète dans l'oraison parce que le temps semble s'étirer et que l'on a hâte de passer à une autre occupation, Claude La Colombière conseille de se poser la question : « Eh bien, mon âme ! Tu t'ennuies avec ton Dieu ? Tu n'es pas contente en lui ? Tu le possèdes et tu cherches autre chose ? Où trouveras-tu mieux que sa compagnie ? D'où pourras-tu tirer meilleur profit9 ? » Saint Claude assure que ces remarques calment l'esprit et unissent à Dieu.
On ne peut passer sous silence dans la spiritualité du père La Colombière l'exercice qui consiste à considérer la présence de Dieu en tout lieu et à tout moment. Voyons comment lui-même le décrit pendant sa retraite à Lyon :
Saint Claude écrit avec tant d'enthousiasme au sujet de la pratique de la présence de Dieu qu'il raconte qu'il pourrait passer des heures sans se fatiguer ni s'épuiser à considérer Dieu autour de lui et en lui, qui le soutient et l'aide, en le louant pour ses miséricordes et en nourrissant des sentiments de confiance, avec le désir d'être à Lui sans réserve.
Pour saint Claude, l'exercice de la présence de Dieu est d'une admirable utilité et la recommandation de cette pratique abonde dans ses écrits. À une dirigée, il écrivait de Londres : « Mademoiselle, [...] je suis surpris que, pour vous mettre en la présence de Dieu, vous vous ressouveniez qu'il vous voit du ciel, comme si vous aviez oublié qu'il n'est pas plus réellement dans le ciel que dans le lieu où vous priez, et même dans votre cœur où il habite, invisiblement à la vérité, mais avec autant de réalité que Jésus Christ est dans le Saint Sacrement de l'autel. Le ciel est donc partout pour vous puisque tous les lieux sont remplis de votre Dieu, et que vous en êtes emplie vous-même10. »
À certaines personnes, il n'offre que ceci comme matière à oraison : « En ce qui concerne la prière, ne craignez pas de vous tenir en présence de Dieu ; quand bien même vous ne feriez rien d'autre, n'en doutez pas, vous emploieriez bien votre temps. » Et, en une autre occasion : « C'est une grande illusion de se charger de nombreuses pratiques de dévotion. Il faut lire peu de livres et étudier beaucoup Jésus Christ crucifié. Réduisez-vous la méditation au soin de vous tenir en la présence de Dieu et de vous vaincre en toutes choses11 ? »
La Divine Présence se rend particulièrement perceptible pour Claude dans le prochain, comme il le décrit dans ses notes spirituelles de 1675 : « Dieu est en nos frères et veut être servi en eux, aimé et honoré, et il nous en récompensera plus que si nous le servions lui-même en personne […]. Que chacun considère le Christ en son frère. » Mais il perçoit surtout la présence de Dieu dans l'eucharistie.
Quand le père La Colombière décrit dans son offrande la grandeur de l'amour du Cœur de Jésus, il se lamente tristement de ce qu'un tel amour « ne rencontre dans le cœur des hommes que dureté, oubli, mépris et ingratitude ». Cette attitude qui consiste à oublier les grâces de Dieu trouve sa contrepartie positive dans l'oubli de soi qui conduit au souvenir de Dieu, c'est-à-dire à l'intérieur du Cœur de Jésus. Il s'agit de laisser de côté les préoccupations de soi-même pour laisser de l'espace à l'amour du Cœur de Jésus. Thème que reprendra l'Acte d'offrande : « Sacré Cœur de Jésus Christ, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par laquelle on peut entrer en vous... »
Écrivant à une religieuse anglaise, saint Claude conseillait l'oubli de soi de la manière suivante : « Je crains seulement que vous n'ayez la vue un peu ou trop attachée sur vous. Il me semble qu'il serait bon de s'oublier quelquefois et de ne songer à ses misères qu'autant qu'elles nous font connaître l'immense miséricorde de Dieu envers nous12. » Cette pratique est de grand profit et saint Claude pousse sa correspondante, dans une autre lettre, à ne pas perdre de temps à chercher son propre agrément : « C'est un grand malheur de nous amuser à tout ce qui peut nous plaire ici-bas, pouvant employer notre temps et notre esprit à nous sanctifier par la pratique de l'humilité et du détachement entier de nous-mêmes13. »
Saint Claude insiste sans relâche sur ce thème dans ses lettres : « Les retours sur vous-même ne sont nullement nécessités. Plût à Dieu que nous fussions si occupés de la pensée et de l'amour de notre Bon Maître que nous nous oubliassions entièrement14. » Durant la seconde retraite spirituelle de Londres, en 1677, il le décrit avec encore plus de clarté : « On ne rencontre la paix que dans le total oubli de soi-même. Il est nécessaire que nous nous résolvions à oublier jusqu'à nos intérêts spirituels, pour ne rien chercher d'autre que la gloire de Dieu. »
Pour saint Claude, le pire mal qui puisse arriver à une créature est de se défier de la bonté de Dieu... « Quand on peut se défendre de ce mal, qui est de désespérer de la bonté de Dieu, il n'en est point qu'on ne puisse tourner en bien et dont il ne soit aisé de tirer de grands avantages15. » Quand bien même on aurait commis de nombreuses fautes, on peut en tirer bénéfice en les confiant au pardon de Dieu.
On rencontre peu de gronderies dans ses lettres ; cependant, lorsqu'il trouve dans l'une des âmes qu'il dirige quelque chose de la défiance ou de l'inquiétude désespérée, il agit avec la ferme sévérité d'un père qui ne peut tolérer de telles fautes, pour le bien de ses enfants. Ainsi, à une âme éprouvée, tentée de désespérer, il écrit avec rigueur : « Vous appréhendez que Dieu ne vous mette à des épreuves que vous ne pourriez pas soutenir ; c'est une pensée qui vous passe par l'esprit, car si je croyais que ce fût votre sentiment, je ne vous pardonnerais pas cette défiance et l'outrage que vous feriez à la sagesse et à la bonté de notre Seigneur. » Mais, pour ne pas laisser l'âme abattue, sa semonce se termine par une ferme et douce exhortation à la confiance : « C'est lui principalement qui, à nos péchés près, fait tout en nous ; et il ne faut avoir égard ni à nos fautes, ni à notre faiblesse, mais tout attendre de lui seul16. » À la même personne qui semblait faire diverses fautes de défiance, il écrira de nouveau, quelques mois plus tard, avec le même ton sévère et doux : « Je vous avoue que je ne puis pardonner un moment d'inquiétude à une servante de Jésus Christ. Cela fait un très grand tort à votre Bon Maître qui souffre, qui conserve, qui comble de biens ses plus grands ennemis ; jugez s'il voudrait perdre ceux qui ne songent qu'à le servir… Songer à Dieu et remettez-lui tout le soin de vos affaires17. »
En s'inspirant des règles du discernement des esprits de saint Ignace de Loyola, saint Claude écrit à Marie Mayneaud pour la prévenir du danger qu'il y a pour elle à se laisser entraîner par les inquiétudes et fausses raisons du mauvais esprit. La destinataire de la lettre avait peut-être commis quelque faute grave et se sentait fortement tentée par l'inquiétude. Voyons par quelles paroles saint Claude la tranquillise :
Dans les écrits de saint Claude, il est à noter que l'invitation à la confiance s'adresse tout particulièrement aux pécheurs. Ce sont eux qui doivent le plus espérer le pardon de la miséricorde de Dieu. Saint Claude conseille en ces termes une pénitente, en faisant revenir à la mémoire l'« heureuse faute » de l'Exultet pascal : « Vous ne vous tromperez pas tant que vous espérerez beaucoup en lui qui sait tout et qui sait tirer profit de nos fautes mêmes19. » Le père Claude avait réfléchi à ses propres péchés comme matière à glorifier la miséricorde de Dieu : « À la vue de mes péchés et après la confusion que j'en ai ressentie, il m'est ensuite venu la douce pensée qu'à la vérité, il y a en eux un matériau très propre à exercer la miséricorde de Dieu et une très ferme espérance qu'en me pardonnant, il sera glorifié20. »
Nous savons par divers témoignages que le père La Colombière traitait avec grande douceur les pécheurs pendant la confession. Comme un bon berger, il pacifiait les consciences bouleversées, puisque « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout » (1 Jn 3, 20).
Dans la lettre qui suit, il inspire de fermes sentiments de confiance à une religieuse affligée par ses péchés. La richesse de son contenu est telle, et les éléments de la confiance en la miséricorde infinie de Dieu y sont si nombreux, que nous avons jugé plus profitable de la présenter ici presque en entier :
On trouve dans cette lettre les mêmes accents que dans l'Acte de confiance, tiré de la finale du sermon sur le même thème : « Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes... »
***
Il semblerait que, pour saint Claude, la ferme espérance du chrétien doive se traduire par une attitude d'abandon à la Divine Providence. En regardant ses écrits, on est frappé de ce que les deux notions – la confiance et l'abandon à la Divine Providence – sont en intime relation, comme deux reflets de la grâce si éblouissants qu'ils sont difficiles à distinguer l'un de l'autre et que, dans l'âme du chrétien, elles doivent s'enrichir mutuellement pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ainsi que le pressentait saint Claude, dans une résolution qu'il prit le jour de la fête de l'Immaculée Conception de 1674, et dans laquelle se manifestent sa foi constante dans la présence de Dieu et son propos de s'abandonner totalement à lui, au-delà même de ses attachements familiaux :
Le renoncement à sa propre volonté va de pair avec l'abandon à la Providence : ils font partie de notre obéissance chrétienne à nous détacher de notre propre jugement pour accepter humblement les desseins divins. C'est ce que désire saint Claude alors que lui-même se trouve gravement atteint par la maladie qui le mènera à la mort. Il écrit ceci à mère Saumaise, supérieure des Visitandines de Paray-le-Monial : « Je ne puis ni écrire, ni parler, ni presque prier... Priez Dieu pour moi afin que je ne désire rien que sa volonté et que je m'abandonne sans réserve à sa Providence23. » Dans l'une des dernières lettres du saint, nous trouvons encore le conseil de cet abandon à la douce providence du Père, d'où doit jaillir la tranquillité de l'âme : « J'ai souvent conseillé de demeurer tranquille et de ne songer qu'à servir Dieu chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie […]. Ne songeons donc plus à rien qu'à nous abandonner à la Providence de notre bon Père et à vivre au jour la journée. »
NOTES :
2 Les textes cités dans cet article proviennent des archives de la Compagnie de Jésus. Certains ont été publiés dans Claude La Colombière, Écrits spirituels, Desclée de Brouwer, « Christus », n° 9, 1962, et Lettres, Desclée de Brouwer, « Christus », n° 79, 1992. Les chiffres en caractères romains correspondent à la numérotation des lettres de La Colombière.
3 « Sermon pour le jour du Corps de Dieu ».
4 Lettre LXXI.
5 Lettre CXXXVII.
6 Lettre CXX.
7 Lettre XXXII.
8 Lettre LXXIV.
9 Notes spirituelles, 1674.
10 Lettre CXVIII.
11 Lettre C.
12 Lettre XC.
13 Lettre XV.
14 Lettre CXVIII.
15 Lettre XXII.
16 Lettre CXVI.
17 Lettre CXVII.
18 Lettre CXIX.
19 Lettre LXXXIII.
20 Retraite de Lyon (1674).
21 Lettre XCVI.
22 Notes spirituelles, 1674.
23 Lettre XLI.