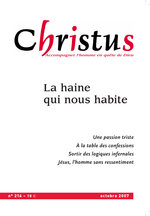Il est difficile de parler du pardon. Car il ne s’argumente pas. Je veux dire qu’il ne se déduit d’aucun raisonnement logique. Il n’a aucune raison.
Si le pardon obéit à l’amour, il n’implique jamais pour autant l’abolition de la loi et de la justice 1. Au contraire, si les bras qui s’ouvrent pour nous accueillir à nouveau sur le chemin du droit et de la justice sont ceux de l’Amour, c’est afin de nous remettre à l’école de la vérité de la vie là où nous avons été entraînés dans les sinuosités du mensonge et de la mort.
Le sentiment de culpabilité
Entraîné dans cette voie, l’homme va jusqu’à croire qu’il est l’auteur, voire l’origine de l’amour. Comme il le dit, il se « construit » lui-même une vie ou il « fait » l’amour pour s’assurer de « sa » puissance. S’il n’a plus ce sentiment de puissance, voire de toute-puissance, il se sent abandonné et douloureusement incapable d’aimer. Lorsqu’il n’est plus sous l’emprise plus ou moins consciente de sa volonté propre, il se sent impuissant à se donner. Sauf à faire semblant, bien sûr. Mais alors, plus il éprouve cette impuissance avec force, plus il aliène sa vie à sa propre image et se détourne de Dieu. Le sentiment qu’il a de ce qui se passe en lui ne l’autorise plus à discerner les esprits. Dans une telle voie, le « manque à être » que l’homme ressent ne l’ouvre pas à l’Autre ou à son absence, mais au fait qu’il ne peut plus exercer sa puissance. L’homme découvre qu’il ne cherchait pas l’Autre qui est la source de son désir. Il tente seulement de transformer le don de la vie, l’amour, en un avoir dont il pourrait disposer à sa guise dans un passage à l’acte immédiat pour son plaisir. Ce qui contrarie cette pulsion à prendre et à posséder (avec les yeux,