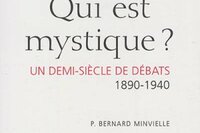«Le démon de mon coeur s’appelle : À quoi bon ? » Sous la plume de Bernanos, au moment où il entame Les Grands cimetières sous la lune, terrible réquisitoire contre la répression franquiste et l’agenouillement de l’épiscopat espagnol, l’aveu surprend. Tenté par le découragement, lui, l’indomptable, qui aura mené tant de combats contre la bêtise et la veulerie humaines ? Les familiers de son oeuvre savent jusqu’où a pu aller, chez lui, la tentation de rendre les armes devant les difficultés du métier d’écrivain et d’abord du métier d’homme.
Son exemple – sa foi – nous encourage. Sans avoir, peut-être, frôlé les mêmes abîmes que lui, nous connaissons trop bien l’affreuse tristesse qui peut nous étreindre au spectacle de nos défaites. Grands ou petits combats, nos luttes contre nous-mêmes ou contre l’entêtement de la réalité peuvent se conclure par un : « Je n’y arriverai jamais ! », ou : « Ce n’est même pas la peine d’essayer », ou : « Après tout, qu’ils se débrouillent sans moi ! », qui, à la longue, enfoncent dans le désespoir.
Bernanos aurait beaucoup à nous apprendre. Mais ce n’est pas à lui que nous demanderons ici des leçons de vie. Sa stature pourrait nous intimider. La littérature spirituelle chrétienne, en revanche, nous met en confiance. Elle abonde en récits d’expérience et en conseils de sagesse propres à nous remettre en selle.
Découragement et désespoir
Forme banale de réaction devant des échecs, le découragement peut conduire au désespoir, mais il n’est pas le désespoir. Le désespoir, la désespérance, c’est la terrible nuit où se voit enfermé celui qui ne peut plus croire à rien, sauf au néant de tout. Ruine de la deuxième vertu théologale, qui rend impossible le moindre acte de foi ou de charité. Il ne reste plus qu’à tirer le rideau sur la mauvaise farce de l’existence. À l’époque moderne, des romanciers comme Dostoïevski ou Albert Camus ont suggéré la dimension métaphysique du désespoir 1. Bernanos a souligné sa dimension spirituelle. Le héros de Sous le soleil de Satan, l’abbé Donissan, connaît – c’est le titre de la première partie du roman – « la tentation du désespoir ».
C’est que les grands spirituels eux-mêmes ont été en première ligne dans le combat contre le désespoir. Jean de la Croix, dans la Nuit obscure, évoque l’atroce vertige qui peut saisir l’âme au bord du vide où tout s’est englouti, lorsqu’au terme de toutes les épreuves et de tous les renoncements, il ne reste apparemment que nada, nada, nada ! Ce vertige nihiliste, Ignace de Loyola l’a connu dans la grotte de Manrèse, pendant l’année d’érémitisme et de saintes folies pour le Christ qui a suivi sa conversion. Alors qu’il était ravagé par les scrupules et les doutes sur la validité de ses interminables confessions, et donc sur son salut, « lui venaient bien souvent des tentations, avec grande violence, de se jeter par un grand trou qu’il y avait dans sa chambre et qui se trouvait tout à côté du lieu où il faisait oraison » 2.
Aux siècles « mystiques », en effet, que furent le XVIe et le XVIIe, la tentation du désespoir se nourrissait de la conviction d’être damné. Que l’on fût luthérien ou non, la conscience chrétienne était alors ravagée par l’angoisse de la prédestination et l’incertitude sur son salut. Dès lors qu’apparaissaient à l’individu des preuves tant soit peu appuyées de sa corruption par le péché originel, la certitude s’installait dans son coeur : « Je suis damné ! » Lorsque le sujet était un saint, il en fallait peu pour que l’extrême délicatesse de l’âme s’offusquât des ombres qu’elle constatait en elle. Croira-t-on que saint François de Sales lui-même, cet homme d’un équilibre psychologique exceptionnel, n’a pas été épargné ? S’il n’en a rien écrit, les témoignages de quelques proches, lors du procès de béatification, l’attestent. À l’âge de dix-neuf ans, alors qu’il étudiait la théologie à Paris et qu’il venait de suivre un cours sur la prédestination, il fut convaincu que, faute d’une parfaite chasteté dans ses pensées, il ne pouvait être que damné. L’effondrement et la torture morale durèrent six semaines. Son précepteur, épouvanté, crut qu’il allait mourir, tant son dépérissement était visible. La libération vint, dans la chapelle de la Vierge de l’église Saint-Étienne-des-Grès, d’un acte de totale remise de soi à la volonté de Dieu, allant jusqu’à accepter l’enfer « si Dieu devait être plus honoré en sa condamnation qu’en son salut » – acte qu’il ratifia en disant la prière Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie… La chape de plomb tomba alors de ses épaules : « Il se sentit tout en un moment accoisé [apaisé] en son coeur et affranchi d’une si cruelle et fâcheuse tentation, laquelle il ne ressentit jamais plus » 3.
Soixante ans plus tard, le même acte de confiance et d’abandon à la volonté de Dieu, fût-elle volonté de damnation, et la même grâce de pacification arrachèrent définitivement le jésuite Jean-Joseph Surin à la nuit mentale et spirituelle où l’avait plongé, plus de quinze ans durant, sa conviction d’être damné. Il avait imprudemment offert à Dieu son salut éternel en échange de celui de Jeanne des Anges, la religieuse possédée. La délivrance de celle-ci l’avait convaincu que Dieu l’avait pris au mot. À la suite de son acte d’abandon, la paix qui lui fut donnée, vingt ans plus tard, fut telle, écrit-il, « que jamais plus le désespoir n’a pu dominer en mon intérieur, et ce fut là le dernier coup que l’ennemi porta sur mon âme. Je n’y suis jamais retombé depuis car, quoi qu’il ne laisse pas, de temps en temps, de friser mes terres et faire encore des efforts pour attaquer mes bastions, jamais pourtant je n’ai, depuis ce jour-là, senti aucune impression pénétrante de ce cruel ennemi du coeur humain et Notre Seigneur m’a fait la grâce de me tenir toujours un peu éloignant de moi la défiance et le désespoir » 4.
Ce sont là, dira-t-on, grandes épreuves de croyants d’exception, dans des univers mentaux et des problématiques théologiques bien éloignées des nôtres. Il ne serait pas difficile, pourtant, d’en découvrir de modernes analogues, pas seulement chez Thérèse de Lisieux : pour avoir été la première sainte à en faire état, elle n’est plus la seule désormais à être affectée par l’apparent effacement de Dieu dans sa vie, pendant ses dix-huit derniers mois, et l’effondrement des croyances traditionnelles dans nos sociétés. Pour beaucoup, aujourd’hui, le ciel est vide ou réservé à d’autres, jugés moins lucides.
Ce sont là, dira-t-on, grandes épreuves de croyants d’exception, dans des univers mentaux et des problématiques théologiques bien éloignées des nôtres. Il ne serait pas difficile, pourtant, d’en découvrir de modernes analogues, pas seulement chez Thérèse de Lisieux : pour avoir été la première sainte à en faire état, elle n’est plus la seule désormais à être affectée par l’apparent effacement de Dieu dans sa vie, pendant ses dix-huit derniers mois, et l’effondrement des croyances traditionnelles dans nos sociétés. Pour beaucoup, aujourd’hui, le ciel est vide ou réservé à d’autres, jugés moins lucides.
Mais ce n’est pas la tentation du désespoir ou du nihilisme qui doit nous retenir ici. Ce n’est pas non plus l’épreuve de la désolation spirituelle. Épreuve normale, fréquente chez qui a entrepris de mener une vie spirituelle, elle fait partie, comme la sécheresse et la consolation, des « signes » qui composent le langage commun à Dieu et à l’homme. À la fois plus violente et moins sournoise que le découragement, elle est plus facilement identifiable quant à ses manifestations et ses causes, et donc « traitable », comme l’explique saint Ignace dans ses « Règles pour le discernement des esprits » (Exercices spirituels, n° 328-336).
Le découragement n’est pas non plus l’acédie, ce dégoût radical de la vie qui, selon les Pères du désert, menace le moine au mitan de son existence (« démon de midi »). L’acédie était, chez Évagre et Cassien, le sixième des huit vices principaux qui guettent le moine 5. Elle disparaît de la liste des sept péchés capitaux établie par saint Grégoire (604), qui l’assimile à la tristesse. Mal métaphysique et maladie de l’âme, l’acédie sera plus tard assimilée à la mélancolie et dès lors « médicalisée » (neurasthénie) 6.
Si l’on cherche une définition simple et générale du découragement, on dira qu’il consiste en une attitude de défaitisme, une tentation d’abandon à la suite d’un échec ou d’une succession d’échecs. Le découragement, en effet, suppose que le sujet se soit assigné un objectif, un but à atteindre. Ce but se révélant hors d’atteinte, le sujet « perd coeur », il perd courage. Le siège du courage, l’étymologie l’indique, est en effet le « coeur ». Pour les Anciens déjà, le coeur était non seulement le siège de la vie mais aussi, métaphoriquement, le siège des affects (émotions, sentiments), celui de la « volonté » en tant que capacité d’être affecté, donc de désirer et d’aimer et, par conséquent, de vouloir, de se décider. Lorsque nos efforts se révèlent vains ou que le sort semble s’acharner contre nos désirs ou nos projets, la tentation de la démission, celle de tout envoyer promener et de se réfugier dans l’indifférence égoïste, n’est pas loin. Dans cet état d’« àquoibonisme », on peut être alors la proie de l’apathie, de l’aboulie, de la tristesse, ou, au contraire, on se jette dans la fuite en avant ou la recherche de dérivatifs compensateurs. L’image de soi peut être gravement compromise : je suis nul, je suis un raté. À terme, le désespoir, un désespoir psychologique, guette.
Grands et petits découragements
Il est bien des occasions et des formes de découragement. Les plus immédiatement choquantes sont celles que peut engendrer un accident ou un mauvais coup du sort : un cancer qui récidive, une recherche d’emploi qui n’en finit pas d’aboutir, un éclatement familial… Spectaculaires ou tristement ordinaires, souvent dramatiques, les occasions de baisser les bras et de se laisser aller, pour beaucoup de nos contemporains, sont quotidiennes. La proportion de Français qui redoutent plus que tout, et comme une éventualité plausible, de finir à la rue est impressionnante, une enquête vient de le montrer.
Dans ce genre de situations où le découragement peut être fatal, c’est à son entourage que la personne accablée peut devoir son salut. Beaucoup dépend, chez les proches, de leur capacité de présence ; capacité aussi de parler sans trop de peur avec la personne accablée par la situation qui l’obsède ; capacité enfin de donner l’aide ou le petit coup de pouce matériel qui, à la longue, pourra aider à refaire surface. Il y faut une grande patience.
En effet, la personne éprouvée par le découragement est d’abord étreinte par un poignant sentiment de solitude : à ses yeux, personne ne peut la comprendre ni la rejoindre dans ce qu’elle vit, personne ne soupçonne à quel point elle est atteinte par le coup du sort qui la frappe ou la situation dans laquelle elle se trouve. Plus grave encore, et bien souvent : personne, pense-t-elle, ne soupçonne les limites de sa personnalité auxquelles la renvoie sa situation. Ces limites, c’est bien normal, elle avait toujours cherché à les dissimuler à son entourage, et peut-être à elle-même. Elle se considère aujourd’hui comme un « cas ». Elle a honte. Découvrir qu’on n’est pas seul à être un cas, loin de là, ce peut être un premier pas vers le courage retrouvé. Encore faut-il qu’on soit aidé à sortir de sa solitude.
Ce constat vaut aussi bien pour les cas de « petits » découragements éprouvés à la suite d’un échec ou d’une série d’échecs, dans un domaine où l’on pensait pouvoir réussir : on se découvre incapable d’atteindre le but qu’on s’était fixé. La vie spirituelle est sans doute le domaine dans lequel les échecs peuvent être les plus cuisants. Ici encore, c’est l’image de soi qui est en cause. On aurait voulu être quelqu’un de bien, ou de meilleur. Or on découvre qu’on n’est pas celui qu’on voudrait être. Sentiment d’échec et, bien souvent, culpabilisation. On ne retiendra ici que quelques cas typiques parce que très ordinaires.
Le plus courant et le plus simple, presque caricatural, se rencontre d’ordinaire lorsqu’on fait ses premiers pas dans la vie spirituelle. On a pris des « résolutions » : ne pas me coucher sans avoir fait mon temps de méditation quotidien, m’astreindre à un régime alimentaire plus frugal, diminuer ma consommation d’alcool, ne plus dire du mal de ma supérieure, aller à la messe en semaine, m’engager dans une association d’aide aux gens en détresse, mettre un frein à ma langue de vipère, m’intéresser davantage à ce qu’aura fait ma femme pendant la journée, n’ouvrir mon ordinateur que deux heures, pas plus, pendant le week-end… L’expérience montre qu’il est rare qu’on tienne ses résolutions. Alors on se lasse, on se dit que, décidément, on n’est pas bon à grand-chose pour le service de Dieu, et on retourne à ses ornières.
Le cas le plus typique est celui de la vie de prière – l’oraison personnelle, qui est la pierre d’angle de la vie spirituelle. Combien de confesseurs ou d’accompagnateurs spirituels entendent l’aveu accablé : « La prière, je n’y arrive pas. Ça a marché par périodes : je suis arrivé parfois à tenir plusieurs mois de suite. J’avais un certain goût pour la prière. Ça me faisait du bien, ça donnait du tonus à mes journées. Mais ça n’a pas duré. Maintenant, ma prière, c’est presque rien. Et je sens que, sur bien des points de ma vie quotidienne, je décroche » ? Tristesse de se dire qu’on est voué à une certaine médiocrité, que l’aventure spirituelle, c’est pour les autres.
Une autre forme de découragement guette celui qui a déjà fait un bon bout de chemin dans la vie spirituelle ou qui s’est engagé dans la vie religieuse ou dans un séminaire : « Jusqu’à présent, ça va à peu près. Mais il n’est pas possible que cela dure. C’est trop difficile, jamais je ne pourrai tenir toute ma vie. Fait comme je suis, un jour, je vais me casser la figure. Il vaut mieux arrêter les frais tout de suite. » Qui n’a jamais connu cette tentation ? Ignace de Loyola lui-même, dans sa grotte de Manrèse, a été habité par cette « pensée lancinante qui le torturait : “Comment pourras-tu supporter cette vie pendant les soixante-dix ans que tu dois vivre ?” » 7. Fort de son expérience, il pourra écrire dans les Exercices spirituels : « Chez ceux qui progressent intensément […] le propre de l’esprit mauvais est de mordre, d’attrister et de mettre des obstacles en inquiétant par de fausses raisons, pour empêcher d’aller de l’avant » (n° 315). Puissance de l’imagination : elle projette sur l’avenir les difficultés du présent, en les amplifiant, sourde à la chanson de la petite fille Espérance.
Une autre forme de découragement guette celui qui a déjà fait un bon bout de chemin dans la vie spirituelle ou qui s’est engagé dans la vie religieuse ou dans un séminaire : « Jusqu’à présent, ça va à peu près. Mais il n’est pas possible que cela dure. C’est trop difficile, jamais je ne pourrai tenir toute ma vie. Fait comme je suis, un jour, je vais me casser la figure. Il vaut mieux arrêter les frais tout de suite. » Qui n’a jamais connu cette tentation ? Ignace de Loyola lui-même, dans sa grotte de Manrèse, a été habité par cette « pensée lancinante qui le torturait : “Comment pourras-tu supporter cette vie pendant les soixante-dix ans que tu dois vivre ?” » 7. Fort de son expérience, il pourra écrire dans les Exercices spirituels : « Chez ceux qui progressent intensément […] le propre de l’esprit mauvais est de mordre, d’attrister et de mettre des obstacles en inquiétant par de fausses raisons, pour empêcher d’aller de l’avant » (n° 315). Puissance de l’imagination : elle projette sur l’avenir les difficultés du présent, en les amplifiant, sourde à la chanson de la petite fille Espérance.
Petits et grands remèdes
Face au découragement, et comme on l’a suggéré à propos des « mauvais coups du sort », la tradition chrétienne est unanime : le premier remède consiste à trouver une oreille capable d’entendre votre plainte. Sortir de sa solitude : « Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie », disait Paul Valéry. Il y a là un premier acte de foi à poser : oui, je peux parler. La figure du « père spirituel », ou de celui qui en tient lieu, est là pour aider celui qui est sur la pente de la désespérance.
Le découragé qui a encore le courage de s’ouvrir de son découragement sera d’abord surpris de découvrir qu’il n’est pas le « cas » qu’il s’imagine être. Ce qui lui arrive, est arrivé à bien d’autres. Il découvrira en même temps que le simple fait d’exprimer son découragement, maladroitement peut-être d’abord, de le faire passer par les mots, a le pouvoir étrange de dégonfler considérablement les baudruches qu’avait enflées son imagination. C’est déjà beaucoup pour quelqu’un qui est tenté d’abandonner le genre de vie auquel il s’est engagé.
Dans le cas de celui qui a pris des « résolutions », une des premières découvertes sera qu’il avait vraisemblablement placé la barre trop haut. Les exigences qu’il s’était imposées ne tenaient sans doute pas assez compte des contraintes de la réalité. Et d’abord de la réalité de ce qu’il est. Dans la vie spirituelle, il entre d’ordinaire beaucoup d’idéalisme. On cherche des performances, on veut être autre que ce qu’on est. La comparaison du moi idéal avec ce qu’on est en fait, peut décourager les meilleures volontés. L’accompagnateur aidera à trouver de plus justes repères. Il invitera à la patience. Il y a fort à parier qu’il déconseillera, pour l’avenir, les « résolutions » : il suggèrera des « orientations ». Jésuitisme ? Pour convaincre les esprits mal tournés, lisons ce passage d’une lettre de François de Sales (pétri, il est vrai, de spiritualité ignatienne !) à Jeanne de Chantal :
Dans le cas de celui qui a pris des « résolutions », une des premières découvertes sera qu’il avait vraisemblablement placé la barre trop haut. Les exigences qu’il s’était imposées ne tenaient sans doute pas assez compte des contraintes de la réalité. Et d’abord de la réalité de ce qu’il est. Dans la vie spirituelle, il entre d’ordinaire beaucoup d’idéalisme. On cherche des performances, on veut être autre que ce qu’on est. La comparaison du moi idéal avec ce qu’on est en fait, peut décourager les meilleures volontés. L’accompagnateur aidera à trouver de plus justes repères. Il invitera à la patience. Il y a fort à parier qu’il déconseillera, pour l’avenir, les « résolutions » : il suggèrera des « orientations ». Jésuitisme ? Pour convaincre les esprits mal tournés, lisons ce passage d’une lettre de François de Sales (pétri, il est vrai, de spiritualité ignatienne !) à Jeanne de Chantal :
« Vous ne vous sentez pas ferme, constante, ni bien résolue. […] Serait-ce point peut-être une multitude de désirs qui fait des obstructions en votre esprit ? J’ai été malade de cette maladie. L’oiseau attaché sur la perche se connaît attaché et sent les secousses de sa détention et de son engagement seulement quand il veut voler ; et, tout de même, avant qu’il ait ses ailes, il ne connaît son impuissance que par l’essai du vol. Pour un remède donc, ma chère fille, puisque vous n’avez pas encore vos ailes pour voler et que votre propre impuissance met une barrière à vos efforts, ne vous débattez point, ne vous empressez point pour voler ; ayez patience que vous ayez des ailes pour voler comme des colombes. Je crains infiniment que vous n’ayez un peu trop d’ardeur à la proie, que vous ne vous empressiez et multipliiez les désirs un peu trop dru. […] Il faut faire des essais, mais modérés, mais sans se débattre, mais sans s’échauffer » 8.
Quant à la vie de prière, celui qui est tenté de se décourager s’entendra dire que la prière – prendre le temps de prier – est un combat jamais gagné, toujours à reprendre, même pour le moine. Si je règle ma vie de prière sur le goût que j’y éprouve (ou, pour reprendre un mot de notre époque, l’« envie » que j’en ai), j’aurai tôt fait d’abandonner. Prier, c’est s’exercer à la foi. Or la foi commence quand on ne « voit » pas, quand on ne « sent » pas. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le climat habituel de la prière des grands amis de Dieu, ceux qui rayonnent de joie et de charité active, est la sécheresse, c’est-à-dire l’absence de ces élans qui jadis les transportaient parfois – quand ce ne sont pas les ténèbres, comme on vient de le découvrir chez Mère Teresa. Prier, c’est prendre le temps de Lui dire : « Je suis là parce que Tu es là », même s’il ne se passe pas grand-chose. Prier, c’est d’abord faire acte de présence, simplement, respecter le silence. Il est probable que, pour celui qui aura su passer outre ses premiers découragements, ce silence ne tardera pas à bruire d’une brise encourageante.
Le découragement se nourrit de la considération de notre misère. Or il faut prendre garde à la mauvaise complaisance dans ce triste spectacle. François de Sales disait à ses filles de la Visitation : « C’est l’amour-propre qui donne ces confusions-là, parce que nous sommes marries de n’être pas parfaites, non tant pour l’amour de Dieu que pour l’amour de nous-mêmes ». Il entre souvent du dépit dans nos découragements. « Il est très bon d’avoir de la confusion quand nous avons la connaissance et sentiment de notre imperfection ; mais il ne faut pas s’arrêter là, ni tomber pour cela en découragement, mais relever son coeur en Dieu par une sainte confiance, de laquelle le fondement doit être en lui et non pas en nous. […] J’ai accoutumé de dire que le trône de la miséricorde de Dieu, c’est notre misère : il faut donc, d’autant plus que notre misère sera plus grande, avoir une plus grande confiance, car la confiance est la vie de l’âme : ôtez-lui la confiance, vous lui donnez la mort » 9.
À suivre François de Sales, l’antidote contre le découragement, ce n’est pas le courage. C’est la confiance, autre nom de la foi. Comme tous les grands spirituels, il invitait à contempler Jésus de préférence à Gethsémani. Faire l’expérience du découragement, c’est pouvoir enfin entrer dans le chemin de l’humilité vraie. Comme le faisait remarquer Cassien, lorsque David n’a pas perdu coeur devant Goliath, il n’a pas choisi le lourd équipement du guerrier accompli. Il a pris l’arme proportionnée à sa frêle stature et à ce qu’il savait faire. David a été humble et il a eu confiance 10.
À nos frondes !
1. Le Traité du désespoir (1849) de Sören Kierkegaard fait date.
1. Le Traité du désespoir (1849) de Sören Kierkegaard fait date.
2. Récit, 24. Dans cette « autobiographie », Ignace parle de lui à la troisième personne.
3. Déposition de Mme Amelot. Sur cet épisode, voir Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux, Bloud et Gay, 1921, t. I, ch. 3, p. 86s. ; voir surtout François de Sales, OEuvres, éd. d’Annecy, t. XXII (1925), Préface, p. XIIs.
4. Correspondance, 1966, p. 522.
5. Voir Cassien, Institutions, X, 1-6.
6. Voir Bernard Forthomme, De l’acédie monastique à l’anxio-dépression. Histoire philosophique de la transformation d’un vice en pathologie, Sanofi-Synthélabo, 2000.
7. Récit, 20.
8. Correspondance, Desclée de Brouwer, 1980, p. 183.
9. « De la confiance et abandonnement », Entretiens spirituels, III. Tout cet entretien éclaire notre sujet. De même le petit traité L’Abandon à la Providence divine, jadis attribué à Caussade (éd. D. Salin, Desclée de Brouwer, coll. « Christus », 2005).
10. Conférences, XXIV, 8.