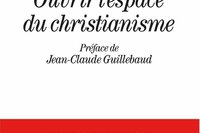Lorsqu'à quelques encablures d'Orléans s'étire la Loire sablonneuse, la basilique de Saint-Benoît dresse sa flèche un peu massive. A sa manière, la flèche romane témoigne d'emblée de la beauté de la vie religieuse comme affirmation radicale, appel qui s'impose à travers le temps et l'espace, défiant le fleuve et la plaine. « La beauté, Dieu l'a partagée... », psalmodie un poète berbère. A sa manière, la vie religieuse en a sa part qui donne chair à l'intuition chrétienne.
Plus encore que de pierres, cette forme de beauté me parle d'abord de visages. Dans mon parcours de laïc engagé, des aumôneries de lycée au Service national des Vocations, dans mon travail d'éditeur religieux depuis près de vingt ans, nombre de figures de religieux et de religieuses m'ont marqué. A leur manière, tous ces visages, ces sourires, ces regards sont autant de contrepoints aux
Plus encore que de pierres, cette forme de beauté me parle d'abord de visages. Dans mon parcours de laïc engagé, des aumôneries de lycée au Service national des Vocations, dans mon travail d'éditeur religieux depuis près de vingt ans, nombre de figures de religieux et de religieuses m'ont marqué. A leur manière, tous ces visages, ces sourires, ces regards sont autant de contrepoints aux