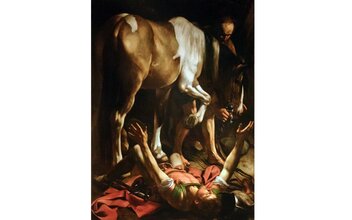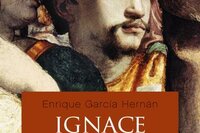En 2014, les jésuites ont célébré le bicentenaire de la restauration de la Compagnie de Jésus. Un colloque s’est tenu au Centre Sèvres à cette occasion. Le père Patrick Goujon, théologien et historien, a donné une conférence à ce sujet. L’article qui suit est la reprise de son propos.
Entre 1773, date à laquelle est proclamé le bref de suppression de la Compagnie de Jésus, et 1814, quand est promulguée la bulle de son rétablissement, à peine quarante ans se sont écoulés. Mais ces années comptent double, si l’on peut dire : fin de l’Ancien Régime, Révolution française, guerres napoléoniennes et enfin congrès de Vienne qui, en 1814, donne à l’Europe des frontières et des régimes politiques nouveaux, même sous l’habit ancien des monarchies…
Cependant, ces deux dates dessinent également un trompe-l’œil : les suppressions ont commencé bien avant la décision du pape Clément XIV. Quant au rétablissement, il a été précédé de multiples entreprises, dès les premières années qui ont suivi la suppression. Retraçons les grands moments de ces événements afin d’essayer de comprendre ce qui s’est passé.
Suppression et rétablissement de la Compagnie de Jésus
Ou comment faire corps en Eglise

Plan de l’article
- Les causes de la suppression
- En divers lieux, de 1773 à 1814
- La bulle du rétablissement
- Poursuivre l’aventure
- Des griefs nombreux et variés…
- La fin proclamée des jésuites
- La Russie blanche
- En Italie
- En Angleterre et aux États-Unis
- Un attachement à la Compagnie malgré tout
- L’imprévu
- Les concertations
- Pour le bien universel de l’Église
- Comment faire corps ?
- Une reconfiguration du lien
Article réservé aux abonné(e)s
Le bref de suppression, décrété par Clément XIV, rassemblait tous les chefs d’accusation portés de longue date envers les jésuites.Depuis sa fondation, la Compagnie s’était rendue active, bon gré mal gré, dans différentes polémiques. En théologie, contre les protestants, les jansénistes et dans la querelle de la grâce. Dans la vie religieuse, elle était perçue comme un ordre nouveau qui semblait faire concurrence à des ordres plus anciens, notamment dans les luttes d’influence pour se partager les
Il reste 90% de l’article à lire
Cet article fait partie de la sélection réservée à nos abonné(e)s
Déjà abonné(e) ?
Abonnement Numérique
9,50€ par trimestre
JE DÉCOUVRE, SANS ENGAGEMENT
9,50€ par trimestre
Tous les contenus en illimité
sur revue-christus.com
sur revue-christus.com
Débloquer l’article seul
ACHETER L'ARTICLE EN NUMERIQUE - 2,50 EUROS
Article disponible en version numérique en ligne (2,50 euros)
Revue N°245 (Janvier 2015) disponible en version papier et numérique.
Revue N°245 (Janvier 2015) disponible en version papier et numérique.
Dans le même domaine
A propos de l'auteur