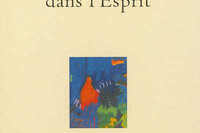Le souci, connaturel à l'être humain, a engendré de nos jours une sorte d'inquiétude bien caractéristique, à savoir « la fatigue d'être soi », pour reprendre ici le titre d'un ouvrage fort éclairant d'Alain Ehrenberg. Ce sociologue du CNRS, qui s'est attaché à dessiner les figures de l'individu contemporain, voit dans la dépression, si largement répandue aujourd'hui, le signe majeur d'une mutation : pourquoi donc et comment la dépression s'est-elle imposée dans la société occidentale comme notre principal malheur intime ? Telle est la question qui conduit son analyse à partir d'une hypothèse assez convaincante : « La dépression amorce sa réussite au moment où le modèle disciplinaire de gestion des conduites, les règles d'autorité et de conformité aux interdits, qui assignaient aux classes sociales comme aux deux sexes un destin, ont cédé devant des normes qui incitent chacun à l'initiative individuelle en l'enjoignant à devenir lui-même » 1.
La dépression s'impose ainsi dans notre culture comme une maladie de la responsabilité, celle de n'avoir d'autre compte à rendre qu'à soi-même de la réussite ou de l'échec de sa vie. Elle est une zone privilégiée pour comprendre l'individualité contemporaine. Elle est la pathologie d'une société où l'obligation morale n'est plus fondée sur le permis/défendu, mais sur le fait de devoir se montrer « à la hauteur ». Si le névrosé se sent coupable devant une loi qu'il enfreint, le déprimé, lui, se sent insuffisant devant une obligation de réussite qui l'épuisé : il tombe en panne !
Il n'est pas question de suivre ici le cheminement d'un livre d'une grande richesse, mais d'y trouver un point de départ à notte réflexion sur le souci de soi. La fatigue d'être soi ne serait-elle pas, sur son versant spirituel, le symptôme d'une autre crise celle de l'oubli d'une Parole fondatrice que beaucoup rejettent aujourd'hui au nom du refus de la transcendance ? Et si justement l'écoute de cette Parole, ou, pour parler comme saint Paul, l'obéissance de la foi, était autre chose qu'une soumission servile ? Si elle était écoute d'un appel à devenir soi-même et d'une promesse d'accomplissement ?
La dépression s'impose ainsi dans notre culture comme une maladie de la responsabilité, celle de n'avoir d'autre compte à rendre qu'à soi-même de la réussite ou de l'échec de sa vie. Elle est une zone privilégiée pour comprendre l'individualité contemporaine. Elle est la pathologie d'une société où l'obligation morale n'est plus fondée sur le permis/défendu, mais sur le fait de devoir se montrer « à la hauteur ». Si le névrosé se sent coupable devant une loi qu'il enfreint, le déprimé, lui, se sent insuffisant devant une obligation de réussite qui l'épuisé : il tombe en panne !
Il n'est pas question de suivre ici le cheminement d'un livre d'une grande richesse, mais d'y trouver un point de départ à notte réflexion sur le souci de soi. La fatigue d'être soi ne serait-elle pas, sur son versant spirituel, le symptôme d'une autre crise celle de l'oubli d'une Parole fondatrice que beaucoup rejettent aujourd'hui au nom du refus de la transcendance ? Et si justement l'écoute de cette Parole, ou, pour parler comme saint Paul, l'obéissance de la foi, était autre chose qu'une soumission servile ? Si elle était écoute d'un appel à devenir soi-même et d'une promesse d'accomplissement ?
Ne dépendre que de soi-même
Au premier abord, il est vrai, cette « obéissance » se présente comme une soumission : elle engage à soumettre sa volonté et son jugement à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Saint Ignace y voit avec la tradition chrétienne la base de l'humilité : « Elle consiste à m'abaisser et m'humilier autant que cela m'est possible pour que j'obéisse en tout à la loi de Dieu'notre Seigneur » (Ex. sp. 165). De la soumission à la démission, il n'y a qu'un pas aux yeux des maîtres du soupçon, pour qui toute dépendance est aliénation : « Le fruit le plus mûr de l'arbre écrit Nietzsche est l'individu souverain, l'individu qui n'est semblable qu'à lui-même » 2. L'individu contemporain se veut, en effet, souverain : ayant conquis son autonomie, il ne dépend plus d'aucune norme étrangère à son jugement propre, ou au jugement de la délibération démocratique. C'est une dimension de la modernité, que chacun revendique aujourd'hui. D'où cette sensibilité quasi épidermique vis-à-vis de toute autorité qui se réfère à une révélation dans le domaine moral ou religieux.
Que l'on mesure à cette aune le paradoxe des affirmations conciliaires. A propos de la vie consacrée, le décret Perfectae caritatis souligne, parmi les biens que les familles religieuses procurent à leurs membres, « une liberté fortifiée par l'obéissance », et il demande aux supérieurs d'amener leurs subordonnés à collaborer par une obéissance responsable et active dans les tâches à accomplir et les initiatives à prendre. Quel paradoxe, en effet, que cette obéissance qui promeut la créativité ! De même, à propos des laïcs, dont la vocation est de construire l'ordre temporel et de l'orienter vers Dieu, le Concile, tout en reconnaissant l'autonomie des réalités terrestres et des sociétés elles-mêmes, met en garde contre un usage des choses qui se voudrait indépendant de leur source, qui est le Créateur : si l'homme doit en user selon sa conscience il revient cependant aux pasteurs d'« énoncer clairement les principes concernant la fin de la création et l'usage du monde et d'apporter une aide morale et spirituelle pour que les réalités temporelles soient renouvelées dans le Christ » 3.
Autrement dit, l'Eglise affirme tout à la fois la responsabilité personnelle des chrétiens dans les initiatives qui relèvent de leur compétence, et la dépendance de leurs décisions vis-à-vis de la loi de Dieu, dépendance consentie non seulement dans le for interne de la conscience morale, mais aussi dans l'assentiment à l'interprétation que le magistère ecdésial propose de cette loi. On sait ce qu'il en advient souvent dans la pratique. Comme l'exprime ingénument une jeune pèlerine des JMJ à Rome : « On écoute ce que dit le Pape, et ensuite chacun voit si ça colle avec qu'il a envie de croire ou ce qu'il a envie d'être » Serions-nous au rouet ? Liberté et obéissance seraient-elles rivales au point que ce que l'on donne à l'une serait retirée à l'autre ? La tentation peut êtte grande alors, pour l'autorité, de prétendre apporter réponse à tout et, pour le fidèle, religieux ou laïc, de se soumettre au point de renoncer à penser par soi-même, ou inversement de considérer son action comme ne relevant que de soi et de la soustraire à la relation d'obéissance D'un côté comme de l'autre, c'est l'impasse, celle de l'autoritarisme qui confisque la responsabilité de chacun ou celle de l'indépendance qui dérive vers le sécularisme. On est là dans une dialectique faussée dès l'origine, qui donne à l'un ce qu'elle prend à l'autre.
Le fils de l'homme ne fait rien de lui-même
C'est en regardant le Christ que le paradoxe s'éclaire. En lui, en effet, initiative et soumission, loin de s'exclure, s'appellent l'une l'autre par un mystérieux échange avec celui qu'il appelle son Père une communication réciproque qui est précisément l'Amour en personne L'évangile de Jean le souligne montrant sans cesse comment le Fils « ne fait rien de lui-même », mais seulement ce qu'il voit faire au Père, qu'il « ne dit rien de lui-même », sinon ce que le Père lui enseigne qu'il « n'est pas venu de lui-même », mais qu'il est envoyé 4. L'agir de l'un est engagé tout entier dans l'agir de l'autre au point que cette volonté du Père, le Fils la trouve non seulement dans son union intime à Celui qui l'envoie, mais aussi dans les Ecritures, qu'il accomplit jusqu'au dernier iota dans la condition humaine de son incarnation : c'est sa nourriture sa vie et sa joie d'accomplir le dessein du Père et il en dépend absolument.
Et pourtant si Jésus n'agit à aucun moment de façon indépendante, il montre en toutes choses une liberté souveraine. Les traditions humaines, le désir de plaire ou la crainte de contrarier, la pression du groupe des disciples comme la persuasion des affections familiales n'ont aucune prise sur son comportement. Comme l'ont remarqué ses auditeurs directs, « aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme » ; aucun ne s'est jamais comporté avec une telle « autonomie ». Et comme l'a si bien reconnu un penseur contemporain : « Sa vie est faite tout entière de ce qui arrive si rarement chez un homme uniquement de décisions. Jésus, en chacune de ses paroles, en chacun de ses actes, n'est jamais là où nous l'attendons. Il n'agit jamais ni par routine ni par révolte mais à coup d'inventions qui sont chaque fois pour nous des surprises, comme un poème qui désarçonne nos logiques coutumières » 5.
Or, et voici ce qui nous touche, c'est précisément parce que Jésus est obéissant qu'il est libre. C'est parce qu'il remet à un autte le souci de soi et écoute sans cesse une parole qui vient d'ailleurs qu'il est « différent ». C'est parce qu'il s'en nourrit continuellement et l'accueille au point d'être lui-même la Parole que son langage et ses démarches ne sont réductibles à aucun discours humain ni à aucune analyse sociale. Il se reçoit du Tout Autre. Aussi, ses décisions étonnent et sa sagesse paraît folle au regard de la prudence humaine, de ses routines ou de ses révoltes. Son obéissance même est l'expression de son identité de Fils et d'Envoyé.
C'est cette conformité d'attitude que vise l'obéissance chrétienne, celle qui anime l'Eglise dans le monde : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » L'Eglise, comme chacun de ses membres, trouve son identité et son assurance dans le fait de se recevoir d'un autte, car l'Esprit que Jésus ressuscité souffle sur ses disciples établit sa présence en eux dans une relation analogue à celle qu'il vit avec son Père. Et de même que Jésus, qui trouvait la volonté du Père à sa source, en découvrait les déterminations concrètes dans le corps des Ecritures qu'il accomplissait ainsi le chrétien, qui cherche le vouloir de Dieu dans la prière, en trouve l'expression à travers les événements qu'il interprète dans le corps de l'Eglise visible et hiérarchique, avec les déterminations propres à chaque état de vie : « Car nous croyons qu'entre le Christ notre Seigneur, qui est l'Epoux, et l'Eglise son Epouse, il y a un même Esprit qui nous gouverne et nous dirige pour le bien de nos âmes » (Ex. sp. 365).
Donné à soi-même
L'Evangile nous révèle ainsi le mystère de l'existence humaine. Car, hors de Jésus Christ, comme l'exprimait si justement Pascal, « nous ne savons ce que c'est ni que notte vie, ni que notte mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes ». Mais en lui, l'homme découvre qu'il est l'objet d'une attention bienveillante et qu'il se reçoit bien plus qu'il ne se fait. Telle est sans doute pour chacun la première expérience spirituelle, vécue sous des modes fort divers, celle de se découvrir aimé de Dieu et d'y trouver la lumière qui transfigure toutes choses. Un témoin comme Jean Vanier l'a dit en mots familiers à propos de ces personnes accueillies à l'Arche avec un grave handicap, qui, après quelque temps, découvraient dans la prière une paix insoupçonnée : « Il est extraordinaire de rencontrer certains hommes ou femmes, profondément blessées, qui ont découvert qu'ils sont aimés de Dieu, et qu'ils ont vraiment un pouvoir sur Dieu. A ce moment, on n'est plus handicapé, on a découvert sa raison d'être... »
La plupart d'entre nous dépensent une énergie considérable à justifier leur existence aux yeux des autres. Notte monde, impitoyable aux faibles, demande à chacun d'être performant pour avoir le droit d'occuper une place reconnue dans la société et pour mériter de la garder. D'où cette course épuisante à la qualification et au rendement, cette recherche permanente de formation et de développement en vue d'une réussite qui oblige à se construire un « moi » compétitif souvent assez artificiel. Or, affirme hautement l'évangile, ce ne sont pas les mérites qui nous justifient devant Dieu, mais la foi. Voilà ce qui, pour un chrétien, justifie son existence : croire qu'il est aimé de Dieu sans l'avoir mérité et chercher à lui plaire. Chacun, pour exister, pour respirer, pour inventer sa vie a besoin de plus d'amour qu'il n'en mérite : c'est cela qui le fait tenir debout sur la terre le délivre du souci si encombrant de lui-même et suscite en lui un mouvement de confiance d'abandon et de reconnaissance.
Tel est le miracle de l'amour : chacun s'éprouve, selon le mot d'Aragon, « donné à soi-même par la grâce d'un autte », par ce regard qui, loin de figer et d'exiger, voit toujours en chaque personne un extraordinaire possible. Cette expérience-là révèle une autre image de Dieu, elle fait tomber les écailles des yeux du croyant qui découvre étonné, qu'il avait été trompé, qu'il s'était leurré sur Dieu. Elle lui révèle l'humilité d'un Dieu soucieux de l'homme et de sa réussite
Alors, est-il possible de parler à nouveau de transcendance, si c'est celle d'un amour qui ne se laisse déterminer par rien d'autre que lui-même ? Quand nous parlons de la transcendance de Dieu, n'est-ce pas ce que nous voulons exprimer ? Que l'origine de toute chose n'est pas le hasard, ni le déterminisme ni l'Idée ni la matière, mais un mystère personnel qui ne se laisse mouvoir que par le pur désir de se communiquer, de susciter l'autre de le valoriser, et finalement de lui conférer toute dignité. « Je me reçois bien plus que je ne me fais..., remarquait Teilhard. En dernier ressort la vie profonde, la vie fontale, la vie naissante nous échappent absolument. »
Le don de soi comme sens à la vie
Si la personne humaine est, selon l'affirmation du Concile, « l'unique créature sur la terre voulue de Dieu pour elle-même », elle ne peut alors se ttouver qu'en entrant dans ce même mouvement par le don d'elle-même. Quand la logique du don désintéressé entre dans la vie que ce soit sous la forme de la vie familiale d'une consécration religieuse de l'attention aux plus faibles ou de tout engagement sincère alors commence proprement la vie spirituelle, c'est-à-dire, au sens chrétien, la vie dans l'esprit du Christ, celle qui cherche à lui plaire, en se rendant docile à son inspiration.
Cette remise de soi dépasse de beaucoup la soumission à la loi : elle est le fruit d'un désir profond d'unité, de conformité et de collaboration à l'oeuvre de Dieu dans le monde. A ce point il n'y a plus division entre la prière et l'action, mais union des volontés en toutes choses. Nous retrouvons ici le sens de l'obéissance dans sa dimension proprement spirituelle, qu'éclaire un mot de saint Jean Climaque : « La chute, pour l'obéissant, c'est la volonté propre. Pour l'hésychaste, c'est l'interruption de la prière. » Remarque fort pertinente, en ce qu'elle souligne que le retour à la volonté propre chez l'homme d'action est semblable à la cessation de la prière chez le contemplatif. Pour l'un comme pour l'autre, dans la différence de leur vocation, le retour sur soi interrompt le courant de la charité qui vient d'en haut et la recherche du bon plaisir de l'autre.
C'est dans cette perspective qu'il est permis de comprendre la nécessité d'un juste souci de soi. Car l'amour, qui est communication mutuelle des biens, cherche à développer les talents reçus afin de pouvoir offrir en échange un don plus précieux. « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède... Tu me l'as donné. A toi, Seigneur, je le rends. Dispose de tout selon ton entière volonté... » C'est par cette offrande que s'achèvent les Exercices. Dès lors, tout effort de développement personnel trouve ici son sens, dans la mesure où il se situe au sein d'une alliance, d'une communication réciproque.
Dans son précieux petit livre sur Le développement personnel, Michel Lacroix, auteur d'un article dans ce numéro, montre bien comment une certaine conception laïcisée de la spiritualité fait de celle-ci le moyen de manifester son potentiel comme pure affirmation de soi : « Travaillez sur vous-mêmes, dit-on aux adeptes, élargissez votre conscience et vous atteindrez l'absolu. » Cette recherche d'excellence, de pouvoir illimité, a quelque chose de faustien et aboutit finalement à faire de la « spiritualité » un instrument au service du culte du moi, même si ce moi-là est recherché dans le dépassement de l'ego. L'homme du développement personnel, écrit Lacroix, « fasciné par la dissolution mystique, se réserve la possibilité de revenir à tout moment à l'ego. Bref, il n'oublie jamais que son potentiel est à la fois transpersonnel et personnel stricto sensu. » Ce développement, qui participe de la culture prométhéenne, pourrait conduire à une nouvelle forme de conscience malheureuse. L'analyse rejoint pleinement celle d'Ehrenberg.
* * *
Le juste souci de soi trouve sa vraie place au sein de la relation comme la nécessité de faire mûrir des potentialités qui ne s'accom- plissent finalement que dans l'oblation. Beaucoup voient aujourd'hui ce développement corporel et affectif, intellectuel et social, comme une haute exigence, un dépassement continuel qui exige aussi un vrai renoncement. C'est comme un entraînement ou, pour reprendre ici un mot chargé de sens, un exercice.
Rainer Maria Rilke le dit magnifiquement de l'amour humain et de ses préparations : « L'amour d'un êtte humain pour un autre est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun d'entre nous, c'est le plus haut témoignage de nous-mêmes... L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autte... L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. » Que dire alors de l'amour d'un être humain pour son Seigneur ! Il fait de lui l'un de ces vivants dont saint Paul affirme qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, « mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2 Co 5,15). En fin de compte, l'Evangile nous rappelle que cet amour-là est folie, renversement des sagesses humaines, et que c'est en se donnant, à cause du Christ et de son Royaume, que l'on reçoit, en se quittant que l'on se trouve.
1. La fatigue d'être soi, Odile Jacob, 1998, p. 10.
2. Généalogie de la morale (1887), cité en exergue par A. Ehrenberg, op. cit.
3. Décret sur l'apostolat des laies, 7.
4. Cf. Jn 5,19 ; la note 9 de la Bible de Jérusalem indique les autres références.
5. Roger Garaudy, Parole d'homme, Laffont, 1975, p. 14 (rééd. Seuil, 1980).