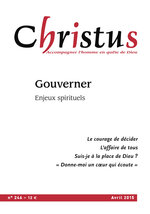Le rapport entre gouvernants et gouvernés repose sur le couple plus fondamental délégation-confiance. Dans un monde représentatif, comme on le connaît en France et dans toutes les démocraties, les gouvernants font l’objet d’une délégation donnée par le vote lors d’élections. En donnant mon vote, je vais « soutenir » une organisation politique, ou un homme politique, à qui je fais confiance. Sinon je ne voterais pas pour lui. Ce qui est au coeur du sujet, c’est ce rapport délégation-confiance et le maintien de la confiance dans le temps, malgré les déceptions et les difficultés. En effet, tout n’est pas écrit au moment de l’élection. J’ai vécu cela dans mes responsabilités syndicales. Élu par l’ensemble des syndicats, je faisais partie d’un collectif amené à prendre des décisions difficiles, notamment sur la réforme des retraites et en matière d’emploi. Comme « gouvernant », chargé d’une responsabilité et d’une prise de décision, comment garder la confiance de ceux qui m’ont délégué ?
La réception des décisions prises
Dans le cadre de ma responsabilité propre qui consistait à diriger une organisation syndicale de cadres, je savais, à un certain moment, que tel dossier sur lequel on voulait avancer devait être retiré parce que ce n’était pas mûr. J’étais reconnu comme celui qui pouvait dire, dans un bureau national, qu’on reprendrait le dossier plus tard, parce que, insuffisamment abouti ou partagé, il n’était pas recevable en l’état. C’est toujours la prise de décision et sa réception par l’ensemble d’un corps social qui est ici en question. La dynamique gouvernant-gouverné n’est pas propre au politique, elle est au