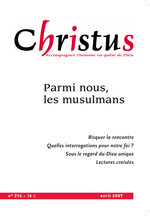«Il a parlé par les prophètes », dit le Credo chrétien. « Nous croyons en Dieu (…), en ce que les prophètes ont reçu de leur Seigneur — et nous ne faisons pas de différence entre eux », lit-on dans le Coran (2,136). Les deux confessions de foi seraient-elles équivalentes ? Il est tentant de le penser et de voir, dans le judaïsme, le christianisme et l’islam, des religions qui, à défaut d’être soeurs, pourraient bien être cousines. Mais on prendra garde aux équivalences faciles. Les mêmes mots ne signifient pas nécessairement les mêmes choses selon qu’ils entrent dans un ensemble ou dans un autre. L’oublier, c’est s’exposer à des erreurs de perspective et à de graves déconvenues.
« Prophète », un mot équivoque
Dans son discours de Pentecôte, Pierre qualifie David de prophète (Ac 2,30). Dans les anciens récits, le roi David était flanqué des prophètes Gad (1 S 22,5 ; 2 S 24,11) ou Natan (2 S 7,2) ; les narrateurs de ce temps-là savaient bien qu’on ne pouvait pas être à la fois roi et prophète. Que s’est-il donc passé entre deux ?
Dans la société israélite préexilique était qualifié de prophète quelqu’un qui disait transmettre un oracle divin. C’était une fonction parmi d’autres, celles des rois, des prêtres, des sages, etc. Et de même qu’il pouvait y avoir des rois tyranniques, des prêtres corrompus, des sages incompétents, il pouvait y avoir des prophètes trompeurs. Cela n’avait rien de scandaleux ; il appartient à chaque société de se prémunir contre le mauvais fonctionnement de ses institutions.
On en a un exemple aux traits grossis jusqu’à la caricature dans l’affrontement entre Michée fils