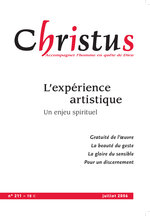Les premiers jésuites connaissaient certainement les Turcs. La promesse qu’ils vouaient au pape au sujet des missions « concernant le bien des âmes et la propagation de la foi » impliquait de se rendre, « sans aucune tergiversation ni excuse, immédiatement », partout où l’on avait besoin d’eux. Plusieurs possibilités étaient mentionnées : le Nouveau Monde, « chez les luthériens » ou « n’importe quels autres infidèles ou fidèles » 1. Mais les premiers nommés étaient les Turcs.
À l’origine de l’engagement des premiers jésuites, il y avait la conviction que le Dieu qu’ils priaient ne pouvait être pleinement trouvé que dans l’engagement au service du Royaume. Ils se voulaient contemplatifs « dans l’action », et cherchaient à rencontrer le Dieu vivant dans leurs multiples manières de servir. Même en 1550, Ignace pouvait imaginer quelque chose de ce genre pour une force navale combattant les Turcs à Tunis. Les grâces du jubilé que l’on manquait si l’on était loin de sa patrie, les grâces accordées aux pèlerins qui s’étaient rendus à Rome, au coeur de l’Église, pouvaient aussi s’étendre « à vous qui, pour la gloire du Christ et l’exaltation de la sainte foi, êtes occupés à guerroyer au loin contre les Infidèles » 2.
Mais la contribution la plus sérieuse des Turcs à l’identité jésuite commença et prit fin avant l’instauration de la Compagnie de Jésus. Ce sont les Turcs qui, en 1537, empêchèrent les compagnons de passer d’Italie en
À l’origine de l’engagement des premiers jésuites, il y avait la conviction que le Dieu qu’ils priaient ne pouvait être pleinement trouvé que dans l’engagement au service du Royaume. Ils se voulaient contemplatifs « dans l’action », et cherchaient à rencontrer le Dieu vivant dans leurs multiples manières de servir. Même en 1550, Ignace pouvait imaginer quelque chose de ce genre pour une force navale combattant les Turcs à Tunis. Les grâces du jubilé que l’on manquait si l’on était loin de sa patrie, les grâces accordées aux pèlerins qui s’étaient rendus à Rome, au coeur de l’Église, pouvaient aussi s’étendre « à vous qui, pour la gloire du Christ et l’exaltation de la sainte foi, êtes occupés à guerroyer au loin contre les Infidèles » 2.
Mais la contribution la plus sérieuse des Turcs à l’identité jésuite commença et prit fin avant l’instauration de la Compagnie de Jésus. Ce sont les Turcs qui, en 1537, empêchèrent les compagnons de passer d’Italie en