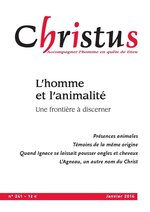Parmi les nombreuses « contrariétés » que Pascal décèle dans l’être humain, figure celle qui se joue entre le sentiment de sa grandeur et la conscience de sa bassesse. Par le premier, l’homme se voudrait l’égal des anges, alors que par la seconde, il se ravalerait au rang de l’animal. Mais, pour Pascal, aucune de ces deux attitudes prise séparément n’est juste. Ainsi écrit-il : « Il est dangereux de trop faire croire à l’homme combien il est égal aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui trop faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l’un et l’autre, mais il est très avantageux de lui représenter l’un et l’autre. Il ne faut pas que l’homme croie qu’il est égal aux bêtes, ni aux anges, ni qu’il ignore l’un et l’autre, mais qu’il sache l’un et l’autre ». Deux dangers menacent donc la condition humaine : se vouloir ange ou bête, ne se savoir ni l’un ni l’autre. Entre les deux, les Pensées tracent une voie étroite. Si l’on en croit Pascal, un jugement lucide conduirait à reconnaître ces deux tendances en l’homme et à les faire cohabiter.
Cette situation de l’homme entre ange et bête se trouve déjà décrite chez les Pères de l’Église. Parmi eux, Grégoire de Nysse décrit cette ambivalence dans son magnifique traité sur La création de l’homme : « Certaines statues présentent, invention de l’artiste pour frapper le spectateur, une double forme, deux visages étant sculptés sur la même tête : de même il me semble que l’homme présente une ressemblance avec deux choses contraires : le caractère divin de sa pensée porte les traits de la beauté divine, mais les élans de ses passions affirment sa parenté avec les animaux. » Les traits qui portent le nom d’instinct chez l’animal prennent une connotation morale et deviennent passions chez l’homme : « Ainsi, ce qui chez le porc est gloutonnerie devient en nous
Humain et animal : rechercher la paix
Dans la Bible

Plan de l’article
- Un compagnonnage
- Sous le signe de la bénédiction
- Un régime de paix
Article réservé aux abonné(e)s
Il reste 90% de l’article à lire
Cet article fait partie de la sélection réservée à nos abonné(e)s
Déjà abonné(e) ?
Abonnement Numérique
9,50€ par trimestre
JE DÉCOUVRE, SANS ENGAGEMENT
9,50€ par trimestre
Tous les contenus en illimité
sur revue-christus.com
sur revue-christus.com
Débloquer l’article seul
ACHETER L'ARTICLE EN NUMERIQUE - 2,50 EUROS
Article disponible en version numérique en ligne (2,50 euros)
Revue N°241 (Janvier 2014) disponible en version papier et numérique.
Revue N°241 (Janvier 2014) disponible en version papier et numérique.
Dans le même domaine

- Expérience spirituelle
- Messe, rites et liturgie
- Parole de Dieu
- Prière, méditation, contemplation

- Evangile
- Foi
- Histoire
- Pauvreté

- Bible
- Confiance
A propos de l'auteur
Brigitte PICQ
A publié « À l’image de Dieu. » Douceur et figure chez Paul Beauchamp (Cerf, 2016).