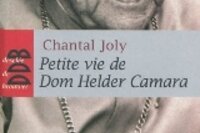Jeanne-Marie Baude
Universitaire et essayiste, Paris.
A notamment publié : Georges-Emmanuel Clancier (PULIM, 2001), Anne Perrier (Seghers, 2004) et L’oeil de l’âme : plaidoyer pour l’imagination (Bayard, coll. « Christus », 2009).Dernier article paru dans Christus : « Plaidoyer pour l’imagination » (n° 215, juillet 2007).
Le présent article est dédié à Édith Clanet-Delos, in memoriam.
Joseph Lemarchand est né en 1913 à Montauban-de-Bretagne, dans une famille de cultivateurs. Son père est tué à la guerre en 1916, et la pauvreté contraint sa mère à se remarier, ce dont il se consolera difficilement. Ordonné prêtre en 1938, il enseigne à Rennes, crée un centre culturel, un journal mensuel, un ciné-club. Il ne commence à publier qu’à quarante-cinq ans, sous le pseudonyme de Jean Sulivan, inspiré du nom d’un héros de film américain. Il vient alors habiter à Paris, en étant déchargé de tout ministère, après la mort de sa mère (à laquelle il a consacré un livre émouvant, Devance tout adieu). En février 1980, il est renversé par une voiture et meurt peu après. Son oeuvre comporte une trentaine de titres.
Les deux articles qui suivent sont issus de conférences organisées par l’Association des amis de Jean Sulivan au Centre Sèvres le 9 avril 2010, sous le thème : « Jean Sulivan, maître spirituel ? », à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort.
Universitaire et essayiste, Paris.
A notamment publié : Georges-Emmanuel Clancier (PULIM, 2001), Anne Perrier (Seghers, 2004) et L’oeil de l’âme : plaidoyer pour l’imagination (Bayard, coll. « Christus », 2009).Dernier article paru dans Christus : « Plaidoyer pour l’imagination » (n° 215, juillet 2007).
Le présent article est dédié à Édith Clanet-Delos, in memoriam.
Joseph Lemarchand est né en 1913 à Montauban-de-Bretagne, dans une famille de cultivateurs. Son père est tué à la guerre en 1916, et la pauvreté contraint sa mère à se remarier, ce dont il se consolera difficilement. Ordonné prêtre en 1938, il enseigne à Rennes, crée un centre culturel, un journal mensuel, un ciné-club. Il ne commence à publier qu’à quarante-cinq ans, sous le pseudonyme de Jean Sulivan, inspiré du nom d’un héros de film américain. Il vient alors habiter à Paris, en étant déchargé de tout ministère, après la mort de sa mère (à laquelle il a consacré un livre émouvant, Devance tout adieu). En février 1980, il est renversé par une voiture et meurt peu après. Son oeuvre comporte une trentaine de titres.
Les deux articles qui suivent sont issus de conférences organisées par l’Association des amis de Jean Sulivan au Centre Sèvres le 9 avril 2010, sous le thème : « Jean Sulivan, maître spirituel ? », à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort.
Petit traité des fulgurances
Le destin posthume d’un écrivain a quelque chose d’imprévisible, et la bonne réception d’une oeuvre par les contemporains n’engage pas son devenir posthume. Qu’en est-il, trente ans après sa mort, pour Jean Sulivan, dont la réputation a été considérable en France dans les années 1960-1980 ? Son statut, à vrai dire, est particulier, puisqu’il était l’un des rares écrivains prêtres à avoir cultivé un genre considéré comme « profane », le genre romanesque. Sa qualité de prêtre constituait par ailleurs, dans les années 1970 – années de contestation et de combats idéologiques –, un réel handicap pour être reconnu comme romancier dans les milieux littéraires, et le mettait en marge, alors qu’il était également en marge par rapport à l’Église catholique, à laquelle, néanmoins, il est toujours demeuré fidèle.Ce statut n’a pas manqué d’éveiller la curiosité de la grande presse. Un journaliste de Paris-Match, Robert Serrou, lui consacre, le 18 mars 1967, un article substantiel sous le titre : « Ce prêtre en colère est-il un nouveau Bernanos ? », et rapporte ces propos de Sulivan : « Prêtre et écrivain, cela va bien ensemble, car l’écrivain, s’il n’est pas un homme debout et en marche qui met le monde en question, qu’est-il, sinon un raconteur d’histoires ? »
Un écrivain sans message
Ce prêtre se démarque des écrivains chrétiens qui se présentent comme des maîtres à penser. Il écrit dans Miroir brisé (1969) : « Supposons que l’écrivain colle parfaitement au message dont il se veut le porte-parole, il devient insidieusement le distributeur de vérités, le Grand Défenseur, consacré, oint du Seigneur. Il se tient en maître sur un siège élevé, auréolé, chargé d’honneurs. Cet écrivain chrétien est littéralement un scandale ; c’est-à-dire un obstacle sur le chemin de la vérité. » Il précise de surcroît dans un entretien : « Je n’ai pas de message […]. J’écris par une espèce de besoin spontané, par une sorte de nécessité intérieure de faire éclater autour de moi le monde dans lequel j’étouffe comme beaucoup de gens. » Il convient en effet de distinguer soigneusement cette nécessité intérieure de la préoccupation du message. On attend trop souvent des écrivains qu’ils apportent un message, attente fort irritante pour beaucoup d’entre eux, comme Paul Claudel qui déclarait avec vigueur que, s’il avait un message à envoyer, il passait par la poste.
Sulivan écrit pour vivre, comme il le dit avec force : « Un écrivain écrit comme une plante pousse, comme un arbre s’élargit, pour respirer un peu plus haut. » Et c’est dans le mouvement même de cette fidélité à une recherche existentielle qu’il aide ses lecteurs à vivre, à respirer eux aussi un peu plus haut. Jacques de Bourbon Busset a consacré à L’Exode (1980), le dernier livre de Sulivan, écrit un an avant sa mort, une belle préface, qui constitue une