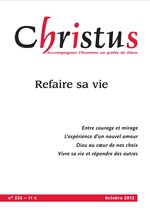Philippe Charru s.j. Centre Sèvres, Paris.
A récemment publié : L’esprit créateur dans la pensée musicale de Jean-Sébastien Bach (avec C. Theobald, Mardaga, 2002), Voici l’Homme. Au carrefour du Miserere de Georges Rouault et de la Via Crucis de Franz Liszt (avec V. Fabre, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2006) et Quand le lointain se fait proche : la musique, une voix spirituelle (Seuil, 2012).
Dernier article publié dans Christus : « L’écoute, une voie spirituelle » (n° 223, juillet 2009).
Il se trouve que des prêtres, des religieux et des religieuses quittent un jour leur ministère ou leur congrégation des années après s’y être engagés à vie. Selon les responsabilités qu’ils exercèrent, leur départ peut passer inaperçu ou au contraire avoir un retentissement ecclésial et social plus ou moins grand. Certains s’en scandalisent, d’autres s’en étonnent ou en souffrent, d’autres encore font preuve de compréhension. Beaucoup y voient aujourd’hui un symptôme de plus d’une Église qu’ils estiment en crise sinon en voie de disparition.
On ne cherchera pas ici à analyser les raisons de ces départs, encore moins à porter un jugement. Le respect des personnes et la complexité des itinéraires toujours singuliers, comme l’extrême diversité des situations institutionnelles, invitent à la prudence et mettent à mal toute généralisation hâtive. Par ailleurs, on ne saurait ramener au seul plan sociologique, psychologique ou juridique, ce qui représente un débat de