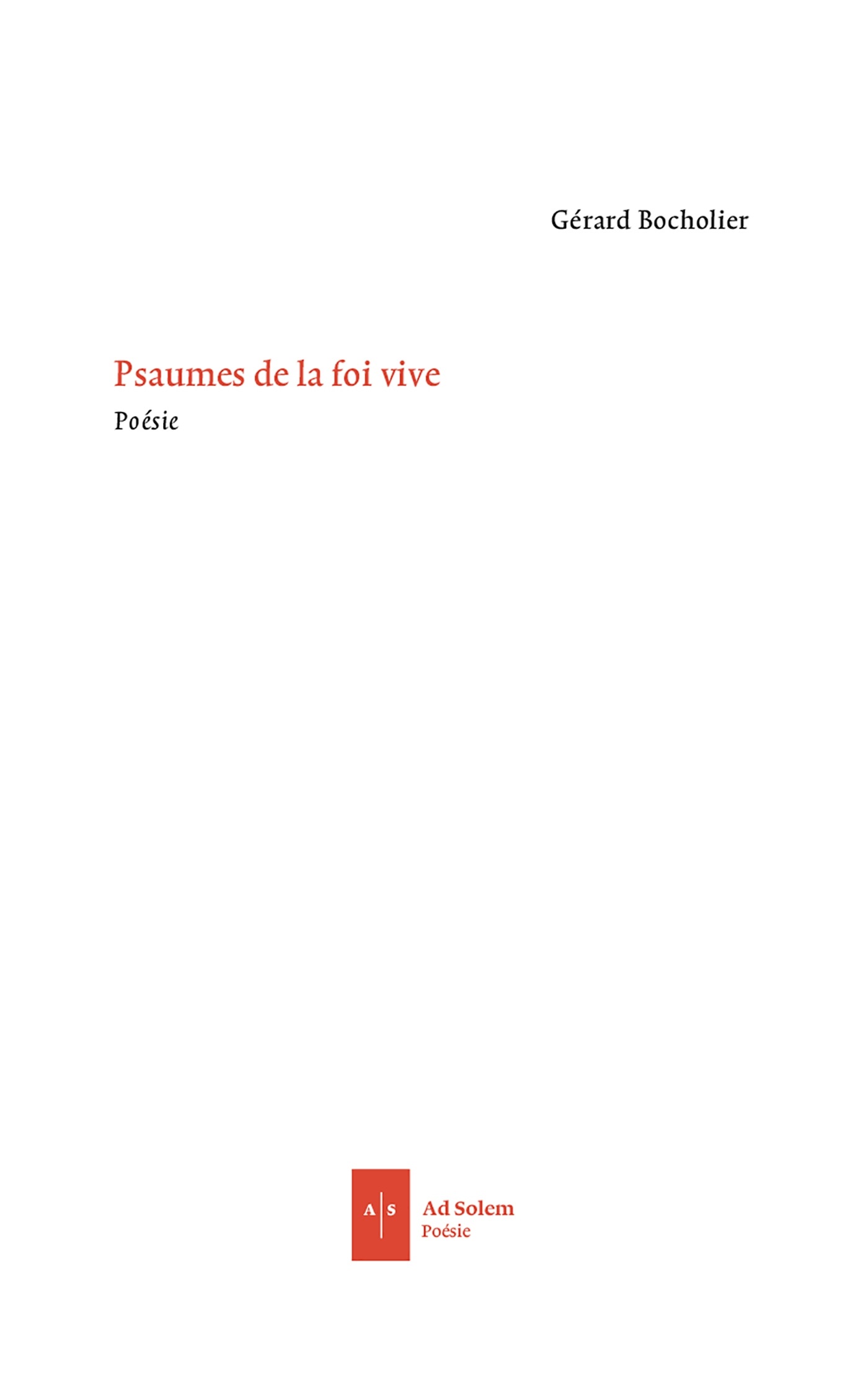Ce dernier livre de « psaumes » (pour le moment, car rien n'indique un tarissement de cette eau vive) vient couronner une trilogie qui avait commencé avec les Psaumes du bel amour (Ad Solem, 2010) et s'était poursuivie avec les Psaumes de l'espérance (Ad Solem, 2012). C'est la même voix qui continue, fluide, murmurante, au rythme d'heptasyllabes (chers à Paul Verlaine), groupés en quatrains. Pas de ponctuation mais une voix mesurée, donc, où se marient le pair et l'impair, et dont rien ne semble devoir interrompre ou altérer la discrète musicalité. Dans ce troisième livre, ses inflexions se font plus persuasives encore que dans les précédents, comme si nous entendions le ruisseau plus près de sa source.
Il n'est pas toujours aisé de distinguer ce qui, dans ces Psaumes de la foi vive, relève du « bel amour », de « l'espérance » ou de la « foi vive ». À vrai dire, leur lecture nous invite à nous défaire d'une idée préconçue de la foi qui l'associerait à une tension vers ce qui nous échappe, à un effort pour rester fidèle malgré l'absence, pour croire dans les déserts de l'âme. Ici, on est plutôt entraîné par le naturel du dialogue avec une Présence qu'on ne retient pas, mais dont le passage a bien « lieu », traversant « Village / Vignes jardins et vergers », éveillant dans son sillage toutes sortes de sensations spirituelles. La nature, les fleurs particulièrement, la maison servent tantôt de décor, tantôt de métaphores à cette Présence (« Tu es […] / La pluie au cœur du jasmin ») ; roses, lys mais aussi ronces retrouvent parfois le rôle qui était le leur dans la poésie baroque. Le visiteur divin auquel on s'adresse a bien un corps (« Pose ta main sur ma nuque » ; « Sur tes genoux ô délice / Je vais m'endormir en paix » ; « Dans la nuit je sens tes lèvres / De jasmin sur mon épaule »), corps invisible mais mystérieusement sensible (le toucher semble être ici le sens privilégié).
Ces effleurements d'un corps sont rattachés par l'emploi du tutoiement à un interlocuteur véritable. L'âge venant, le poète (qui accompagne la célébration des funérailles dans sa paroisse) anticipe la rencontre où son âme se retrouvera « entre [les] mains de clarté » de son Sauveur.
L'autre médiation qui permet au poète de dialoguer avec son Dieu, c'est l'Écriture. Les poèmes sont tissés de fils évangéliques que discerne un regard averti. Gérard Bocholier a ses préférences : la parabole des ouvriers que le maître envoie successivement travailler à la vigne (le poète se reconnaît dans les derniers, qui reçoivent un salaire inattendu), les récits de la Passion et de la Résurrection (où il privilégie l'épisode des pèlerins d'Emmaüs). Dans ces poèmes inspirés de l'Évangile, on est frappé par l'alliance d'un concret souvent minuscule et du mystère. De la scène où Marie Madeleine prend Jésus ressuscité pour le jardinier, nous ne voyons qu'un détail : « Un râteau dans une allée / Vibrait les dents vers le ciel. » Tout reste allusif. Aucune mise en scène, aucune « figuration ».
Nous épousons le point de vue de Marie Madeleine ou de l'aubergiste d'Emmaüs sans qu'ils soient nommés. Nous participons ainsi plus intimement au mystère et n'avons pas besoin de nous transporter ailleurs que dans notre propre vie. Cette familiarité avec le divin, qui prend pour ainsi dire une odeur de campagne, fait penser à Jean Grosjean. Un vers semble d'ailleurs faire écho au titre d'un recueil de ce grand aîné : « La rumeur de ton cortège ».
La recommandation de l'Apôtre, « Priez sans cesse », qui nous paraît quelquefois peu réaliste, devient, à la lecture de ces poèmes, accessible, presque facile. Si Jean Grosjean nous introduisait dans l'intimité du dialogue entre le Père et le Fils (Dominus Domino), Gérard Bocholier, docile au souffle de l'Esprit qui traverse ses journées, nous aide à nous adresser au Fils avec la tendresse du disciple qui reposait sur son cœur : « Ô j'ai eu si peu de forces / Pose ta main sur ma nuque / Que je ne manque ni l'ombre / De ta croix ni l'incendie. »