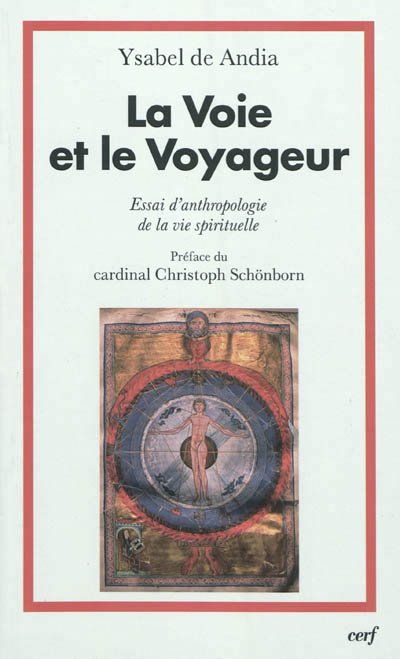Dans le précédent numéro de Christus (pp. 496-498), Dominique Salin célébrait avec enthousiasme et avec combien de raison l’ouvrage de Christian Belin, Le corps pensant, qui ouvrait la voie à une nouvelle manière de proposer une anthropologie spirituelle. L’ouvrage que nous offre Ysabel de Andia – une somme de plus de mille pages – ne lui fera pas concurrence, mais n’en constitue pas pour autant un complément. Avec Chr. Belin, notait D. Salin, on était « loin des déductions dogmatiques et aristotéliciennes qui font habituellement la trame des traités de spiritualité ». Ce n’est sans doute pas la voie qu’aura suivie Ys. de Andia, trop acquise qu’elle est à la cause platonicienne, mais l’on a affaire à un traité et donc à cette autre manière de concevoir et de constituer une anthropologie spirituelle. Ce traité ne cache rien de ses origines : un cours professé à l’École cathédrale de Paris sur les étapes de la vie spirituelle et l’on retrouve avec bonheur toutes les qualités d’un travail académique : un souci d’exhaustivité, un ordre clairement structuré, animé par le dynamisme de la figure de l’homo viator, une thématique permanente de l’expérience spirituelle chrétienne, du pèlerin en route (in via) pour la patrie définitive (le Royaume eschatologique) à la vie voyagère, caractéristique du Verbe incarné, selon Bérulle. Voilà qui est appréciable et prometteur, et pourtant les limites n’en apparaissent pas moins rapidement. En effet, si le plan est clairement trinitaire, le souci encyclopédique d’intégrer toutes les richesses de l’expérience oblige à développer la pneumatologie et à placer sous sa gouvernance non seulement l’expérience mystique mais aussi la pratique ascétique. Certes, ce choix est heureux à bien des égards, mais il en résulte non pas tant un déséquilibre des proportions (près de la moitié de l’ouvrage) qu’un essoufflement du vif élan qui le portait jusque-là. Suffira-t-il alors d’en appeler à la référence de l’amour ? Mais Dieu sait si la période moderne – dès la controverse entre Bossuet et Fénelon à la fin du XVIIe siècle, pour ne rien dire des débats qui agitèrent notre XXe à la suite de la crise moderniste ! – aura débattu de la nature et de l’expérience de l’amour, notion qui, à tout le moins, ne va pas de soi ! Or, on ne peut que le regretter, l’ouvrage ne fait nullement écho à ces moments décisifs de l’histoire de la spiritualité.
Cela ne gênera évidemment pas l’étudiant qui puisera dans ces pages de quoi élargir ses connaissances voire aiguiser sa curiosité ; ni l’enseignant qui trouvera réunies toutes les références souhaitables ainsi que des développements fort propices à l’établissement de sa propre pensée. En revanche, l’ouvrage sera-t-il utile à quiconque voudrait approfondir sa propre vie spirituelle et en éclairer voire guider sa propre expérience intérieure ? Rien n’est moins sûr. D’autant plus que la logique du traité qui accumule connaissances et informations ne répond pas forcément à la logique de l’expérience, telle que la développent les écoles de spiritualité. Qu’est-ce donc qui nous laisse insatisfait dans une entreprise aussi magistrale ? Sans doute une insuffisante prise en compte de l’historicité de l’expérience spirituelle. Il est en effet toujours quelque peu problématique d’aligner au fil des citations – et donc des expériences et des siècles qui se succèdent, voire s’enchaînent – des points sans doute déterminants, des notions assurément capitales, qui structurent l’expérience spirituelle, et de sembler croire que ce sont là des invariants dont la signification et le contenu restent harmonieusement identiques d’un siècle à l’autre, déterminés par la matrice platonicienne du scénario exitus/reditus (sortie de Dieu/ retour à Dieu). Ce qui explique peut-être les rares allusions dans cet ouvrage à notre modernité qui s’inscrit dans un autre horizon métaphysique et culturel, lequel fait meilleur cas de la contingence, c’est-à-dire de ce qu’est capable de créer et de susciter la liberté aussi bien divine qu’humaine.
On appréciera cependant la présentation de ce qui jadis relevait de l’ascétique ou, si l’on préfère, du travail sur soi et de la pratique spirituelle. Une pratique onéreuse (combat spirituel) qui vise à une intériorisation, stimulée et gardée par la vigilance et le discernement éclairé d’un père spirituel, à même de favoriser la juste connaissance de soi (sans complaisance ni dépréciation morbide et factice) et donc de discriminer dans les mouvements de l’âme ce qui lui est propre et inaliénable (l’image de Dieu), mais aussi ce qui lui est étranger, qui obère et ternit la ressemblance. Une aide d’autant plus précieuse que le voyageur trace sa route dans l’alternance enchevêtrée des consolations et des désolations. Dit autrement, si nous considérons notre temps présent, nous constatons que c’est sous les espèces de l’ennui, de l’amertume et du dégoût que nos contemporains connaissent ces mêmes désolations qui naguère accablaient celles et ceux qui s’engageaient sur le chemin de perfection. Ainsi relaient-ils l’acédie des moines de jadis, et le symptôme le plus éloquent en est leur permanente et frénétique envie de déménager (parodie et caricature du voyage intérieur) ; mais ils n’en requièrent et n’en exigent pas moins furieusement les consolations de l’âme et de l’esprit. C’est évidemment dans la prière où s’entrelacent le parler et le silence que ces épreuves sont les plus manifestes.
Ainsi l’allure de cette anthropologie, toute nourrie qu’elle soit – mais aussi parce qu’elle est nourrie – de l’héritage antique et patristique, est résolument personnaliste, mais d’un personnalisme avant tout préoccupé d’un perfectionnement de soi, arrimé à ce « Pas sans Toi ! » cher aux mystiques médiévaux. Hélas, le « Pas sans les autres ! » ne trouve que malaisément sa place dans cette dynamique spirituelle dont la dimension sociale (je n’ose dire : politique) est quelque peu absente. Pourtant, l’évocation en finale de l’horizon eschatologique aurait pu permettre de souligner cette fécondité éthique de l’expérience spirituelle chrétienne.
FRANÇOIS MARXER