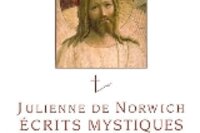Dans sa fresque consacrée au Grand Siècle mystique, Henri Bremond n’avait retenu, de la postérité de saint François, que quelques ténors. Cette publication rétablit les proportions. En 1680, ils étaient quelque cent mille dans le monde – conventuels et surtout observants (cordeliers) : déchaux, réformés, récollets, capucins, clarisses, minimes et membres des Tiers Ordres – à vivre de « l’esprit » de saint François (sa « spiritualité », comme nous disons aujourd’hui). L’intérêt de cette édition est d’offrir un florilège significatif, encadré de notices historiques. La présentation globale de l’historien Pierre Moracchini, en particulier, permet de voir clair dans la présence et le rayonnement à Paris de la grande famille franciscaine, à la généalogie si compliquée (t. 3, pp. 63-165).
Le florilège se reconnaît « lacunaire », par la force des choses. L’éditeur a voulu présenter des « extraits sensibles au coeur » (t. 1, p. 11). C’est dire qu’il ne s’est pas soucié d’une définition rigoureuse de ce qu’on peut entendre par « mystique » au XVIIe siècle. Il suffit que ces textes reflètent une vraie ferveur et qu’on y retrouve des échos, non seulement de Bonaventure et de Hugues de Balma, mais de la mystique médiévale en général, flamande surtout, via Harphius, la Perle évangélique, Osuna (le maître de sainte Thérèse) et d’autres. Ce florilège écarte donc les « textes ascétiques introductifs » à la vie spirituelle ou préoccupés par la description des « phénomènes » paranormaux (p. 14).
On pourra chicaner D. Tronc sur ses étiquetages parfois artificiels (« mystique quiétiste », « école du coeur », « école du pur amour »). Son grand mérite est de donner accès à des textes inédits (à propos de Catherine de Bar par exemple), rares ou difficilement trouvables. Leur abondance et leur répétitivité même manifestent la perméabilité, au XVIIe siècle encore, des courants spirituels. Les familles religieuses, alors, ne se souciaient guère de marquer « leurs » territoires, elles ne craignaient pas de puiser aux mêmes sources et, parfois, de se piller joyeusement les unes les autres.
Le florilège se reconnaît « lacunaire », par la force des choses. L’éditeur a voulu présenter des « extraits sensibles au coeur » (t. 1, p. 11). C’est dire qu’il ne s’est pas soucié d’une définition rigoureuse de ce qu’on peut entendre par « mystique » au XVIIe siècle. Il suffit que ces textes reflètent une vraie ferveur et qu’on y retrouve des échos, non seulement de Bonaventure et de Hugues de Balma, mais de la mystique médiévale en général, flamande surtout, via Harphius, la Perle évangélique, Osuna (le maître de sainte Thérèse) et d’autres. Ce florilège écarte donc les « textes ascétiques introductifs » à la vie spirituelle ou préoccupés par la description des « phénomènes » paranormaux (p. 14).
On pourra chicaner D. Tronc sur ses étiquetages parfois artificiels (« mystique quiétiste », « école du coeur », « école du pur amour »). Son grand mérite est de donner accès à des textes inédits (à propos de Catherine de Bar par exemple), rares ou difficilement trouvables. Leur abondance et leur répétitivité même manifestent la perméabilité, au XVIIe siècle encore, des courants spirituels. Les familles religieuses, alors, ne se souciaient guère de marquer « leurs » territoires, elles ne craignaient pas de puiser aux mêmes sources et, parfois, de se piller joyeusement les unes les autres.
Dominique Salin