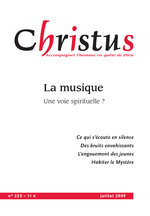La musique sert et accompagne la liturgie. Elle la seconde, comme la liturgie est seconde par rapport au Christ. Porte-Parole, elle voudrait pouvoir désigner quelque chose de son mystère, contribuer à le faire connaître, aimer et advenir. Pour cela, il lui faut d’abord convenir au geste ou au temps liturgiques auxquels elle est destinée, et être en mesure de mobiliser spirituellement une assemblée – l’enthousiasmer au sens étymologique du terme 1. Nous pouvons demander au chant qu’il nous tienne haut dans notre âme tout autant qu’agenouillés aux pieds du Verbe qui nous parle.
Habiter le Mystère
Si la musique sert la liturgie, c’est en habitant le Mystère qu’elle célèbre, dans sa double dimension d’intériorité et de transcendance. Elle permet alors la construction et l’expression de la foi personnelle et communautaire. On la voudrait simple, mais la simplicité est peut-être une des choses les plus difficiles à