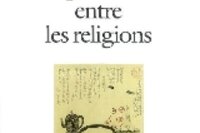« Et maintenant, vous nous entendez1 ? » Inscrit en lettres capitales sur un mur de Minneapolis en mai 2020, après les émeutes suivant la mort de George Floyd, ce simple tag résume bien des colères de notre monde d'aujourd'hui. Au-delà des seules revendications des noirs américains, encore victimes de nombre de discriminations, il exprime par ces mots le cri d'une souffrance qui ne peut s'exprimer que par des réactions violentes. Il jette à la face d'une société son incapacité à répondre à l'injustice. Jusqu'où devons-nous aller pour que vous vouliez bien nous entendre, enfin ? Jusqu'où ?
Si, voici près d'un siècle, Steinbeck pouvait écrire Les raisins de la colère (1939) pour faire écho à la voix des fermiers victimes de la crise, il s'agit pour nous désormais de mieux percevoir les appels de ceux qui ne peuvent se faire entendre que par l'excès d'un cri. Comprendre ces colères invite nécessairement à poser sur elles un diagnostic renouvelé, pour y faire la part d'ambiguïté et d'authenticité. Au carrefour du collectif et de l'intériorité, de telles expressions ne peuvent trouver une issue que si des voix les médiatisent, pour mieux trouver des chemins d'incarnation et de justice.
Vivons-nous vraiment le temps des colères, voire « l'Âge de la colère2 », pour reprendre le titre si emblématique de l'essayiste indien Pankaj Mishra ? La réponse oblige d'abord au constat d'un paradoxe. Tandis que les apôtres du développement personnel et de la vie épanouie ne cessent de nous prêcher calme et zénitude, que nombre d'institutions sont censées relayer nos demandes et aspirations, que nous disposons comme jamais de moyens de communication et d'expression, voici que nos sociétés semblent n'avancer qu'à coups de soubresauts et de mouvements d'humeur. Dans des médias où se bousculent sans hiérarchie informations, faits ou opinions, le mot de colère revient en permanence pour désigner les expressions les plus diverses, collectives ou individuelles, argumentées ou plus impulsives, voire violentes. Leur seule évocation donne le tournis. Qu'on en juge…
Colère chaude du social, avec le mouvement des « gilets jaunes » en France ou les revendications des soignants. Colère blessée des victimes, celles des violences conjugales, des abus sexuels dans l'Église ou des attentats terroristes. Colère froide d'une Greta Thunberg, mobilisant les jeunes par milliers autour de la question du climat avec une détermination impressionnante. Colère de ceux qui ont jugé les politiques incapables de réagir à l'épidémie du coronavirus… La liste, on le voit, ne cesse de s'allonger, une flambée venant prendre le pas sur l'autre. Sans trop exagérer, on pourrait presque dire que la qualité d'un responsable public aujourd'hui se mesure davantage à sa capacité de faire face à de tels mouvements attendus ou plus imprévisibles, qu'à penser à long terme. Comme s'il fallait gérer les émotions du présent, au détriment d'un travail de raison plus construit et patient.
Si bien des sociologues tentent d'analyser ce trait3, voire s'inquiètent de la marginalisation de pans entiers de la population ou du risque de populisme, Mishra n'hésite pas, quant à lui, à voir dans la colère la clé de « l'histoire du présent4 ». Comment expliquer les nombreuses poussées de violences que nous connaissons : flambées terroristes, montée des nationalismes, fanatismes religieux, pressions populistes au sein des démocraties les plus vénérables ? Remontant aux intuitions de Rousseau qui pointait déjà les dangers d'un libéralisme guidé vers le seul enrichissement personnel, Mishra voit dans la culture du ressentiment la cause de tous ces maux. Car ce ressentiment traduit tout à la fois l'individualisme de nos sociétés et une forme de « mimétisme appropriatif », qui pousse des individus à désirer en permanence ce qu'ils n'ont pas. Autant d'aspects qui ne cessent de nourrir humiliation et frustration, alimentant la colère et une forme de « guerre civile mondiale ».
Si le diagnostic de Mishra est incontestablement à prendre en compte, qui vise les ambiguïtés de bien des revendications actuelles et critique l'héritage intellectuel des Lumières et de la pensée occidentale, il reste qu'il ne doit pas faire oublier l'authenticité de nombre de cris de sans-voix. Car, à côté du seul ressentiment, du seul désir égoïste, la colère qui gronde peut révéler en effet de réelles fractures au plan social ou culturel, avec toute une souffrance et un sentiment d'injustice qui n'arrivent pas à vraiment s'exprimer. On a pu souligner combien le mouvement des « gilets jaunes », en dépit de ses inévitables ambiguïtés, portait aussi en lui de justes demandes de reconnaissance, de convivialité et l'expression d'un vrai malaise social, d'un sentiment de déclassement et d'humiliation de la part des populations rurales ou des classes moyennes. Sans nécessairement toujours illustrer les caprices de l'individu contemporain, qui a de plus en plus de mal face à l'autorité, face à une règle dictée de l'extérieur, ce ressentiment traduit aussi l'extrême psychologisation de ses comportements. Par le mouvement d'humeur, par l'excès et la démesure, j'exprime ce qui ne peut plus être dit selon moi par la raison. Partagée avec d'autres, lâchée dans la rue ou sur un rond-point, la fureur va me faire du bien en me défoulant, en libérant des énergies trop longtemps étouffées.
Pour compléter, signalons deux autres traits qui marquent cet Âge de la colère. D'abord, le fait que bien des médiations institutionnelles ne fonctionnent plus – syndicats, partis politiques ou Églises le constatent au quotidien – pour relayer et traiter les frustrations qui s'expriment. Aux institutions existantes, impuissantes et comme dépassées, il faut ajouter sans cesse commissions, comités, consultations diverses créées pour répondre aux attentes d'une opinion toujours insatisfaite. Cette crise de la représentation, si elle n'est pas nouvelle, ne cesse de s'approfondir : évoquons encore les « gilets jaunes » pour rappeler qu'ils se sont montrés incapables de désigner des représentants pour parler en leur nom, les quelques leaders qui pouvaient émerger étant immédiatement récusés. Comme si l'autre se révélait incapable de ressentir et d'exprimer ce que je ressens, et donc de me représenter. Il devient difficile alors de faire remonter des attentes légitimes.
À cette crise de la représentation s'ajoute un profond manque d'incarnation. Comment ne pas rappeler ici le film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake (2016), peinture crue et terrible de la misère sociale en Grande-Bretagne, avec son triste chapelet de femmes seules, de chômeurs, de vieillards et de malades ? Voulant faire reconnaître ses droits sociaux, en proie à des problèmes de santé, l'ouvrier Daniel Blake ne cesse de se heurter à des répondeurs téléphoniques, des administrations froides, des numéros de téléphone qui sonnent dans le vide. Je pense aussi à cette religieuse de mes amis qui lutte pour des familles roms en extrême précarité. Elle ne peut cacher non plus sa colère lorsque toutes les portes se ferment – État, élus locaux, Église, presse… Comment se faire entendre, là aussi ? Dans une culture qui fait une large part au virtuel, où il est souvent difficile d'avoir un interlocuteur en direct, la parole humaine vient buter contre la voix métallique du robot. Or, la souffrance a besoin de chair pour s'exprimer, l'expression de la colère passe par le corps et les expressions du visage, comme le rappelait Jean Sarocchi5 dans un livre toujours suggestif.
Évoquant à grands traits ces soubresauts collectifs, nous avons croisé l'individu. N'est-ce pas dans sa condition même qu'il faut chercher aussi la source de nos colères ? Il commence fort tôt dans nos itinéraires biographiques, ce compagnonnage avec le mouvement colérique, dans ces premiers moments de la vie où nous éprouvons le manque et la frustration, où, tout-petit, la nourriture ne vient pas assez vite, où la douleur d'une dent ou d'un ventre ne peut s'exprimer que par le cri, par ce hurlement déployé. Quand le langage manque encore, comment ne pas passer par l'excès, pour que soit rétablie une situation de satisfaction et de calme ? Un peu plus tard, la colère va se faire trépignement, irritation devant ce que l'on nous refuse ou ce qui ne nous plaît pas. Parfois, cependant, le refus peut se faire blessure, amour déçu, et le baiser refusé au début de La Recherche (1913-1927) au petit Marcel Proust restera longtemps dans sa mémoire.
Dès nos premières années et pour longtemps, la colère va donc venir révéler notre fragilité, ce moment où nous butons violemment contre nos propres limites. De plein fouet, nous nous cognons contre notre impuissance, nous nous sentons à l'étroit ou par trop vulnérables face à l'adversité. C'est notre légitime révolte de malade à qui l'on donne un pronostic défavorable, celle de notre vieillesse devant ce corps qui ne répond plus comme avant. C'est cette rage qu'exprimait sur les réseaux sociaux le père Jean-Marc Barreau, accompagnateur de personnes en fin de vie à Montréal, face à tant de malades mourant de la Covid-19 alors qu'on ne pouvait rien faire pour eux6. C'est aussi, bien sûr, notre découverte épouvantée devant le mal que nous faisons et le bien que nous n'arrivons pas à accomplir, comme le reconnaît saint Paul dans l'une de ses lettres : « Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas » (Romains 7,19).
Pour autant, si la colère signe la marque d'une passion inquiétante, voire d'un péché comme pour cette jalousie qui conduit à la haine du frère, si finement décrite par saint Augustin dans ses Confessions (397-401), elle peut aussi apparaître comme une énergie positive, une saine réaction de défense face à un agresseur. Devant une menace, une force de mort peut-être, elle se révèle être ce sursaut qui, une fois maîtrisé, va se montrer salutaire. Nous voici alors placés là face à une émotion qui appelle une attention renouvelée, une vigilance qui tient du combat spirituel, car cette pulsion émotionnelle exprime sans doute une attente plus profonde, l'authentique demande née d'une souffrance. Oui, il y a parfois de justes courroux et de saintes colères.
Mais alors, sommes-nous donc tant en manque de médiateurs, de passeurs ou de prophètes que les cris de nos contemporains ne puissent plus se faire entendre ? Qu'avons-nous fait de nos saintes colères, personnelles ou plus collectives ? Sommes-nous devenus incapables d'écouter les appels de l'Esprit, ceux des pauvres et des oubliés, mais aussi impuissants à les médiatiser ? Car, si l'on veut que toutes ces colères puissent trouver une issue, une formulation positive, l'ouverture à un dialogue et des alliances possibles pour plus de justice, alors des voix sont nécessaires pour les porter en vérité.
À sa manière, le succès posthume d'Albert Camus, et pas seulement à cause de La peste (1947), traduit bien ce besoin actuel de voix qui portent, qui s'offrent à plus large qu'elles. Dans L'homme révolté (1951), Camus souligne combien, pour lui, « la révolte est, dans l'homme, le refus d'être traité en chose et d'être réduit à la simple histoire7 ». Rédigées durant l'Occupation, ses Lettres à un ami allemand8 insistent également sur cette légitime colère, à travers la nécessaire résistance face à une puissance d'oppression, au nom des valeurs supérieures de fraternité. Mais, à côté du propos humaniste de Camus, comment ne pas rappeler, sans nostalgie, que nombre d'écrivains catholiques se sont fait aussi les tenants d'une sainte colère qu'il pourrait être pertinent de réactiver aujourd'hui ? À cause de la tradition prophétique sans doute, du souffle biblique, il y a chez eux comme un tropisme du mouvement d'humeur au nom de l'Évangile, sursaut salutaire qui a pu permettre à certains moments d'alerter une opinion trop assoupie face à des injustices et des souffrances cachées. Chacun à leur manière, insupportables et truculents parfois, Bloy, Péguy, Bernanos ou Mauriac continuent de nous rappeler combien le cri d'une femme pauvre9, l'injuste condamnation d'un capitaine juif innocent, l'imposture du religieux lié à une dictature ou la souffrance d'un homme torturé sont insupportables. « J'ai juré de vous émouvoir par amour ou par colère… Je vous offre un livre vivant », écrivait en ce sens le jeune Bernanos. Mais nous, aujourd'hui, pourtant si friands de communication ou de réseaux sociaux, de « posts partagés », savons-nous émouvoir par amour et par colère, pour alerter sur le sort des sans-papiers, la détresse des familles blessées, le drame des suicides ou des laissés-pour-compte de l'économie ?
Voici quelques années, on s'en souvient, l'ancien diplomate et déporté Stéphane Hessel avait invité les jeunes générations à s'indigner face aux nouvelles inégalités sociales ou économiques, entraînant un mouvement qui eut un réel succès en Europe. À sa manière de vieux sage, il redisait combien la colère, si elle ne veut pas s'épuiser vainement, doit toujours se convertir en une exigence d'engagement ici et maintenant, à travers un retour au réel et un élargissement du regard. Dans son foisonnant ouvrage consacré à ce thème, Sarocchi précise bien en ce sens cette distinction graduelle entre colère et indignation : « L'indignation, c'est la colère quand, délivrée de sa fièvre immédiate et pondérée par la raison, elle n'est pas la riposte nerveuse à une blessure de l'amour-propre ou du corps propre, mais une émotion prenant en compte les intérêts non seulement du groupe local, du clan ou de la nation, mais ceux de l'espèce humaine10. »
Si nous voulons donc que la voix des sans-voix résonne davantage à nos oreilles, casse la cacophonie de sons et d'images qui nous abreuvent, traverse nos écrans et nos opacités intérieures, il nous faut modestement retrouver les chemins de l'incarnation, d'une indignation qui se fait prise en main de ce monde, habitation d'une histoire en train de se faire. N'est-ce pas la limite de notre culture que de nous entraîner trop souvent, pour beaucoup de nos contemporains, dans un imaginaire d'arrière-monde ou face au miroir narcissique des outils numériques ? Sans être dépourvus de talents ou de portée morale, toute une littérature n'a-t-elle pas déserté le terrain de l'Histoire, d'un engagement dans les luttes du temps ? À force d'admirer des superhéros, des nains ou des elfes, nous n'avons plus de témoins capables d'incarner des causes fortes et de donner figures à la colère. Même si nous ne sommes plus au temps des luttes sociales décrites par le Germinal de Zola (1885), il reste que des combats sont toujours à mener pour la dignité et la liberté de l'homme. Qui va leur donner chair ?
Alors oui, à ce prix, nous pourrons méditer en vérité la parole du Dieu d'Israël face à Moïse : « J'ai entendu la misère de mon peuple. » Comme un écho au tag de Minneapolis, à tous les cris des sans-voix.