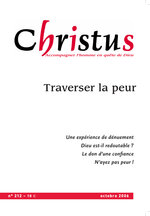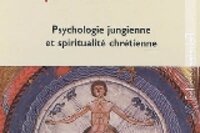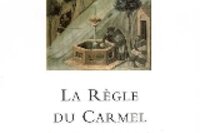À la première page de la Bible, après le péché, Dieu questionne Adam : « Où es-tu ? » Adam répond : « J’ai entendu ton pas dans le jardin ; j’ai eu peur parce que je suis nu » (Gn 3,9-10). Chacun de nous peut faire sienne cette réponse. Car la peur nous ex-pose, c’est-à-dire à la fois nous dénude et nous déplace. Dénuement : les protections interposées entre moi et le monde, entre moi et autrui, entre moi et Dieu, m’apparaissent soudain dérisoires : « J’ai eu peur parce que je suis nu. » Déplacement : quand « j’entre en effroi » 1, je suis déporté hors de mes assises, loin du monde familier. Cela peut être pour fuir : « Je me suis caché. » Mais il arrive aussi que la peur et ses deux compagnes, l’angoisse et la crainte, gardent le seuil des plus hautes aventures spirituelles, du jardin d’Éden au jardin de l’agonie, de l’apôtre Paul au pape Jean Paul II. Car elles sont un lieu privilégié où l’homme peut s’éprouver, selon le mot de saint Augustin, « spirituel jusque dans sa chair, charnel jusque dans son esprit ». Mais par là même elles nous mettent en situation de combat spirituel, dans un drame qui fait de notre devenir temporel, exposé aux menaces de la nature et de la vie sociale, une histoire de péché et de grâce, de conversion et de salut.
Nous qui avions cru que la maîtrise raisonnable du monde nous délivrerait des antiques terreurs, nous en découvrons aujourd’hui de nouvelles formes et de nouveaux motifs. Peut-être y a-t-il là une invitation à réveiller en nous les virtualités spirituelles de la peur, de l’angoisse et de la crainte, à entrer, comme dans une grâce de pauvreté, dans le dénuement qu’elles révèlent, à nous laisser mener par elles là où peut-être nous ne voudrions pas aller, mais où un Autre nous attend : « C’est moi. N’ayez pas peur » (Mt 14,27).
Nous qui avions cru que la maîtrise raisonnable du monde nous délivrerait des antiques terreurs, nous en découvrons aujourd’hui de nouvelles formes et de nouveaux motifs. Peut-être y a-t-il là une invitation à réveiller en nous les virtualités spirituelles de la peur, de l’angoisse et de la crainte, à entrer, comme dans une grâce de pauvreté, dans le dénuement qu’elles révèlent, à nous laisser mener par elles là où peut-être nous ne voudrions pas aller, mais où un Autre nous attend : « C’est moi. N’ayez pas peur » (Mt 14,27).
Peur, angoisse, crainte
La peur ne nous est pas propre ; nous partageons avec le monde animal cette soudaine surprise devant le danger, nous donnant des ailes ou nous clouant sur place, selon la nature de l’agression et notre capacité à y faire face. Mais si la peur est un réflexe du