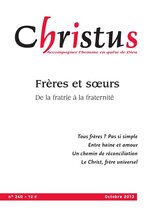C’est dans la vie tumultueuse des fratries que s’initie dans tous les domaines une relation aux autres faite d’attirance, d’amour et d’ouverture, mais aussi de haine et de peur, de frustrations génératrices de blessures et de fermetures. Quel chemin peut s’ouvrir alors pour reconnaître l’autre comme un frère sans céder à un idéal illusoire ? Qu’est-ce qui nourrit en nous cette aspiration constante à rechercher et promouvoir une fraternité plus marquée dans nos relations humaines et sociales ? Nos relations entre frères et sœurs peuvent-elles être vécues comme une expérience spirituelle qui rend crédible l’avènement d’une vraie fraternité entre les hommes ?
Repartons de l’expérience initiale, et jamais totalement quittée, de cette vie en fratrie qui met son empreinte sur nos relations adultes. Il nous sera alors possible d’approfondir ce qui ouvre à la promesse d’une fraternité dans notre relation aux autres, et qui appelle conversion et combat intérieur pour demeurer ouverts à l’Esprit en nous mettant en mouvement vers l’autre, notre semblable.
Frères et sœurs pour la vie
Tel est le titre du récent ouvrage qu’une psychologue, Lisbeth von Benedek, écrit à partir de son expérience analytique des relations entre frères et sœurs. Longtemps regardé à partir de la relation privilégiée à ses parents et des complexes qui en découlent, l’enfant est aujourd’hui perçu et compris aussi comme frère ou sœur, comme membre d’une fratrie avec son empreinte et son histoire propres. Les dictionnaires soulignent le caractère récent de cet intérêt pour ce domaine. Ainsi le Petit Robert signale-t-il que le mot « fratrie », « ensemble des frères et sœurs d’une famille », apparaît vers 1970, avec l’essor des enquêtes démographiques et des sciences humaines.À cette époque correspond aussi le