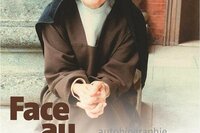Tu as vingt ans et te retrouves au tribunal. Tu conduisais trop vite, ou mal, tu avais bu (un peu) et fumé des pétards (beaucoup). La voiture que tu as percutée a fait des tonneaux et la conductrice est désormais en fauteuil. Elle est là dans les rangs des parties civiles. Tu la vois. Elle pleure. Ton avocat a insisté, il faut que tu lui demandes pardon. Mais tu ne sais pas comment faire et tu pressens bien que les mots que tu vas dire ne pourront rien pour ses jambes. Si tu ne dis rien, ou si tu demandes pardon sans y croire, ta peine en sera peut-être alourdie. Tu veux bien tout, demander pardon comme il faut, mais, au fond de toi, tu sais qu'il y a là de l'impardonnable et celui à qui tu ne pardonnes pas, c'est toi-même. Et tu ne sais que faire de cette injonction de ton avocat, désormais incontournable pour qui se retrouve dans ta situation : « Il faut demander pardon. »
Tu as trente-huit ans. La vie ne t'a pas malmenée. Tu as de beaux enfants, un mari soutenant, une activité professionnelle plutôt épanouissante et, pourtant, en toi, quelque chose semble bloqué, comme si la vie n'arrivait pas à faire son chemin. Une amie t'a invitée à un groupe de prière. Tu y es allée sans grande conviction et voilà qu'un couple s'approche de toi pour prier pour toi ou prier sur toi – tu ne sais plus bien ce qu'ils ont dit – et tu te laisses faire. Dans la discussion, ils te demandent si tu as eu des difficultés relationnelles dans ton enfance, avec ta mère ou ton père. Tu sais bien que la relation avec ta mère n'a jamais été simple, tu avais toujours le sentiment qu'elle te préférait ton frère. Tu le leur dis. Ils te demandent où en est aujourd'hui ta relation avec ton frère. Tu le vois peu, tu le leur dis. Ils te demandent si tu regrettes cela. Oui, tu le regrettes. Et si tu t'en repens. Tu ne sais pas trop. Et si tu pardonnes à ta mère le mal qu'elle a pu te faire. Tu ne comprends pas bien. Ils t'expliquent que, dans ta petite enfance, tu as pu être liée sans en avoir conscience par les forces du mal et qu'une prière de délivrance pourra t'en délier, si tu pardonnes à ceux qui t'ont blessée. Tu essaies de pardonner mais, en rentrant chez toi, tu n'es pas sûre de bien comprendre ce que tu as fait, ni si finalement la difficulté avec ta mère relève de quelque chose qu'il convient de pardonner ou plutôt d'accepter.
Tu as cinquante ans et, depuis dix ans, tu travailles avec une collègue qui est devenue ta meilleure amie. Vous partez en vacances ensemble. Elle est comme toi, très investie dans son Église, très croyante. Mais, un jour, quelque chose dérape, tu glisses sur un mot de verglas qu'elle a posé là un matin. Tu tentes de mettre un mouchoir par-dessus. Mais la même chose se reproduit un autre matin. À la troisième pique, quelque chose en toi se déchire à l'intérieur, tu sens que tout s'effondre. Cette amitié a-t-elle seulement existé ? Sur quoi s'était-elle établie ? Tu en viens à douter de tout. Certes, elle t'a demandé pardon, mais tu te refais le film de votre rencontre, de vos relations, de ses confidences et tu pressens qu'il y a un énorme doute qui s'est insinué depuis longtemps en toi : tu en viens à douter de sa confiance, de ses confidences, et tu constates avec effroi que cette amitié est morte, en petits morceaux sur le sol, toute cassée. Ton conjoint qui vous connaît toutes deux est désemparé : « Mais pourquoi tu n'acceptes pas son pardon ? » Tu ne sais pas comment lui expliquer qu'il n'y a pas à pardonner car, pour l'heure, ce qui est cassé est comme la révélation d'une relation qui n'a jamais été vraie, solide, et que tu ne peux que le constater, le déplorer, mais qu'il n'y a pas à parler de pardon. C'est plutôt du malheur, une sorte de fatalité : ce qui est cassé vous dépasse, elle comme toi, c'est un état de fait. Il n'y a pas de faute. Seulement un grand malheur. Et l'on ne demande pas pardon au malheur.
Les vignettes ci-dessus pourraient être multipliées à l'infini, de la plus anodine à la plus grave. Nous avons tous en tête des pardons offerts non reçus, des pardons espérés et non offerts, des pardons faciles qui nous ont fait grandir, des pardons impossibles, des pardons imposés, des pardons maladroits, des pardons destructeurs. L'injonction « il faut pardonner » peut vite virer au désespoir et à la culpabilité quand le pardon n'est pas possible.
Le plus grand danger serait de faire du pardon un moyen. Un moyen pour aller mieux, un moyen pour « passer à autre chose », un moyen pour « se soulager la conscience ». Le pardon ne peut pas être un moyen, sinon il devient effectivement une « arme de soumission », voire de « destruction ». Il a sa fin en lui-même, et c'est peut-être cela qu'il nous faut préciser.
Le mot « pardon », en français, vient du latin perdonnare, « donner complètement ». Le pardon est un don. D'où une première question : qu'est-ce que l'on donne quand on pardonne ? Ce que l'on donne, je crois, c'est une parole, mais pas n'importe quelle parole, une parole efficace car, au moment où je dis : « Je te pardonne », le pardon a lieu. C'est une parole dans laquelle toute l'existence est prise. Si un homme ou une femme pardonne authentiquement, toute sa parole est donnée dans le pardon qu'il ou elle donne, et toute sa vie est donnée avec cette parole. Nous avons coutume de considérer que le pardon n'est ni l'excuse, ni l'oubli. Le pardon, c'est donner au cœur même de la déception et de la douleur, se donner malgré tout. Se remettre à nouveau entre les mains de l'autre pour que la vie poursuive sa route et que le mal subi ne vienne pas la freiner.
Dans le même esprit, un des mots grecs pour pardonner est charizomai, « faire grâce ». Le pardon est gratuit, il n'est jamais un calcul. Et l'on pourrait dire du pardon ce que saint Paul dit de la charité : « Le pardon prend patience, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout » (cf. 1 Co 13, 4-7). Mais, de ce fait, il n'est pas possible de faire injonction de pardon. Nul ne peut dire à son frère : « Mais maintenant, tu pourrais pardonner, non ? » Car le temps de mon frère, de ma sœur, n'est pas le mien, et le temps nécessaire pour au moins désirer un pardon gratuit peut être légitimement très long. Parce qu'il est la charité même, le pardon est fragile, et vouloir le provoquer l'abîme et le dénature.
Pour qu'il y ait pardon, encore faut-il qu'il y ait justice, il faut nommer le mal, le regarder en face : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », dit le psaume 84. À ce sujet, le Nouveau Testament nous donne au moins deux critères de ce qu'est la justice. Le premier critère du pardon de Dieu, nous dit Jésus, c'est la manière dont nous avons traité les « plus petits de ses frères ». Dans son évangile, Matthieu, au chapitre 25, annonce que le Jugement dernier est un jugement des œuvres et qu'il concerne notre attitude envers ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui ont besoin d'être nourris, abrités, habillés. La parabole se conclut par cette phrase terrible : « Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel ; et les justes, à la vie éternelle » (Mt 25, 46). Il faut entendre la leçon de ce texte : il y a des négligences qui sont ni plus ni moins des œuvres impardonnables. En s'adressant à un groupe, Jésus rappelle d'ailleurs que nous pouvons être collectivement coupables d'œuvres impardonnables. Le second critère est celui mis en lumière par l'avertissement de l'apôtre Jacques : « Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe [littéralement : se glorifie] du jugement » (Jc 2, 12-13). Nous ne pouvons pas à la fois réclamer un pardon inconditionnel pour nos fautes et traiter durement, par le silence ou le mépris, celui qui, à côté de nous, nous demande de lui pardonner. Pour parler clairement : si l'Église que nous formons tous ensemble, laïcs et clercs, donne des leçons de morale à ceux qui la regardent de loin et implore la miséricorde quand un de ses membres est coupable de délit ou de crime, elle pourrait bien (et là encore il s'agit d'un péché collectif) tomber sous le coup d'un jugement sans miséricorde.
Après les attentats de Charlie Hebdo en 2015, le premier dessin de Luz fut un Mahomet qui pleure, portant comme titre « Tout est pardonné »2. Sans vouloir récupérer ni l'auteur, ni Charlie, ce dessin bouleversant m'a fait l'effet d'une Une « christique », tant je suis convaincue qu'il n'y a qu'un pardon véritable, dans lequel tous les autres sont inclus, les pauvres, les maladroits… Inclus, portés, assumés, redressés, sauvés. Comment écrire « Tout est pardonné » à ce moment-là ? Y compris si c'est « pour rire » comme le dit l'équipe de l'époque. Comment écrire cela, sinon en puisant dans l'inconscient collectif occidental, christianisé, même si, aujourd'hui, il ne le sait plus ?
Je crois, oui, qu'il n'y a qu'un pardon, celui que le Christ sur la croix demande à son Père d'offrir à ceux qui l'ont conduit là. Élevé de terre, comme autrefois le serpent d'airain, déposé à la place du serpent, le Christ crucifié comme un bandit prend la place du maudit. Ce faisant, il porte seul sur ses épaules la malédiction et détache de la vie des hommes toute forme de malédiction, y compris celle du mal subi et du mal commis, car il est déposé à la place des méchants. Il se tient avec eux, de leur côté, lui, l'innocent par excellence. « Celui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu » (2 Co 5, 21). Lui seul peut tenir cette place en vérité. Lui seul peut « détruire le mur de la haine » qui sépare les uns des autres, les Juifs des Grecs, les femmes des hommes, les esclaves des hommes libres, les victimes des bourreaux. « C'est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine » (Ep 2, 14). Si, par grâce, l'un de nous peut un jour, lucidement, donner à son frère ou à son persécuteur un pardon véritable, ce ne peut être qu'en Christ, à l'intérieur de l'espace qu'il a ouvert une fois pour toutes. « En sa personne, il a tué la haine » (Ep 2, 16).
Mais nous, comment pardonner ? Il y a fort longtemps, j'avais eu la chance de lire le très petit texte de Maurice Bellet, Incipit, qui se terminait par ces mots :
Il en va de même du pardon. Tu peux, dans la nuit, te trouver en toute honnêteté dans l'impossibilité de pardonner et peut-être peux-tu désirer pourtant pardonner ? Mais si tu es dans l'impossibilité de désirer pardonner, tant la blessure est amère et profonde, alors qui sait, peut-être peux-tu désirer de désirer pardonner un jour ? Et ce désir-là, parce qu'il est humble, pauvre et authentique, parce qu'il renonce à la vengeance, est le véritable pardon qui germe dans ton cœur, enraciné dans l'unique pardon qui soit, celui que le Christ, non entamé par la haine, a offert à tous ceux qui voulaient s'y glisser.
La grande ténèbre qui survient à la sixième heure enveloppe les trois longues heures de l'agonie du Fils, où l'on n'entend plus rien, sinon la mort qui vient. Elles enveloppent le larron, celui de droite et celui de gauche, celui qui se moque et celui qui supplie, celui à qui la tradition a donné un prénom, Dismas, et l'autre, figure du refus. Mais qui écoute attentivement l'autre larron – le mauvais, celui qui se moque – peut pourtant entendre comme une petite voix qui n'est pas que moquerie : « Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Ce « nous » du « et nous avec » ouvre une microbrèche, un coin dans la masse de marbre de son cœur, et peut-être ce coin sauve-t-il tout. Il n'y a pas d'homme condamné.