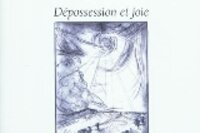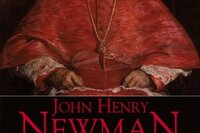Cerf, « La nuit surveillée », 2009, 153 p., 18 euros
En ces temps de crise et de « prospérité du vice », on trouvera dans ce petit ouvrage motifs d’admiration et raisons d’espérer. Simone Weil, en effet, dessine les objectifs spirituels d’une politique qui conjoint amour de la patrie (considérée comme trésor de l’âme, loin de tout nationalisme) et une ambition européenne, délivrée du culte de la force dont le colonialisme est la triste démonstration. Elle pointe le mal (irréparable ?) commis par la modernité : le déracinement qui accable tant la classe ouvrière que le monde paysan, faisant de l’humain, comme elle a pu en faire l’expérience, un exilé ayant perdu estime de soi et sens de la responsabilité. D’où l’urgence de penser et de mettre en oeuvre une philosophie du travail qui réalise l’adéquation de la pensée et de l’action. Il s’agit ainsi de retrouver l’inspiration spirituelle qui permettra le ré-enracinement, en découvrant le sacré à tous les niveaux de l’existence.
Ce n’est pas d’une appartenance à un corps (même mystique), mais d’une « inspiration chrétienne » que se réclame Simone Weil, tout en récusant l’enracinement biblique – et donc la Promesse – comme celui d’une socialité ecclésiale, restant « sur le seuil » dans un désir d’incarnation dans la masse des incroyants. Sainteté sans doute, mais préchrétienne, que d’ainsi demeurer dans le déracinement de l’exil, ayant pour seul instrument la « hache du détachement » qui extermine l’élan vital (cher à Bergson), afin de parvenir, en consentant à la mort, à « la porte du Transcendant ».