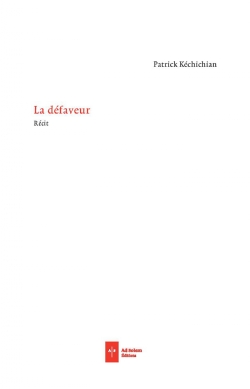Patrick Kéchichian, dont on connaît le riche parcours d'écrivain et de critique, nous livre ici les clefs de son « histoire intérieure ». Ce livre ne prend pourtant pas la forme d'une autobiographie classique. Récit de la formation d'un jeune homme, « ou plus précisément, dit l'auteur, de son édification », il ne comporte ni dates ni anecdotes (on devine Mai-68 dans la périphrase : « Un certain printemps, […] sur la rive gauche du fleuve »). Le narrateur se distingue de son personnage, désigné par un « il », afin de mieux l'accompagner à la juste distance. Il nous mène, dans la langue des moralistes plutôt que dans celle des romanciers, au cœur secret d'une destinée : un retournement qui le fait passer de la « défaveur », à laquelle il se croyait assigné par sa condition d'enfant d'immigrés, dans un monde qu'il voyait partagé entre le côté des « forts » et celui des « faibles », à ce qu'il finira par appeler la « grâce », la douce présence d'un Dieu « de grande tendresse et d'humaine douleur » qui l'assure dans sa personne « de sang et de mémoire », lui donne une place dans la vie et le reçoit dans sa maison, l'Église.
Cette « adoption » filiale et ecclésiale va de pair avec l'appropriation, par le futur écrivain, de la langue de son pays d'accueil. Il aura, dans cet apprentissage de la parole littéraire, à déjouer les pièges de l'imposture et des modes, à une époque où une certaine littérature s'était à ce point coupée de la réalité qu'on n'y reconnaissait pas « un brin d'herbe » dans le macadam idéologique. L'auteur, en revanche, revenant sur ces années-là, évoque avec beaucoup de charme les arbres et les dômes du Quartier latin. Il tirera de cette expérience une morale de l'écriture : « L'audace qui autorise à parler ne doit pas faire violence au silence qui protège cette parole, à la retenue qui la fait mieux, parfois, entendre. » Aussi est-ce en écoutant et en lisant qu'on apprend « à mieux peser ses mots, ceux des autres et les siens ». Si la lecture et l'écriture sont les deux hémisphères de la littérature, la critique est le pont qui les relie. Le livre contient de belles pages sur cette activité que l'auteur exerce avec bonheur depuis ses débuts, et qu'il caractérise par une hospitalité donnée et reçue.
Le pouvoir des mots est donc essentiel pour se rapatrier dans l'espace du dedans, mais aussi bien pour « laisser entrer le dehors ». Leçon d'hospitalité que l'auteur rappelle à ses frères en Église (que serait une cathédrale sans son porche et son parvis ?), et qu'il met en pratique à la fin du livre dans son espace intime. Il y donne la parole à sa mère, qui lui reproche à la fois sa conversion – son passage de « l'Orient » à « l'Occident » – et le prix qu'il attache à sa langue d'adoption, au langage en général, accusés de travestir la réalité ordinaire. La réponse du fils montre à quelle profondeur se refait l'unité d'une histoire, en nommant ses fractures : reconnaissant sa dette filiale, il permet en même temps à celle qui lui a donné la vie de se faire entendre, de tous et de lui-même, dans cette langue qu'elle récuse. À son tour, il la met au monde…