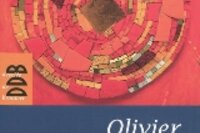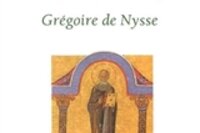Nous vivons un temps béni : un siècle religieux s'ouvrirait devant nous. À lire les journaux, nos sociétés postmodernes seraient celles d'un retour du spirituel. Les signes en sont nombreux, des grands rassemblements catholiques à l'essor des monastères bouddhistes, des cours sur l'icône aux stages de yoga, des Bibles succès de librairie aux collections de spiritualité. Bref, notre temps serait plus éveillé à la foi que celui de nos aînés. Un article récent 1 a pris le contre-pied de cette analyse. En plein débat sur les racines chrétiennes de l'Europe à inscrire ou non dans la future constitution, le journaliste constatait que, « partout en Europe, l'indifférence religieuse gagne donc du terrain, donnant à l'opposition entre valeurs chrétiennes et laïcité une vague odeur de renfermé. Le débat, pour les Européens, est clos et leur Europe n'est ni chrétienne ni laïque, elle est... post-religieuse, areligieuse, multireligieuse, post-laïque ? Il revient aux philosophes et aux intellectuels de rayer la mention inutile. Pas aux journalistes ».
En 1817 déjà, Lamennais se posait la même question dans son célèbre Essai sur l'indifférence. En dénonçant la « léthargie » et la « brutale insouciance » de l'Europe, il n'entendait par « indifférence » que les divers déismes de son temps — l'indifférence « par paresse » relevant, selon lui, de l'« aliénation ». Or nous sommes de cette folie. « Tu crois en Dieu ? C'est bien. Moi, je préfère le jazz », me répondit-on lors d'un dîner. Dieu, le salut, a fortiori l'Église, importent peu, car cela ne porte plus : telle est la conviction qui fonde cette indifférence. Pourquoi la question de Dieu, la question du salut sont-elles si peu présentes dans nos sociétés ? Les avons-nous perdues à cause d'errances théologiques et ecclésiales ? Est-ce par sagesse politique, pour construire un meilleur « vivre ensemble » ? Est-ce un rejet lucide, par choix idéologique ? Ces questions renvoient à autant d'interprétations classiques du phénomène, qui toutes envisagent l'indifférence à l'aune de ses causes. Mais lorsqu'un phénomène est aussi massif et relève à ce point du fait établi, il est vain d'en chercher les causes, car elles seront toujours disproportionnées et dépassées. L'indifférence n'est pas une simple conséquence du passé : elle est un choix de vie. Ce sont donc les structures de ce choix qu'il faut essayer, un tant soit peu, de démonter afin de briser l'illusion de la fatalité.
Un monde clos dans un espace infini
L'indifférence religieuse actuelle semble être plutôt une indifférence à l'égard des questions fondamentales — comme la question du salut ou de la finalité de l'humain — qu'une indifférence à l'égard de la religion. Le monde a été rabattu sur lui-même, à mi-chemin entre un subjectivisme hédoniste et une globalité matérialiste : la vie commune tend à se réduire à la dimension horizontale et au court terme ; l'homme contemporain tend à se considérer comme l'état final de l'évolution, dans un contentement mêlé de désespoir. Un tabou majeur pèse sur l'idée de salut, sur l'idée de chute, sur la possibilité d'une vie autre : bien des quêtes religieuses sont des quêtes de guérison et non de rédemption. Rarement culture aura autant accepté les limitations de la vie présente.
Avec le recul, la prophétie de Nietzsche, dans le Prologue de Zarathoustra en 1883, nous apparaît d'une rare acuité :
Des stratégies d'évitement
Cette indifférence est d'abord une infirmité : expérimenter la question de Dieu et du salut n'est plus seulement une conquête personnelle, mais une conquête contre la tendance générale de nos sociétés qui multiplient, plus ou moins consciemment, des stratégies d'évitement. D'abord, en rejetant toute nouveauté. Contrairement à leurs slogans, nos sociétés sont peu ouvertes au neuf, à l'imprévu. Exclue du politique, la nouveauté est à présent cantonnée à la technique, qu'elle soit artistique ou technologique, et il ne peut donc vraiment s'agir de nouveauté, la technique ne pouvant innover, seulement perfectionner 3. Certes, la vulgate publicitaire — ce mensonge continu qui baigne notre environnement — cultive le newism, mais il s'agit à chaque fois d'un simple recyclage qui jamais ne nous arrache au cercle clos de la production-consommation. Or, sans expérience de la nouveauté, de l'inconnu, comment affronter Dieu ? Ce refus de la nouveauté est en fait une peur de l'altérité, une panique devant celui qui diffère radicalement.
Nous touchons là à un deuxième paradoxe : nos sociétés se définissent comme ouvertes et évitent pourtant soigneusement toute altérité réelle, annulant la chance inouïe offerte par le pluralisme qui les caractérise. L'affirmation du droit à la différence est en partie un leurre : cette différence est cultivée à l'extrême pour elle-même et non comme signe de l'autre. Une différence annulée par son extension infinie, d'un mauvais infini, indifférence répétitive des monades locataires de nos mégalopoles, chacun cultivant sa vocation personnelle, son particularisme, son authenticité : mais quel sens donner à cette unicité coupée de tout lien avec un universel ? Une différence si généralisée qu'elle est source d'indifférence à l'autre, qu'elle génère un agnosticisme social : on doute de la réalité des relations ; accorder confiance, promettre, accepter une parole deviennent des gestes de prophète.
Cet agnosticisme social a connu deux moments : un temps où de façon systématique les liens sociaux se sont défaits et relativisés ; puis un deuxième temps, dit « post-moderne », où ces liens semblent se renouer en réseaux, relations nomades de nomades sans parcours. Car il s'agit là de faux nomades : un nomade a une origine, un itinéraire, un nomade ne s'appartient pas. Nos nomades post-modernes, cellulaires collées à l'oreille, sont des moines gyrovagues, des ermites sans solitude pour les plus forts, des reclus sans communauté pour les plus fragiles. Cet agnosticisme social nourrit l'essor des médias : les écrans s'interposent de plus en plus, nous évitent d'être saisis par l'autre, multipliant des contacts toujours différés, que le prétendu « temps réel » masque mal.
En retour, les médias nous privent de notre qualité de médiateurs, ils sapent la validité des liens sociaux en désintégrant les symboliques fondamentales et fondatrices de l'humain. Les médias fabriquent ainsi des messagers aux mains vides : notre liberté se trouve vidée de sa substance Pour quoi, pour qui être libre ? Une liberté toute abstraite qui se résume souvent, faute d'assise, à une illusoire possession de soi. La seule façon d'être libre de rien est de vivre dans une absence totale de conséquences. Cette liberté-là nous est vendue chaque jour sous toutes les formes de biens matériels et immatériels, et tient une large place dans les préoccupations de la gestion politique de la cité. Une liberté sans engagement ni promesse, car il s'agit de vivre dans une immédiateté totale, dans un « temps réel », sans jamais différer quoi que soit. Un faux présent toutefois, illusion de notre obsession de l'automaticité, un présent sans présence.
L'indifférent jouit de l'enfouissement dans un « vécu » instantané, de l'intimité médiatique, de l'événement fugitif. L'indifférent ne remet pas à un autre temps, et donc ne se remet pas lui-même à un autre temps, il vit à l'intérieur d'un présent implosé. Certes, il lui reste encore des bribes du passé, des savoir-faire et des façons d'être façonnés par les aïeux. Mais quelle place cela tient-il dans ses modes de vie ? On a parlé d'athéisme pratique, et il est un fait que nous vivons comme s'il n'y avait pas d'autres temps : en refusant de différer la vie, la vie s'indiffère
Illusion de l'abondance
En tout cas, il est certain qu'il s'agit plus de pratiques et de rites que de discours. Ce n'est pas une idéologie qui nous rend indifférents, mais une véritable orthopraxie qui nous enferme dans la seule actualité apparemment commune, celle du marché. En effet, la société de marché est une société immédiate à elle-même, aspirant à un présent sans passé ni avenir, un présent sans présence... Les rites mercantiles que nous accomplissons chaque jour tissent la temporalité de l'indifférence. Le levier de cette orthopraxie, le point d'Archimède à partir duquel elle déplace le monde, est le rejet de toute précarité matérielle. Cette obsession de la surabondance est un des fondements de notre époque : comme il ne s'agit plus pour les générations actuelles de la hantise du manque, quelle peut être la motivation de cette volonté inflexible de tout prévoir, assurer, d'entasser les biens, de se nourrir au-delà des nécessités et de transformer son propre corps en le soumettant à cette surconsommation ?
Nos sociétés sont bien plus qu'une société de divertissement et semblent culminer dans le rejet de la précarité ultime : la mort. Le refus de se confronter à la mort nourrit le maintien en activité permanente du marché, les flux financiers ininterrompus, l'extension croissante de la logique mercantile dans les espaces privés, l'absorption des loisirs et du « temps libre » par le marché, etc. Il n'y a pas de précédent d'une telle négation de la mortalité. Celle-ci se réfugie dans la solitude des âmes, ou au sein de quelques communautés qui résistent à cet aveuglement. Significativement, des adolescents osent porter le deuil dans leurs habits : ce n'est plus le rouge, mais le noir qui signe la révolte. La mort est la grande ennemie de notre indifférence postmoderne, car elle menace à chaque instant d'en crever la bulle spéculative.
Une acédie globale
La mort peut briser l'illusion, de même que la fatigue psychique peut devenir si pesante qu'un appel à la spiritualité surgit. Alors on pourrait espérer une sortie de l'indifférence, tant il est vrai que cet épuisement anthropologique appelle à « plus de spirituel », « plus de religieux ».
Nos contemporains sont balancés entre anorexie et boulimie religieuses : d'un côté, rejet de tout ce qui, de près ou de loin, évoque la religion, culte techniciste, nihilisme mondain, humanisme désenchanté ; de l'autre, quête de techniques spirituelles, exploration de son corps aux frontières de l'esprit, recherche de schémas anthropologiques, demande de pratiques ascétiques ou de retours aux sources.
Mais les étiquettes « religieux » ou « spirituel » ne doivent pas faire illusion. L'homme reste souvent décentré de son vrai centre : Dieu. S'il estime avoir besoin de la spiritualité, il ne comprend souvent plus grand-chose à Dieu, et ne s'y intéresse pas pour autant.
Cette indifférence à Dieu alliée à cette alternance de torpeur et d'hyperactivité sont les symptômes d'une maladie bien connue de la tradition monastique : l'acédie. L'acédie est une dépression d'ordre spirituel se manifestant par un dégoût de vivre, une indifférence affective. Cette torpeur coexiste avec une hyperactivité, car la personne cherche ordinairement à compenser le vide spirituel qu'elle éprouve par de multiples occupations et distractions. Le travail, les arts, les loisirs captent toute l'attention et toutes les énergies. L'incapacité à rester en place, à s'écouter, et, en même temps, un nombrilisme exacerbé — mais d'un soi réduit à ses pulsions ou à une authenticité dose — caractérisent l'anthropologie tronquée de notre temps. L'indifférence religieuse s'enracine dans une indifférence à soi-même. Cette indifférence constitue une nouvelle forme de l'acédie, mais une acédie sociale, globale. L'acédie est, comme dit saint Jean Climaque, « une calomniatrice de Dieu qu'elle trouve sans cœur et sans bonté ». Une acédie diffuse qui constituerait le fond spirituel de nos sociétés, et qui en résumerait assez bien l'instabilité, la constante fuite de soi-même, la coexistence d'hyperactivité et de dilettantisme.
La fine pointe de cette acédie serait une spiritualité de l'indifférence, commune à l'indifférence religieuse et à bien des « retours du religieux ». Dostoïevski, dans Les possédés, analyse prophétiquement l'intelligence spirituelle de notre temps à travers le personnage de Kirilov :
Un voile à déchirer
Il y a donc des limites à cette indifférence. Elle est comme un voile superficiel, qui semble évident tant qu'il garde sa cohésion, mais qui se révèle sans attache solide dès qu'on le soulève. Cette culture de l'indifférence est invisible et enveloppe tout un chacun, croyant ou non. Car l'inquiétude religieuse elle-même n'est pas nécessairement le contraire de l'indifférence : elle est souvent une inquiétude du sens de sa vie, de son bonheur, de sa place dans l'Église. Ce climat d'indifférence est donc aussi une chance pour le chrétien, pour sa conversion. Les chrétiens sont appelés à être des témoins du risque, de l'imprévu, de l'inconnu : de façon paradoxale, s'ils veulent s'arracher à cette indolence de l'esprit, les chrétiens doivent non pas délivrer des réponses, mais des questions ; non pas rassurer, mais révéler les abîmes pour accueillir l'espérance. Appelés à vivre une altérité prophétique, à accueillir l'autre dans un dialogue de personne à personne, une liberté s'adressant à une liberté dans une confrontation à l'issue toujours nouvelle, les chrétiens ont à témoigner de la folie de la parole donnée, de la promesse, une folie qui nous libère du petit calcul prudent et terrifié. Cette folie seule peut rendre au présent sa densité, en faire le signe de l'origine et de l'ultime, libérer une eschatologie active et ouverte pour féconder notre temps.
En résistant dans leurs pratiques quotidiennes, les chrétiens peuvent démystifier l'illusion de la surabondance, et faisant œuvre de justice, ils feront œuvre de vérité. Le christianisme est porteur de cette science de la nouveauté, de la capacité à commencer 4. Les chrétiens ont à rendre compte de la véritable nouveauté de l'esprit en face du cycle fermé de la matière, une nouveauté qui doit s'exprimer dans les arts et les politiques : inventer de la gratuité et de la confiance. Dans le creuset de cette expérience de la nouveauté, il devient possible d'affronter la peur de la mort pour s'en libérer, pour dire que le christianisme est résurrection. Autant de voies pour renverser l'indifférence en faveur d'un véritable éveil spirituel, pour orienter ce sommeil de l'âme, en faire une nuit des sens et de l'esprit, pour y accueillir le visage de l'autre, son regard.
1. Anthony Bellanger, « L'Europe est-elle chrétienne ? », Courrier international, 1" juin 2003
2. Sciemment, je n'utilise ni le terme trop hexagonal de laïcité, car le phénomène est mondial, ni le concept trop marqué de sécularisation. Ce qui est en cause ici, ce ne sont ni le pluralisme religieux, ni la distinction entre le politique et le religieux, mais la tendance à donner un contenu idéologique à ce qui est une simple convention pratique.
3. Voir sur ce point Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, qui développe une véritable philosophie de la natalité très stimulante pour notre propos.
4 Saint Augustin écrit dans La Cité de Dieu « Pour qu'il y eût un commencement, l'homme fut créé ».