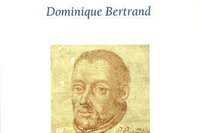Vouloir traiter ce sujet brièvement est une gageure, du fait de sa complexité, mais plus encore en raison des interprétations contrastées auxquelles il donne lieu. Pour certains, la cause est entendue : l’Église catholique a condamné, emprisonné et martyrisé Galilée, un astronome génial qui avait démontré que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu’elle refusait d’admettre au nom des Écritures. Pour d’autres, « l’affaire Galilée », dont bien sûr les jésuites sont les principaux protagonistes, est un tournant symbolique. Pour d’autres encore, les choses doivent être au contraire réexaminées. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux et, depuis une vingtaine d’années, les articles et les livres allant dans ce sens se multiplient.
L’autorité du Collège romain
Grâce à leurs préoccupations scientifiques et pédagogiques, les jésuites ont rapidement été conduits à réfléchir aux problèmes épistémologiques qui se posaient alors, à distinguer le simple recours à l’expérience et les expérimentations, et à montrer que ces deux conceptions donnent à l’expérience des fonctions différentes. En effet, si, dans le premier cas, les expérimentations a posteriori tendent à rendre évidents à l’intellect les principes théoriques, dans le second, en revanche, elles sont la pierre de touche des hypothèses et s’inscrivent dans la dynamique de la recherche.
L’importance du Collège romain
Christoph Clavius, qui enseigne les mathématiques depuis 1563 au Collège romain, a joué un grand rôle dans l’élaboration d’une