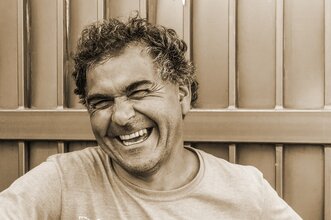MARIE-HÉLÈNE CONGOURDEAU, CNRS, Paris. Spécialiste de Nicolas Cabasilas, elle a traduit et édité un grand nombre d’ouvrages des Pères grecs, surtout chez Migne dans la collection « Les Pères dans la foi ». A publié chez Brepols : Le livre des saints (avec J. Fournier, 1995), et aux Presses de la Renaissance deux romans : Le silence du roi David (1999) et Quand viendra le Jour de Seth (2004).Dernier article paru dans Christus : « Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze : l’homme d’Église et le poète » (n° 209, janvier 2006).
Philon d’Alexandrie, juif de la diaspora et contemporain du Christ, fut un modèle pour les premiers exégètes chrétiens 1. Juif de langue grecque, il fut le premier à tenter une synthèse entre la pensée hellénique et la révélation biblique. Dire qu’il tenta une synthèse est d’ailleurs inexact : Philon lisait la Bible grecque (la Septante) comme un juif pieux de langue grecque, et se mouvait dans les deux cultures avec l’aisance d’un autochtone. L’inculturation est chez lui naturelle, et c’est pourquoi il fut précieux aux premiers chrétiens grecs qui eurent à expliquer la Bible à leurs semblables : un chemin était esquissé. C’est donc en familier de l’Écriture et en homme rompu aux schémas de la pensée hellénique que Philon aborda le thème universel, commun aux deux cultures, de l’exil.
Une expérience universelle
Le thème de l’exil naît d’une intuition diffuse : l’âme de l’homme n’est pas à sa place en ce monde de contingence, elle qui par sa pensée peut embrasser les âges et