Quand la conversation devient spirituelle
N°278 - Avril 2023
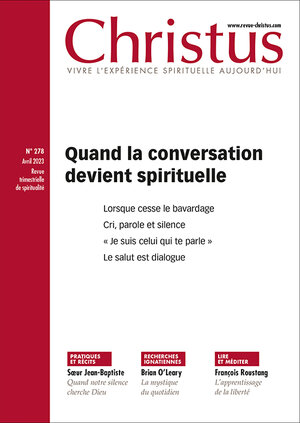
Publié le 01 avril 2023
Version Numérique : ePub
Dossier du numéro
Vivre la spiritualité
Recherches ignatiennes
Lire et méditer
Edito


