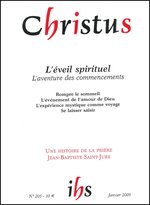Pour éclairer le thème de l'éveil spirituel, je voudrais évoquer les déplacements que subit aujourd'hui la question de « la venue à la foi » qui a tellement occupé la théologie au XXe siècle. Je le ferai en citant tout d'abord quelques lignes fameuses du théologien catholique Karl Rahner qui développa jadis, d'une manière saisissante, le thème d'une expérience de la grâce constitutive de l'existence humaine dans toutes ses dimensions, et non plus enfermée dans l'accomplissement des actes liturgiques ou sacramentels ou en des pratiques de piété conçues alors comme d'étroites fenêtres vers le ciel. Il se situe ainsi dans le cadre de réflexions communes au milieu du XXe siècle, où, sous l'influence de théologiens protestants en particulier, la théologie développait une critique aiguisée d'une conception étroitement ritualiste de la vie chrétienne, comprise comme une sphère à part de l'ensemble de l'existence :
Venir a la foi aujourd'hui
L'événement de l'amour de Dieu

Plan de l’article
- Une expérience entraperçue
- Une maïeutique ?
- L'événement de l'amour de Dieu
- Se laisser saisir
Article réservé aux abonné(e)s
« La grâce est partout comme fin la plus profonde du monde et de l'histoire humaine, greffée par Dieu préalablement sur le monde et l'histoire (. ) La grâce est l'ouverture globale et radicale de l'entière conscience humaine vers Dieu (...) ; la grâce ne se manifeste pas ponctuellement ici et là dans le monde, par ailleurs profane, qui existerait sans cette grâce. (. ) Dieu est le but du monde spirituel, en ce sens que, du centre le plus intime de ce monde, il est le moteur de ce mouvement vers lui-même (.. ), et lorsque ce mouvement du monde spirituel qui part de son centre le plus profond devient radical, il y a grâce » 1.
Ces pages thématisent ce que l'on peut appeler une « mystique du quotidien » qui découvre l'existence humaine toute entière inscrite dans l'ordre de la grâce. La vie quotidienne, l'exercice de la responsabilité historique sont ainsi découvertes comme le lieu de réalisation de la vocation chrétienne à la Il reste 90% de l’article à lire
Cet article fait partie de la sélection réservée à nos abonné(e)s
Déjà abonné(e) ?
Abonnement Numérique
9,50€ par trimestre
JE DÉCOUVRE, SANS ENGAGEMENT
9,50€ par trimestre
Tous les contenus en illimité
sur revue-christus.com
sur revue-christus.com
Débloquer l’article seul
ACHETER L'ARTICLE EN NUMERIQUE - 2,50 EUROS
Article disponible en version numérique en ligne (2,50 euros)
Revue N°205 (Janvier 2005) disponible en version papier.
Revue N°205 (Janvier 2005) disponible en version papier.
Dans le même domaine

- Combat spirituel
- Expérience spirituelle
- Jésuites et Compagnie de Jésus
- Mystique
- Psychologie
- Spiritualité ignatienne

- Confiance
- Famille
A propos de l'auteur