À la manière d’un guide dans lequel nous trouverions de quoi répondre à tout coup aux injonctions de notre temps, Une saison en littérature est un livre essentiel à plusieurs vitesses. Traversant l’œuvre d’Olivier Clément (1921-2009), Franck Damour, avec l’aide de Monique Clément, a réuni plusieurs textes du fameux théologien orthodoxe sous le signe du « dialogue spirituel ». Des auteurs aussi différents que Rimbaud, Camus, Eliot, Vigée, Emmanuel, Dostoïevski, Soljenitsyne et Bloy sont explorés.
Bien connu du grand public,
O. Clément livre une pensée synthétique extrêmement nourrissante qui semble mettre en œuvre la phrase de Rimbaud : « La science est trop lente, que la prière galope et que la lumière gronde. » Ainsi se dessine, depuis Les Visionnaires (1986) jusqu’à la revue Nunc dans laquelle O. Clément analysa Le Voyage des Mages de T. S. Eliot (n° 7, avril 2005), un paysage passionnant de la littérature comme champ de bataille et comme révélation : c’est là que s’exposent non seulement les idées, l’athéisme et la foi, mais l’amour lui-même.
Au long d’un essai inédit jusqu’à ce jour, la trajectoire d’Albert Camus est scrutée, où l’on voit apparaître une vision de l’absurde qui n’est plus tout à fait la même quand on lit les extraits de ses dernières adaptations théâtrales. C’est aussi l’occasion de poser avec Pierre Emmanuel la question : « Comment affamer de Dieu les hommes ? » Nous entrons avec Dostoïevski dans « le souterrain […], le samizdat d’une modernité réductrice ». « C’est l’homme qui n’a pas d’autre définition que d’être indéfinissable […]. C’est aussi la terre des incarnations créatrices, où le christianisme se réconcilie avec la vie. » Soljenitsyne rappelle « que le monde moderne, s’attaquant au grand arbre de l’être, a brisé la branche du vrai et du bien. Seule reste la branche de la beauté, et c’est à elle qu’il appartient maintenant d’assumer toute la sève du trône ». Il assigne à l’art une mission des plus hautes : « La conviction profonde qu’entraîne une véritable œuvre d’art est absolument irréfutable, elle contraint même le cœur le plus hostile à se soumettre. »
Ainsi, pour O. Clément, « la véritable beauté est celle qui produit toute communion ».
Une saison en littérature
Olivier Clément
Une saison en littérature
Av.-pr. Fr. Damour.
Desclée de Brouwer, coll. « Littérature ouverte », 2013, 234 p., 17 €.
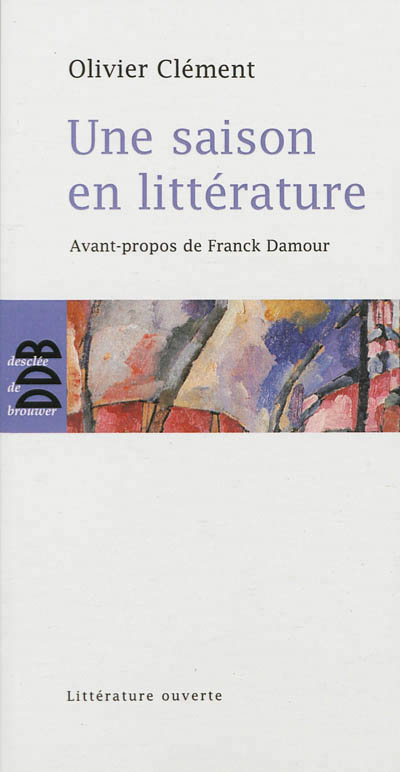
Christophe Langlois

