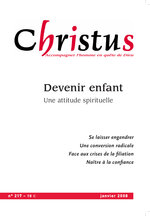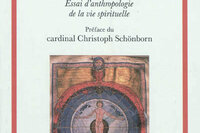Ouvrons les Cahiers de Simone Weil :
« C’est par la force et la fixité du désir que nous devons devenir des enfants. Un enfant tend les mains et tout le corps vers ce qui brille, fût-ce la lune. Un enfant crie avec sa voix et tout son corps, inlassablement, pour demander du lait ou du pain, s’il a faim. Les adultes s’attendrissent et sourient, mais lui est totalement sérieux. Tout son corps et toute son âme sont uniquement occupés à désirer. Rien n’est moins puéril qu’un petit enfant. Les adultes qui jouent avec lui sont puérils. (Je crains bien que la petite Thérèse de Lisieux n’ait ressemblé plus souvent à un tel adulte qu’à un petit enfant) » 1.
Constat accablant dont je voudrais bien exonérer Thérèse, mais les experts le confirment cruellement quand ils se penchent sur les déboires d’une enfance maladive, réputée névrotique, et plus encore sur les dernières semaines de cette carmélite de vingt-quatre ans qui va mourir – et elle le sait – et qui, en ces heures graves, se dépense en billevesées gamines : la voilà qui parle « bébé », de « lolo » et de « dodo » ! la voilà qui patoise, qui infantilise ! Perspicace, Claude Langlois aura remarqué que ce parler bébé est un code mis au point par Thérèse pour s’entretenir avec Céline, mettant hors jeu Pauline – la Mère Agnès – qui l’importune et ne comprend rien.
Et de fait, sous ce maquillage qui fait diversion, transparaît l’effroyable négation : « Je suis un bébé qui n’en peut plus. » C’est le langage de la chair transie de souffrance, assiégée par l’angoisse de la mort qui vient : « Comment que bébé fera pour mourir ? » Pauline, qui pensait que l’agonisante voulait ainsi détendre et « faire sourire » son entourage déjà endeuillé, lui demande quand même : « Vous êtes donc un bébé ? », et elle de répondre : « Oui, je suis un bébé qui est un