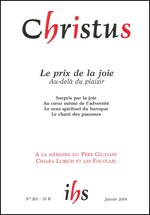Les pages qui suivent, simples impressions d'un séjour à Vienne, n'ont rien d'un exposé méthodique. Je n'ai fait que recopier, en essayant de les grouper, les réflexions qui m'étaient venues à l'esprit au sortir de la Peterskirche ou du Barockmuseum. Je m'excuse de ce défaut de présentation. Il aura du moins l'avantage de laisser à ces notes le caractère de spontanéité qui est leur unique mérite.
Le terme « baroque » a pris en France un sens péjoratif. Nous nous demanderons tout à l'heure pourquoi. Ce qu'il désigne chez nous justifie d'ailleurs en partie ce mépris. Mais cela ne doit pas nous masquer qu'il en est tout autrement en d'autres pays. Baroque y désigne une grande civilisation catholique, celle qui est issue de la Contre-Réforme et qui va du Concile de Trente à la fin du XVIIIe siècle 1. Elle représente l'effort du catholicisme pour assumer toutes les découvertes de la Renaissance et les emporter dans son élan. L'humanisme chrétien y a trouvé son expression adéquate et magnifique.
Née en Italie, la culture baroque semble d'abord triompher en France au début du XVIIe siècle avec saint François de Sales et les Jésuites 2. Mais le malheur est qu'elle n'y trouvera pas pour s'exprimer un Calderón ou un Tintoret. Les œuvres du baroque français seront le Saint-Louis du Père Lemoine ou les tableaux de Le Brun. C'est contre elles précisément que la culture française du XVIIe siècle se définira chez un Boileau. L'anthropocentrisme classique s'opposera au théocentrisme baroque. Il se rattachera à l'humanisme de Montaigne et au rationalisme de Descartes. L'harmonieuse synthèse sera défaite, les saints retourneront à leur dépouillement dans les Maisons de Port-Royal et l'art se repliera sur lui-même dans les boudoirs de Versailles et de Saint-Germain au grand dommage de l'un et de l'autre. L'art baroque aura cependant en France un mode d'expression, mais il ne sera pas religieux. Il servira à l'exaltation de la monarchie absolue. La perspective qui s'ordonnait au ciel et à la céleste conversation s'ordonnera au trône et au prince. La hiérarchie des courtisans remplacera celle des chœurs angéliques. Cette religion de l'État s'exprimera par le merveilleux païen. Sur les plafonds peints, au lieu des Assomptions, on verra Louis XIV enlevé dans la gloire au milieu d'un tumulte d'amours et de nymphes. Simple substitution de sujet, semble-t-il. Mais la déviation est plus profonde. Le baroque est essentiellement ouvert ; il trouve son naturel épanouissement dans l'infinité du Dieu chrétien. Représentant des sujets païens, son infinitude n'est plus justifiée, et ceux-ci, par ailleurs, se
Sur l'architecture baroque
Sa signification religieuse

Plan de l’article
- L'ÉGLISE BAROQUE
- Le mouvement : la vague
- La ligne baroque
- L'ordre : l'étagement
- SYMBOLISME DES ESPACES
- Ordre et mouvement : la montée
- Le Nuage
- Le pli
- L'aile
- ARCHITECTURE OUVERTE
- La coupole
- La fenêtre et le miroir
- Les fresques et le miroir
- L'ASSOMPTION
- Esthétique de l'Assomption
- « ... Sedet ad dexteram... »
- THÉOLOGIE DU BAROQUE
- Rubens et Rembrandt
- L'EXTASE
Article réservé aux abonné(e)s
Il reste 90% de l’article à lire
Cet article fait partie de la sélection réservée à nos abonné(e)s
Déjà abonné(e) ?
Abonnement Numérique
9,50€ par trimestre
JE DÉCOUVRE, SANS ENGAGEMENT
9,50€ par trimestre
Tous les contenus en illimité
sur revue-christus.com
sur revue-christus.com
Débloquer l’article seul
ACHETER L'ARTICLE EN NUMERIQUE - 2,50 EUROS
Article disponible en version numérique en ligne (2,50 euros)
Revue N°201 (Janvier 2004) disponible en version papier.
Revue N°201 (Janvier 2004) disponible en version papier.
Dans le même domaine

- Eglise
- Foi
- Histoire
- Jésuites et Compagnie de Jésus
- Obéissance et autorité
- Théologie

- Arts (littérature, cinéma, peinture, sculpture,…)
- Conversion
- Désir
- Saints et sainteté

- Arts (littérature, cinéma, peinture, sculpture,…)
- Corps, sexualité
A propos de l'auteur