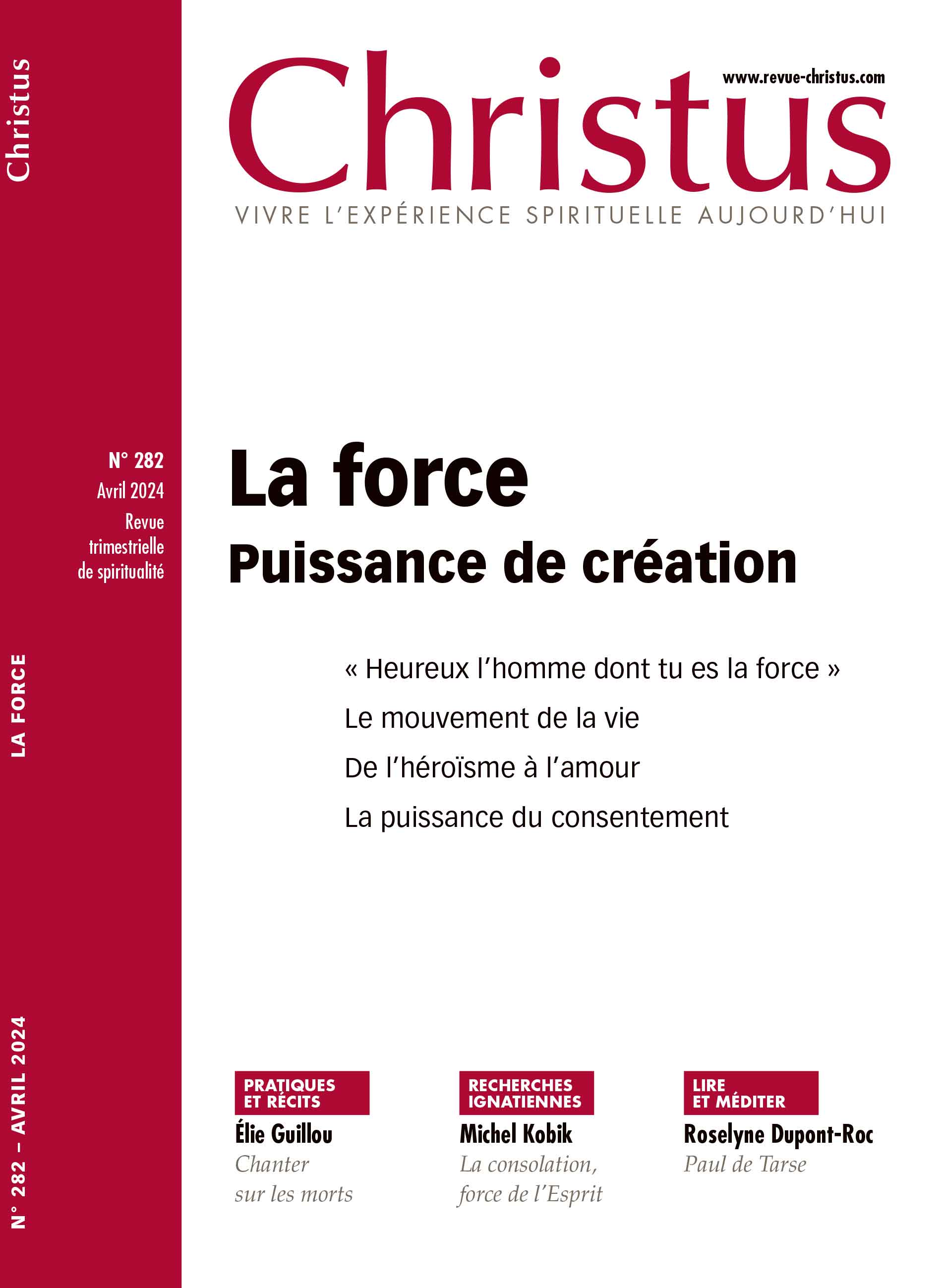La sélection de la rédaction
Explorez Christus
(Re)découvrez nos contenus à travers 20 ans d’archives numériques
Nos derniers articles

L'aventure de la patience
- Action et contemplation
- Expérience spirituelle
- Souffrance, épreuve, mystère de la Croix

Sur qui se fonder pour continuer
- Combat spirituel
- Jésus Christ
- Vie religieuse

Événements et Partenariats

Repères pour l’accompagnement spirituel Amoris Laetitia : une aide et des repères pour accompagner
Samedi 4 Mai 2024
de 09h00 à 18h30
Vivre la spiritualité

Offert
- Corps, sexualité
- Expérience spirituelle
- Prière, méditation, contemplation
- Spiritualité
Recherches Ignatiennes
Les auteurs du dernier numéro
Boutique

S'engager
N°281 - Janvier 2024
- Action et contemplation
- Amour, charité
- Combat spirituel
- Confiance
- Conversion
- Désir
- Discernement
- Eglise
- Espérance
- Exercices spirituels