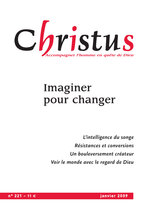«Des rues pavées d’or » : c’est le cliché répété par les histoires du XXe siècle pour décrire la motivation des Européens pauvres émigrant vers l’Amérique. La poursuite « de l’or et de la gloire » est présente à l’origine de la colonie anglaise de Jamestown, en Virginie, tout comme à la fondation des vice-royaumes du Pérou et du Mexique. Mais les colons du début et ceux qui émigrèrent plus tard aux États-Unis eurent des motivations variées, et pas forcément aussi matérialistes ou ambitieuses que celles des marchands aventuriers anglais et des conquistadors espagnols du XVIe siècle.
Les espoirs des colons et des immigrants
Les colons d’Amérique du Nord et les immigrants qui leur succédèrent avaient des buts aussi nobles que la liberté religieuse et politique, et aussi terre-à-terre que celui de fuir la pauvreté. Les pèlerins qui abordèrent à Plymouth Rock cherchaient la liberté de culte, et la colonie de Massachusetts Bay donna naissance à son tour à des dissidences religieuses en Rhode Island et au Connecticut. Les quakers en Pennsylvanie et les catholiques au Maryland allèrent plus loin, en fondant des sanctuaires de tolérance. Les premiers colons créèrent aussi des institutions pour s’autogouverner, et leurs espoirs de liberté personnelle se retrouvèrent au coeur des