Saint Bernard, dans son troisième Sermon pour la Pentecôte, déplore que, trop souvent, nos « étroitesses » nous suffisent et que nous ne fassions aucun effort, même pas celui du désir, « pour respirer dans cette liberté » offerte par l’Esprit. Ce n’est pas le cas de Françoise Callerot et d’Étienne Baudry, tous deux cisterciens, qui nous apportent la preuve, de la première à la dernière page de ce livre, que lecture studieuse, recherche historique et méditation spirituelle peuvent dialoguer de manière libre et féconde, pour autant que les textes initiaux soient respectés. Leur enthousiasme est communicatif, car ils nous font participer au dynamisme de leurs découvertes, n’hésitant pas à convoquer avec reconnaissance d’autres commentateurs qu’eux-mêmes (Joël Chauvelot, Philippe Nouzille ou Bernard-Joseph Samain), et risquant des hypothèses sur la manière dont se sont construits les trois sermons : la conversion à l’œuvre dans le premier, la mise en place des vertus théologales dans le deuxième et la tension vers la réalisation eschatologique dans le troisième. Sans pour autant enfermer la théologie de Bernard dans des catégories figées, comme le prouve la qualification de « saveur orientale » donnée à sa doctrine trinitaire. S’il attribue l’image de la source au Père, celle de la lumière au Fils et celle de la Paix à l’Esprit, il ne tient pas ces attributions pour absolues : elles « jouent » d’une personne à l’autre. Dans cette veine apophatique, Bernard insiste à la fois sur l’achèvement de la Révélation à la Pentecôte et sur la relativité de notre connaissance de Dieu.
Désormais, il s’agira, personnellement et communautairement (il s’adresse à ses moines), d’actualiser la Pentecôte, jour après jour, dans la « maison de l’âme », en reconnaissant que le salut et notre consentement au salut ne viennent pas de nous mais qu’ils ne se feront pas sans nous. Ainsi « dansent » ensemble la grâce et la liberté : « Pour faire le bien, qu’est-ce que l’Esprit de bonté opère en nous ? [...] Il avertit la mémoire, enseigne la raison, met en mouvement la volonté. Car la totalité de notre âme est en ces trois. » Cette « école de l’Esprit » n’est pas limitée au cloître : « Désormais répandu dans l’univers, l’Esprit instruit secrètement, conduit même jusqu’à la plénitude tout homme qui le cherche dans la simplicité de son cœur. » La Pentecôte ouvre le temps de la maturité spirituelle qui recueille le fruit de l’Esprit, moins en termes de chaleur ou de douceur qu’en termes de force et de courage pour combattre l’Ennemi.
Dans le troisième sermon, Bernard, « par un “tu” percutant, s’adresse à chacun de ses auditeurs ou lecteurs afin qu’il vérifie où il en est dans son union à chaque personne de la Trinité » (É. Baudry). L’orateur ne se lasse pas, dans ce même sermon, de décrire les effets bénéfiques du vin nouveau de l’Esprit, « vin qui réjouit le cœur de l’homme et ne met pas l’esprit à l’envers, vin qui fait germer les vierges et ne fait pas apostasier même les sages. C’était un nouveau vin, du moins pour les habitants de la terre ». L’ébriété spirituelle qu’il provoque anticipe la « plénitude de la charité » qui se réalisera à la fin des temps.
Heureux croisements de lectures qui confirment l’intuition de Grégoire le Grand : il voyait « croître » le sens des textes en même temps que leurs lecteurs. Certes, Grégoire évoquait le livre des Écritures, mais tous les sermons de Bernard en sont irrigués.
Quand passe le vent de l’Esprit
Saint Bernard de Clairvaux
Quand passe le vent de l’Esprit
Sermons pour la Pentecôte.
Prés. É. Baudry. Trad. F. Callerot.
Abbaye de Bellefontaine, coll. « Vie monastique », 2012, 247 p., 22 e.
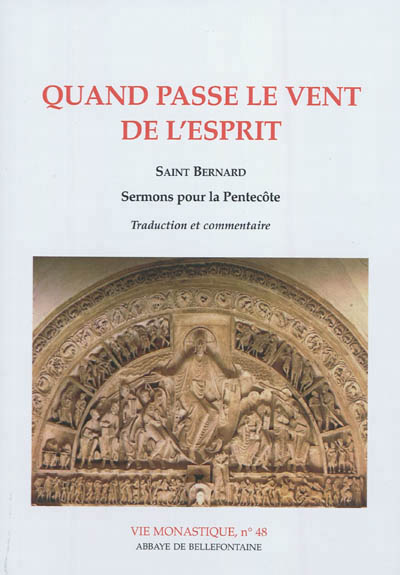
Annie Wellens
A propos de l'auteur



