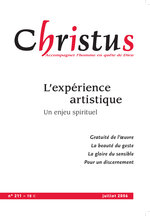Visite d’atelier. Je m’attendais à des peintures, il s’agit d’empreintes : cette corolle sur un linge, l’artiste m’apprend que c’est le bout d’un sein, le sien ; auréole, aréole. Dans la grille d’un carré, cent taches : l’empreinte d’un orteil, d’un index : « On dirait une infinité de paysages, n’est-ce pas ? » Au mur, sur un tissu léger, une espèce de soie, encadrés, des paysages Song : lacs, vapeurs et brumes, montagnes célestes… Secret de ces faux paysages chinois : un peu d’encre au hasard versée et déversée d’un pan de toile à un autre.
Et ainsi de suite.
Je n’aime pas l’oeuvre de Max Ernst : ni ses blasphèmes, ni son « onirisme » ; cette île de Pâques infantile ; mais, enfin, ses frottages sont l’instrument ou la matière de ses forêts, de ses paysages. Et l’oeuvre d’Ernst est un monde. Elle est une part distincte et significative de l’art contemporain, un versant du surréalisme. Pourquoi l’atelier que je viens de voir, et toutes ces empreintes, ces moulages de serpillières ou de semelles dans du ciment, ces aléas, ces jeux, me laissent-ils le sentiment d’une vacuité, d’une inanité, d’un enfantillage ? « Cela n’est pas une oeuvre, cela est insignifiant… C’est l’atelier des petits riens. »
Et ainsi de suite.
Je n’aime pas l’oeuvre de Max Ernst : ni ses blasphèmes, ni son « onirisme » ; cette île de Pâques infantile ; mais, enfin, ses frottages sont l’instrument ou la matière de ses forêts, de ses paysages. Et l’oeuvre d’Ernst est un monde. Elle est une part distincte et significative de l’art contemporain, un versant du surréalisme. Pourquoi l’atelier que je viens de voir, et toutes ces empreintes, ces moulages de serpillières ou de semelles dans du ciment, ces aléas, ces jeux, me laissent-ils le sentiment d’une vacuité, d’une inanité, d’un enfantillage ? « Cela n’est pas une oeuvre, cela est insignifiant… C’est l’atelier des petits riens. »
Les trois prises
Mais qu’est-ce qu’une « oeuvre » ?
C’est alors que me vient la « métaphore des trois prises » : pour qu’il s’agisse d’une oeuvre, et non d’un ouvrage, ou d’un jeu, il faut que son auteur, l’artiste, se soit « branché » sur trois courants, trois énergies, trois sources.
Première prise : un dessein, une intention, une volonté, un désir et un travail d’élucidation, un projet, une maîtrise, un métier, une entreprise raisonnable et dont l’artiste ait les moyens ; ce pôle précède l’action, l’oriente, mais, encore, la corrige, la critique, la modifie.
Deuxième prise : l’inconscient, le rêve, l’involontaire ; « le premier vers donné par les dieux », selon Valéry ; l’inattendu, la surprise… Il faut aussi que ces deux énergies confluent. Il faut, en somme, la collaboration d’Animus et d’Anima ; de l’esprit « classique » et de l’esprit « moderne ». Le vouloir et le non-vouloir, la méthode et le hasard, la stratégie et la tactique ou l’improvisation, la circonstance fortuite. Le savoir, avec le savoir-faire, et le non-savoir ; la prévision et