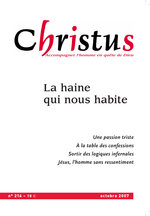Dans la tragédie grecque, la haine fait partie du destin des hommes. Le héros grec a besoin de ses ennemis pour s’affirmer, la haine des autres le fait vivre. Comment vivre sans combattre ? Et comment combattre quand on n’a plus d’ennemi à poursuivre de sa haine ?
Plus originaire et plus vieille que l’amour, la haine prend au sein de la communauté toute son ampleur et sa dimension destructrice. Paradoxalement, elle est également créatrice de lien social et permet aux hommes de fraterniser en luttant contre un ennemi commun.
La haine ne se réduit pas à un emportement passager comme la colère. Elle a quelque chose de plus tenace qui défie le temps et se réveille dans des flambées de violence dès que l’on baisse la garde. La tragédie grecque révèle le vrai visage de la haine comme un attachement passionnel proche de l’amour, ainsi que son caractère fatal. Le héros grec découvre avec effroi l’engeance haineuse qu’il a subie sans échappatoire, sa vie durant. Comment ne pas être désarmé devant tant d’acharnement dans la volonté de nuire ? Pourquoi les hommes prennent-ils tant de plaisir à faire souffrir, à humilier et à détruire leur frère ?
Ces questions qui montent de la tragédie, comme des cris de détresse face à la part nocturne de la condition humaine, demeurent un axe fondamental de notre culture pour comprendre l’énigme du mal.
L’ennemi intime
La tragédie grecque