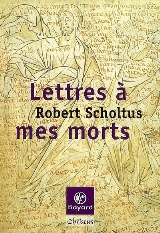Bayard, coll. « Christus », 2009, 90 p., 13,50 euros.
Robert Scholtus signe ici un petit ouvrage très original, bouleversant de vérité et de délicatesse, d’une envergure spirituelle rare. Sept lettres y sont adressées à des proches disparus, liés à l’auteur qui par le sang, qui par la vocation, qui encore par l’amitié ou par une proximité plus souterraine, hommes et femmes envers qui il se reconnaît redevable d’une part de son humanité. Tel est bien l’enjeu de ce projet audacieux : quitter un moment les morts des autres, qui ont tant occupé sa vie de prêtre, pour s’occuper un peu des siens et « leur donner de ses nouvelles », « pour opposer à l’oubli le chant obstiné de la mélancolie ».
Cette exigence intérieure est née de l’insupportable douleur du suicide de sa soeur Claire. Une forme d’écriture qui ouvre la mort à une lumière inédite fut alors inaugurée qui éclaire chez l’auteur des « régions oubliées du passé où s’est tramé mon destin ». Bien plus que de reprendre vie sous la plume, les morts continuent d’habiter ces « régions » et, par ce qu’ils furent, de donner vie, de féconder le plus vivant de nous-même pour un avenir imprévu en leur absence, mais qui ne fait que fortifier leur présence. Comme l’exprime à merveille la dernière de ces lettres (« À dimanche »), cette relation aux morts familiers et intimes est un compagnonnage grand ouvert sur l’avenir, où s’échangent des mots et des images sans prix, tant ils aident à comprendre, à relire et relier, à aimer… Nulle morbidité ni complaisance, on l’aura compris, pour ce qui risque d’enfermer dans le chagrin du passé, ou dans cet intimisme qui fait fi de l’absurdité de la mort, ou encore dans une prédication à bon marché sur la foi en la résurrection… Pourtant, l’Esprit est bien là, lui qui « vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14,26). Le dépouillement des figures et des mots de l’auteur invite pudiquement le lecteur à entrer en résonance, à ouvrir sa propre mémoire, à recueillir et offrir à son tour cette vie héritée de ses morts…
Mais il faut faire un pas de plus. Lettres à mes morts n’est pas seulement une relecture qui donne saveur d’avenir à la mémoire des proches disparus. C’est aussi le récit d’une aventure mystique qui concerne tout un chacun : le travail qu’opère en nous la mort. Il ne s’agit certes pas ici de cette « mortification » inaudible aujourd’hui, car trop chargée en représentations réductrices et sacrificielles. Il s’agit plutôt de ce qui advient en nous quand la mort nous atteint à travers nos intimes, quand elle nous laisse hébétés et inconsolables, quand elle nous fait vivre parfois quelque chose du dépouillement et de la mort du Christ. Ainsi le deuil de la soeur disparue devient-il « la nostalgie d’un avenir que nous ne connaîtrons jamais » : par sa mort, elle a « donné un commencement nouveau à ma vie ». Au centre du recueil, l’étonnante lettre « au fils que je n’aurai jamais » fait quitter les rives de la famille et aborder celles de la maturité avec ses dépouillements et ses libérations intérieures. De la fréquentation de Jean Sulivan, qu’il est temps de « traiter à hauteur mystique », l’auteur, infiniment reconnaissant du regard et des mots qui l’ont aidé, ne retient plus que « l’incessante marche » de ce « passant » qui n’a cessé de chercher la liberté… L’un des fruits les plus étonnants de ce travail de la mort est sans doute la conversion de la douleur « qui me parlait de toi ». Trace de la séparation et de la peine, elle devient signe de la joie d’une présence nouvelle. Tant de spirituels l’ont évoquée ! Ce que la mort creuse ainsi peut devenir accueil de beaucoup d’autres morts.
Dans la foi, le mort libérerait-il le vif plus qu’il ne le saisit ?