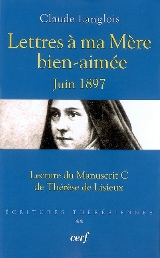LETTRES À MA MÈRE BIEN-AIMÉE (JUIN 1897), Cerf, coll. « Sciences humaines et religions », 2007, 416 p., 34 euros.
L’AUTOBIOGRAPHIE DE THÉRÈSE DE LISIEUX, Mêmes éditeur et collection, 2009, 591 p., 50 euros.
THÉRÈSE DE LISIEUX ET MARIE-MADELEINE, Jérôme Millon, coll. « Golgotha », 2009, 238 p., 20 euros.
Encore un coup de génie ! Dans son précédent Poème de septembre (Cerf, 2002), Claude Langlois avait dégagé le Manuscrit B de sa gangue de piété sirupeuse et révélé un poème vigoureux qui attestait en Thérèse un écrivain incontestable et un théologien subtil, audacieux autant que lucidement prudent. Le Manuscrit C connaît à son tour pareille métamorphose : ce long fleuve composite, fourmillant d’anecdotes où chacun allait butiner le miel de sa doctrine thérésienne, s’avère être la suite parfaitement orchestrée de 27 lettres adressées à la perspicace et pénétrante Marie de Gonzague, rédigées et relues en 27 jours (du 3 juin au 1er juillet 1897), et qui constituent le testament de Thérèse. Elle a conscience de vivre un itinéraire mystique singulier et elle possède – elle le sait – toute la compétence d’un Maître spirituel, capable de le transmettre, non seulement aux novices dont elle a la charge, mais, au-delà de la clôture, à toutes ces « petites âmes » qui mènent comme elle vie ordinaire et commune. Rien d’une théorisation vertigineuse, mais sa propre expérience aussi exemplaire que banale : relever dans l’anodin la trace de l’Autre, car, évidence absolue qu’elle affirme avec tranquille insolence : seul l’amour de Jésus est à la bonne mesure, puisqu’il est à la mesure de Dieu qui est sans mesure – infini.
L’AUTOBIOGRAPHIE DE THÉRÈSE DE LISIEUX, Mêmes éditeur et collection, 2009, 591 p., 50 euros.
THÉRÈSE DE LISIEUX ET MARIE-MADELEINE, Jérôme Millon, coll. « Golgotha », 2009, 238 p., 20 euros.
Encore un coup de génie ! Dans son précédent Poème de septembre (Cerf, 2002), Claude Langlois avait dégagé le Manuscrit B de sa gangue de piété sirupeuse et révélé un poème vigoureux qui attestait en Thérèse un écrivain incontestable et un théologien subtil, audacieux autant que lucidement prudent. Le Manuscrit C connaît à son tour pareille métamorphose : ce long fleuve composite, fourmillant d’anecdotes où chacun allait butiner le miel de sa doctrine thérésienne, s’avère être la suite parfaitement orchestrée de 27 lettres adressées à la perspicace et pénétrante Marie de Gonzague, rédigées et relues en 27 jours (du 3 juin au 1er juillet 1897), et qui constituent le testament de Thérèse. Elle a conscience de vivre un itinéraire mystique singulier et elle possède – elle le sait – toute la compétence d’un Maître spirituel, capable de le transmettre, non seulement aux novices dont elle a la charge, mais, au-delà de la clôture, à toutes ces « petites âmes » qui mènent comme elle vie ordinaire et commune. Rien d’une théorisation vertigineuse, mais sa propre expérience aussi exemplaire que banale : relever dans l’anodin la trace de l’Autre, car, évidence absolue qu’elle affirme avec tranquille insolence : seul l’amour de Jésus est à la bonne mesure, puisqu’il est à la mesure de Dieu qui est sans mesure – infini.
Elle revient donc sur son inflexible désir de la sainteté, dévoile l’épreuve de la Nuit, ces tentations contre la foi, s’interroge sur les relations intra-communautaires, réglées par une civilité raffinée qui n’épuise cependant pas l’ambition de la charité. Au gré de cette anamnèse apparaît, insistante, une requête de fraternité, merveilleusement honorée par le don de ses « frères prêtres », Bellière et Roulland, qui l’ouvrent à la catholicité, et qui s’élargit étonnamment ensuite aux pécheurs avec qui elle consent à partager le pain de l’épreuve. Choix audacieux et pionnier et que détermine la prière, dont la puissance subversive et créatrice lui permet de sortir par le haut d’une impasse, chaque fois que l’y enferme l’étroitesse des doctrines et lieux communs traditionnels.
Autre trésor qu’elle nous offre : l’expérience d’une temporalité, à la fois immobile (puisque réglée par le rituel du cadre monastique) et épousant le tempo de l’aventure intérieure, jalonnée de seuils et traversée de ruptures. Une temporalité qui s’accélère, puisque l’échéance inéluctable en restreint les perspectives et que l’obscurcissement du Ciel qui ne faiblit pas barre l’horizon d’une possible éternité. Thérèse n’en est pas pour autant défaite ni vaincue : elle développe la prégnance de l’événement (ialité) du présent où l’amour fraternellement partagé s’offre comme un « déjà-là » de ce Ciel désormais disparu, en atténue la nostalgie, voire en adoucit la perte. Ce déjà-là s’offre comme le sacrement de la Miséricorde qui est l’éblouissant motif fondant sa théologie et le leitmotiv de sa vie : postulat qui engendre l’Autobiographie (et qui en est la conclusion) et point d’orgue de l’ultime chant de reconnaissance des derniers feuillets du Manuscrit C.
Dans le renouveau des études thérésiennes amorcé dès 1948 par André Combes, il y aura désormais, me semble-t-il, un « avant-Langlois » et un « après-Langlois ». Non que toutes les publications antérieures en soient invalidées, mais les voilà irrémédiablement datées. Claude Langlois, en effet, nous apprend à lire le texte de Thérèse avec autant de minutie rigoureuse que de roborative perspicacité. Il nous restitue ainsi une Thérèse de chair et de passion, subtile, finaude, rusée à ses heures : une jeune femme affrontée à ses désirs véhéments, tourmentée par ce que lui impose l’impossible réquisit maternel (devenir prêtre), et dont la vie atrocement écourtée s’achève sur la seule certitude absolue qui la fonde : d’être aimée de Jésus d’un amour de prévenance qui lui aura évité toutes les pierres d’achoppement et lui permet de rivaliser sans complexe avec Marie Madeleine, à qui il n’aura été fait la grâce que d’un amour de repentance. Des deux (et de toutes), n’est-elle pas, de Jésus, la plus aimée ? Voilà qui donnera à penser à la théologie !