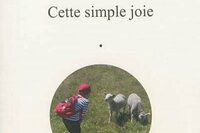Léon Bloy déclarait à l'un de ses amis, Henry de Groux :
Vous n'avez pas la notion de la durée, et c'est extrêmement grave. Les heures ne se ressemblent pas, les jours non plus. Il existe entre chaque heure du jour, et chaque jour de la semaine, une différence absolue, essentielle, divine.
Exemple. D'après la Genèse, le Lundi appartient à la Lumière ; le Mardi, au Ciel ; le Mercredi, à la Terre, à la Mer et aux Végétaux ; le Jeudi, aux Astres ; le Vendredi, aux Poissons, Reptiles et Volatiles ; le Samedi, aux Bêtes et à l'Homme ; le Dimanche, au Repos du Seigneur.
Je suis persuadé qu'un tableau analogue pourrait être établi pour chacune des heures du jour ou de la nuit, pour chacun des mois de l'année, et pour chacune des années d'un siècle1.
À en croire Léon Bloy, la répétition ne serait qu'une apparence dans la succession des heures, des jours, des mois, des années ; ceux-ci seraient en fait séparés les uns des autres par une « différence absolue, essentielle ». Bloy prend comme exemple les sept jours de la Création d'après la Genèse (qu'il fait coïncider avec les jours de la semaine romaine), jours distingués de façon « absolue » par leur contenu : les êtres différents créés à chaque étape de l'action divine. Cette conception originale de la durée est caractéristique du tempérament, de la vision et du talent de