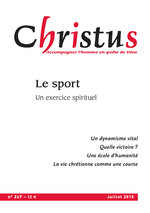A Corinthe, les jeux isthmiques eurent sans doute lieu en 51. La ville se vantait d’abriter l’un des quatre grands jeux panhelléniques avec les jeux olympiques (d’Olympie), les jeux pythiques (de Delphes) et les jeux néméens (de Némée, non loin de Corinthe). Dans ses écrits, et notamment dans ses lettres aux Corinthiens, Paul emploie plusieurs fois des métaphores inspirées de ces compétitions entre cités qui étaient un élément majeur de la culture grecque. Pourquoi le fait-il et comment le fait-il ? Et, plus important, qu’estce que ces exemples pris dans la culture antique peuvent nous dire de la vie chrétienne ?
Pratiques païennes
Force est de constater que Paul emploie de nombreuses fois cette métaphore pour parler de la vie des croyants et d’épisodes de sa vie personnelle sans jamais pour autant la critiquer d’un point de vue religieux. Pourtant n’était-il pas un Juif pharisien et fier de l’être (cf. Ph 3,5) attaché aux traditions de ses Pères (cf. Ga 1,14) ? Et les Juifs n’étaient-ils pas de farouches adversaires de ces pratiques païennes ? Les récits du livre des martyrs d’Israël racontent l’opposition à la culture grecque qui est – en partie – à l’origine de la révolte de la Judée sous les Séleucides (-168). « Jason [le grand-prêtre] se fit en effet un plaisir de faire construire un gymnase au pied même de l’Acropole et il conduisit les meilleurs des éphèbes sous le pétase » (2 M 4,12), c’est-à-dire sous le chapeau grec traditionnel associé aux jeux. En réalité, au temps de Paul, les choses avaient changé, le judaïsme hellénique conjuguait sans complexe une fière identité juive avec la pratique de pans entiers de la culture grecque. On sait, par exemple, que les Juifs de Milet, en Asie mineure, avaient leurs sièges réservés au théâtre et la synagogue de Sardes était contiguë au gymnase [1]. Le judaïsme,