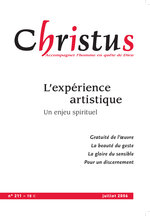Gabriel Miró est né en Espagne, à Alicante, en cette terre levantine d’où il tirera l’essentiel de son inspiration. Nulle oeuvre au demeurant aussi universelle que la sienne, peu d’écrivains s’étant risqués à décrire l’état contemplatif avec une telle transparence : « ... Nous entendîmes la messe, la messe de l’Ascension, vibrante de canaris, dans une église blanchie à la chaux et aux fenêtres de moulin, où entraient un ciel géorgique et un bruit d’eau de rigoles. Si nous avions toujours pu vivre en ce lieu !... Et comme nous ne le pouvions pas, nous voulûmes déjà nous en aller car nous voulons “cet” instant, et cet instant a besoin d’une émotion suivie pour être et s’affiner de manière évocatrice. »
Trois expériences commandent l’oeuvre de Miró. L’autobiographie spirituelle d’abord, répartie en quatre livres et à propos de laquelle on l’a comparé à Marcel Proust ou Virginia Woolf. Ensuite, l’expérience imaginative, romanesque. Enfin, Miró attacha la plus grande importance à l’expérience religieuse, en se livrant à de minutieuses descriptions de « vieilles estampes par naïveté, désir naïf, c’est-à-dire inculqué dans mon sang et mes os depuis l’enfance, de regarder de près l’horizon chrétien, reconstruisant ce que ne nous disaient pas les textes directs et sacrés ». Il souligne ailleurs combien, au collège jésuite d’Orihuela, l’initiation à la « composition de lieu » et à la rumination des mots mêmes de l’Évangile, à la manière des Exercices spirituels, fut pour lui déterminante
Trois expériences commandent l’oeuvre de Miró. L’autobiographie spirituelle d’abord, répartie en quatre livres et à propos de laquelle on l’a comparé à Marcel Proust ou Virginia Woolf. Ensuite, l’expérience imaginative, romanesque. Enfin, Miró attacha la plus grande importance à l’expérience religieuse, en se livrant à de minutieuses descriptions de « vieilles estampes par naïveté, désir naïf, c’est-à-dire inculqué dans mon sang et mes os depuis l’enfance, de regarder de près l’horizon chrétien, reconstruisant ce que ne nous disaient pas les textes directs et sacrés ». Il souligne ailleurs combien, au collège jésuite d’Orihuela, l’initiation à la « composition de lieu » et à la rumination des mots mêmes de l’Évangile, à la manière des Exercices spirituels, fut pour lui déterminante