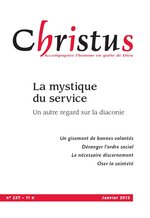Je suis né d’une triple rencontre des hommes et de Dieu, d’un triple baptême, celui des commencements (1912 à Lyon) ; celui de la jeunesse : les mouvements des années trente et l’entrée dans la Compagnie de Jésus (1934 à Moulins) ; celui de la maturité : la grâce « concentrationnaire » à Dachau (1940-1945). Je vis désormais la mémoire de cette histoire à faire et à refaire, en « rattrapant » les étapes de ces baptêmes par la force des Exercices spirituels – lumière militante et passion christique.
Il y a deux manières d’être fidèle à nos « compagnons de destin ». La première fidélité est d’évoquer par le récit la vie quotidienne de là-bas et tout ce qu’alors nous avons reçu de nos frères humains. Ainsi sortent de l’oubli la déportation, les camps et ce qui s’est ensuivi. S’impose alors une seconde démarche, difficile, et qui consiste à laisser retentir en soi, d’abord dans le silence méditatif, les blessures du passé et, davantage encore, les invitations, inscrites au plus profond de nous, à retrouver notre dignité. S’y exprime l’appel, reçu là-bas, de Dieu et des hommes.
Il importe à l’homme qui construit son histoire de repérer les lieux, les modes de vie qui deviennent sans retour, à un moment donné, des modes de mort ou des « façons de