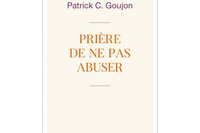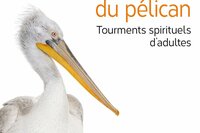La lecture est une école de l'esprit où peut s'exercer le détachement de soi, l'attention aux mouvements de la vie, mais aussi l'écoute et l'accueil de l'autre. Mais si la conversation spirituelle s'enrichit de nos lectures, elle peut en retour transformer nos façons de lire.
On lit seul, on converse à plusieurs. Ce n'est que par métaphore qu'on peut dire que le lecteur entretient avec l'auteur du livre, ou les mots du livre lui-même, une conversation. Solitaire, le lecteur ne l'est peut-être pourtant qu'aux yeux de ceux qui le regardent et, si l'on pouvait entendre toutes les voix qui chahutent, professent, enseignent, pleurent ou interrogent dans ces têtes penchées, on en serait plus étourdi qu'au sortir d'une bruyante assemblée générale. Par ailleurs, la lecture entretient avec la conversation des liens essentiels qui ont à voir avec deux facultés nécessaires à l'une comme à l'autre, une certaine mobilité ou souplesse de l'esprit et, tout autant, une grande attention. La fréquentation des bons livres est ainsi considérée depuis longtemps comme un exercice préparatoire à la pratique de toutes ces formes de la conversation qui fondent et réalisent un idéal politique (qu'il s'agisse de l'aristocratie ou de la démocratie), culturel (la République des lettres) ou spirituel.
Regardant ces liens de plus près pour identifier les conditions selon lesquelles la lecture forme l'esprit et la personne tout entière à entrer dans une conversation féconde avec un autre, on verra aussi que la conversation spirituelle peut, comme en retour, faire porter du fruit à nos lectures.
Ne fuyons pas trop vite – au motif que nous sommes à