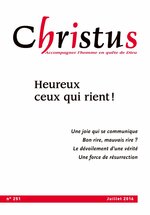« C’est pour rire ! » L’expression s’emploie souvent pour dire : « Ce n’est pas grave ! » et signifier à quelqu’un que la plaisanterie ou le trait d’esprit qui lui est adressé à pour but de rire ensemble sans intention de blesser. Comme si le rire avait le pouvoir d’alléger une réalité qui pourrait être blessante. Mais nous touchons là l’ambivalence du rire qui a toujours suscité une grande méfiance, tout spécialement dans la vie et la tradition spirituelles. Méfiance qui venait de son usage rituel dans les liturgies païennes, méfiance liée à l’expression de mépris ou de refus qu’il peut signifier, ou encore par la futilité ou la méchanceté qu’il véhicule aussi parfois. Pourtant le rire, dans les différentes formes de la gaieté, n’exprime-t-il pas au mieux l’allégresse intérieure, la joie que l’Esprit nous transmet ? Le rire et plus encore la capacité à rire de soi ne sont-ils pas les meilleurs remparts contre la moquerie qui salit, les meilleurs garants contre un sérieux qui dramatise et durcit la vie ?
« Ayez toujours le visage riant » (François d’Assise)
Pour les chrétiens, le rire, l’humour, le sourire, la gaieté sont autant de manières d’exprimer la joie d’être sauvé en Jésus Christ. L’Esprit nous fait renaître à chaque fois de l’amour gratuit de Dieu qui ne cesse de nous engendrer à chaque bonne œuvre, en son Fils, comme l’écrit Origène au IIe siècle : « Heureux celui qui est sans cesse engendré par Dieu ! » (Homélies sur Jérémie, 9, 4). Les récits des Actes des Apôtres le donnent à sentir et à toucher. C’est la présence invisible de Dieu, le don de son Esprit, c’est donc la grâce de Dieu qui se manifeste dans ces signes de joie très inventive, jusque dans les épreuves