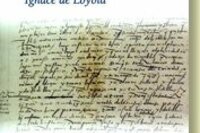Patrick GOUJON s.j. Centre Sèvres, Paris. A publié : Prendre part à l’intransmissible. La communication spirituelle à travers la correspondance de Jean-Joseph Surin (Jérôme Millon, 2008). Derniers articles parus dans Christus : « La relation de l’homme à Dieu selon Ignace » et « Pudeur et délicatesse » (n° 230HS, mai 2011).
À la faveur des renouveaux qui ont traversé l’Église, et comme en témoigne l’engouement pour des spiritualités hors frontières, l’affectivité a acquis dans nos manières de vivre et de penser une place qu’elle semblait n’avoir jamais eue dans le christianisme. L’affectivité n’est pas une dimension secondaire de notre humanité. Il y a affectivité parce que nous sommes des êtres de relations. Elles se vivent au travers de nos cinq sens dont l’unification forme la sensibilité, racine de nos manières d’être 1. Quelle place l’affectivité tient-elle dans les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola et de quoi celui-ci a-t-il hérité ? Poser cette question à notre passé devrait nous permettre de situer ces retours de l’affectivité dans nos propositions actuelles pour faire en sorte qu’elles soient des occasions d’évangélisation de nos existences. Le titre des Exercices indique déjà la place qu’occupe l’affectivité : Exercices spirituels pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie sans se décider par quelque attachement qui serait désordonné (Ex. sp. 21) 2. Encore faudra-t-il s’entendre sur le chemin spirituel qui s’ouvre ainsi et comprendre que, loin de s’en tenir à un point de vue moral et ascétique (un combat contre les attachements désordonnés), Ignace accorde à l’affectivité un rôle central. En elle se déchiffre et se nourrit le dynamisme qui porte l’homme vers Dieu, là où Il vient : la chair visitée par