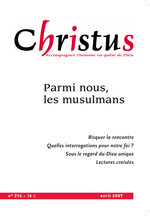OEuvre conjointe de René-Samuel Sirat (Grand Rabbin du Consistoire central de France), d’Olivier de Berranger (évêque de S aint-Denis) et de Youssef Seddik (spécialiste de la pensée islamique), ce livre a été publié par Bayard en 2007, il compte 302 pages et coûte 20 euros.
Il est des livres qui arrivent à point nommé ! Celui-ci en est un, qui convoque trois hommes de
Il est des livres qui arrivent à point nommé ! Celui-ci en est un, qui convoque trois hommes de