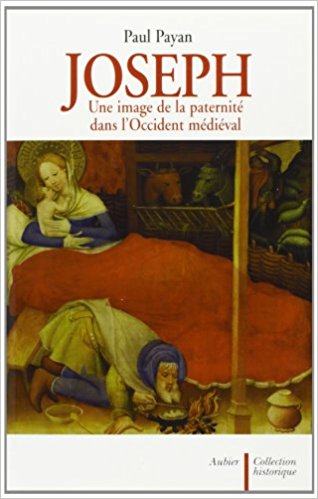Aubier, coll. « Historique », 2006, 476 p., 24,50 euros.
Ne cherchez pas saint Joseph dans la Légende dorée ! Ce n’est qu’à partir du XVe siècle qu’apparaît un culte à l’époux de Marie, « ce saint qui ressemble si peu à un saint », lui dont la vie ne comporte ni miracles, ni faits héroïques. Le premier à proposer Joseph comme modèle de vertu chrétienne est le chancelier Gerson (1363-1429). Sa vigoureuse construction théologique sera sans effet immédiat. Indépendamment naîtront çà et là de discrets efforts pour honorer Joseph le 19 mars. Début d’un culte qui s’affirmera de façon décisive à la fin du siècle, grâce aux franciscains qui présenteront Joseph comme un exemple à suivre et un modèle de vie. Chose remarquable, le culte liturgique a ici précédé la dévotion populaire. Pour retracer cette histoire méconnue, Paul Payan scrute les textes : traités théologiques, sermons, mystères, fabliaux. Parallèlement, il analyse d’innombrables représentations iconographiques, dont, bien sûr, l’interprétation offre des sens pluriels. Cette variété de significations a sans doute favorisé l’essor du culte de saint Joseph. La pluralité des rôles qu’il assume en fait un personnage très humain auquel chacun peut facilement s’identifier : c’est un peu « Monsieur Tout-le-monde ». Pour autant, peut-on voir en lui « une image de la paternité divine dans l’Occident médiéval », comme l’annonce le sous-titre de l’ouvrage ? Ce n’est pas si évident, et, au terme de son enquête si riche, si rigoureusement menée, la conclusion de l’auteur nous laisse un peu sur notre faim.
Ne cherchez pas saint Joseph dans la Légende dorée ! Ce n’est qu’à partir du XVe siècle qu’apparaît un culte à l’époux de Marie, « ce saint qui ressemble si peu à un saint », lui dont la vie ne comporte ni miracles, ni faits héroïques. Le premier à proposer Joseph comme modèle de vertu chrétienne est le chancelier Gerson (1363-1429). Sa vigoureuse construction théologique sera sans effet immédiat. Indépendamment naîtront çà et là de discrets efforts pour honorer Joseph le 19 mars. Début d’un culte qui s’affirmera de façon décisive à la fin du siècle, grâce aux franciscains qui présenteront Joseph comme un exemple à suivre et un modèle de vie. Chose remarquable, le culte liturgique a ici précédé la dévotion populaire. Pour retracer cette histoire méconnue, Paul Payan scrute les textes : traités théologiques, sermons, mystères, fabliaux. Parallèlement, il analyse d’innombrables représentations iconographiques, dont, bien sûr, l’interprétation offre des sens pluriels. Cette variété de significations a sans doute favorisé l’essor du culte de saint Joseph. La pluralité des rôles qu’il assume en fait un personnage très humain auquel chacun peut facilement s’identifier : c’est un peu « Monsieur Tout-le-monde ». Pour autant, peut-on voir en lui « une image de la paternité divine dans l’Occident médiéval », comme l’annonce le sous-titre de l’ouvrage ? Ce n’est pas si évident, et, au terme de son enquête si riche, si rigoureusement menée, la conclusion de l’auteur nous laisse un peu sur notre faim.