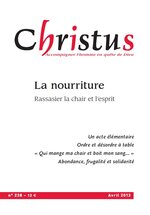Qui l’eût cru ? Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957), un aîné sur le chemin de la prière ! Lui, le flambeur, l’homme à femmes (de préférence mariées), l’homme aux belles voitures, l’homme toujours « fauché », celui avec qui ses amis n’ont jamais pu avoir cinq minutes de conversation sérieuse !
C’est pourtant ce que cet auteur, par-delà la désinvolture et la provocation, est devenu pour moi. J’avais déjà été impressionnée par son attitude en fin de vie, dans le poème Suite de Pâques, écrit aux heures d’insomnie d’un cancer métastasé au cerveau. J’écrivais alors : « Je retiendrai surtout, à l’heure où il a fallu déposer vigueur et beauté, la grande docilité ; à l’heure où il a fallu entrer dans l’absence de tout repère, l’humble patience ; aux heures où il a fallu endurer angoisse et culpabilité, l’obstination à compter sur Dieu. 1 »
À lire et relire l’œuvre du poète, nous percevons une voix, comme dans un ensemble musical, qui, discrète mais insistante, prie. Je voudrais y être ici attentive. Cette voix se fraie un chemin en des conditions propices, non pas liées à une existence facile, mais à une attitude favorable, stable dans l’instabilité même. La prière prend alors ses formes propres. Par elle, nous est donné d’entrevoir le Dieu qui habite ces pages.
1. « Un quelconque travail », dans Nouvelle revue théologique, n° 128 (2006), p. 627.
Une vie
Dadelsen est poète. L’Alsace, son pays d’origine, a fortement marqué son œuvre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fit la campagne de Belgique, rejoignit Londres en 1942, et les FFL. Il tint des chroniques à la BBC après la Libération. Ami de Camus, il fut