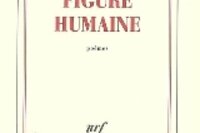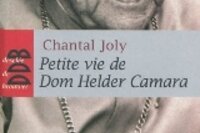Une expérience extrême
Quel droit avons-nous de soumettre à une analyse littéraire une expérience aussi extrême, vécue par autrui et proprement incommunicable ? Aussi bien, il ne saurait s'agir ici de la « soumettre », mais de tenter de remplir de notre mieux le rôle d'un lecteur réceptif à la grandeur d'une oeuvre tout entière élaborée à partir de sa constante mise en doute par l'auteur lui-même. Au processus