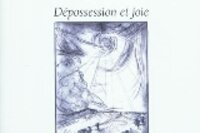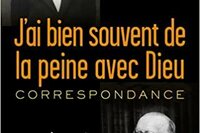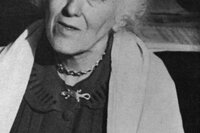François MARXER Centre Sèvres, Paris. Dernier article paru dans Christus : « Thérèse de Lisieux : enfantine ou infantile ? » (n° 217, janvier 2008).
Il y a deux nuits : la nuit et une autre Nuit. L’on aurait plaisir à reconnaître dans la première la nuit romantique, somptueusement enveloppée d’une « ombre tiède et trouble » : l’obscurité y est « translumineuse, dit Roland Barthes, dans l’intérieur noir de l’amour ». Les mystiques, eux – Jean de la Croix en tête –, nous confirment l’autre Nuit où s’éprouve « le froid glacial du vide absolu ». Mais, ajoutent-ils, au-delà de cette nuit, ils ont retrouvé la lumière, « une lumière véritable. La nuit n’est qu’une étape nécessaire et une épreuve. Après elle, la “vraie vie commence” » 1. Leur assurance nous émeut, voire nous bouleverse, mais la commune et pusillanime médiocrité de nos états d’âme, feu roulant de nos fols enthousiasmes ou langueur de nos résignations impossibles, nous laisserait en retrait, comme sur nos gardes. L’expérience de la nuit n’est pas simple, elle est courageuse. La nuit, nous le savons tous, est disparition de la lumière et règne de l’obscurité. L’expérience peut en être heureuse et apaisée : c’est la nuit parfumée, frémissante de multiples et secrètes présences, « où fermente toute l’animalité du monde » ; la nuit d’été, propice, on le sait, aux elfes et aux fées ; ou, au contraire, en notre enfance si impressionnable, ce peut être l’épreuve terrifiante de la perte de tout repère, la perte du monde familier. Mais l’autre Nuit – ou, comme la désigne Catherine Chalier, « la nuit de la nuit » – est autre : elle intrigue la pensée, assaille le coeur et inquiète l’âme sereine. S’en approche la grande peinture, laquelle est d’un accès plus aisé, plus immédiat, toute savante et travaillée qu’elle soit : sans doute parce